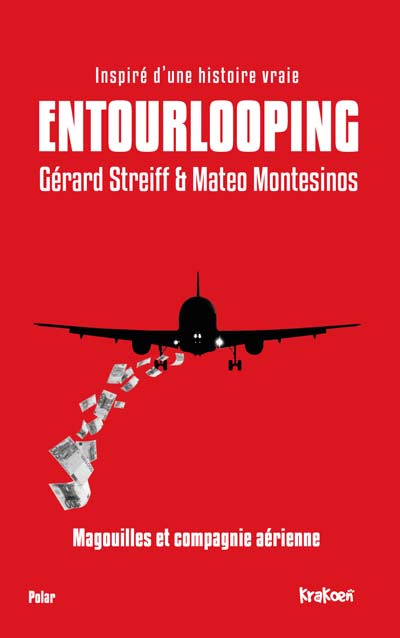ENTOURLOOPING
Matéo Montesinos
Gérard Streiff
Ce récit est inspiré de faits réels, survenus dans les années quatre vingt-dix, mais l’histoire racontée ici est une pure fiction.
Chapitre 1
Roissy CDG.
La bête grognait. Ça faisait un drôle de bruit, entre râle, roulement et cliquetis. Dans un mouvement perpétuel, ça chuintait, ça crissait, ça coulissait. Comme si la monstrueuse machine soupirait, soufflait, souffrait. Vera se trouvait au troisième sous sol, dans un bunker bétonné et vaste comme une cathédrale, éclairée par des batteries de néons. Elle qui aimait se faire peur, elle était servie. Elle venait de grimper au sommet d’un étroit escalier métallique installé sur les flancs du monstre, une dentelle d’acier qui laissait voir le vide, vertige. Du haut de sa tourelle, lilliputienne devant Gulliver couché, elle contemplait une sorte de gigantesques montagnes russes. Le manège s’étalait sur sept niveaux : un tapis roulant, venu des tréfonds, faisait des tours et des détours, décrivait des circonvolutions et lançait des passerelles sur des kilomètres, « 64 km » lui avait-on dit. Des dizaines de bouches d’ombre, aux différents étages, vomissaient régulièrement sur le tapis des wagonnets, bacs de 80 cm sur 150, cinq mille au total. Destinés à contenir chacun une valise, ils formaient un carrousel sans fin. Ces bacs en plastique circulaient à la queue leu leu à un rythme inégal mais incessant : ils dévalaient de courtes pentes, filaient sur le plat, escaladaient plus poussivement de longues montées, et ainsi de suite. L’engin ne s’arrêtait jamais. Le cortège se recomposait sans cesse ; il semblait passer et repasser, répétant le même circuit jusqu’à ce qu’il ait reçu l’ordre de filer vers tel ou tel terminal. Vera tentait de suivre le mouvement des cuvettes mais tout allait vite, trop vite, le regard se perdait entre les couloirs de circulation, les niveaux de l’appareil, les échangeurs. Un bac vide, une valise rouge, trois bacs vides à la suite, un sac à dos tout enturbanné de plastique, un bac vide, des pieds, un autre bac vide. La farandole disparaissait puis resurgissait un étage en dessous. Un colis ficelé, un cylindre, un bac vide, des bras, une longue séquence de tapis vide de tout récipient, trois bacs chargés qui bouchonnaient. Ce manège lui donnait le tournis. On l’avait prévenue pourtant, un gars rencontré à Emmaüs, lui avait dit : « La mine, tu verras, ça fout les boules ! ». Mais bon, c’était pas très clair comme mise en garde. Les boules, c’est vague ! Et puis Vera voulait voir. Elle entendait souvent parler de la Mine, du « stockeur », de la grande procession des bagages, 40 000 colis par jour, venus de partout, repartant aussitôt partout, ou presque ; elle avait eu très envie de cette escapade. Enfin elle pouvait accéder à la trieuse. Elle était d’abord descendue au fond d’un puits carré, par un impressionnant escalier de béton ; les murs gris étaient décorés de quelques messages obscènes, « Karim suce à 17 heures… », suivait un lieu de rendez-vous illisible, ou « Robert, ta mère m’a enc… », une délation restée inachevée, tout cela accompagné parfois de croquis gribouillés, une bite incertaine, des jambes écartées. Tout en bas, une porte donnait accès à l’antre. Vera avait voulu voir, elle n’était pas déçue du voyage. Finalement ce n’était pas tant la masse de la machine, son ampleur phénoménale, l’armada de valises qui l’angoissaient, ni le ronronnement rageur de cet ogre impatient, c’était l’absence totale de tout être humain dans cet espace. Pas un employé à l’horizon, pas la moindre âme qui vive, aucun contrôleur ni agent de sécurité, aucun ouvrier d’entretien, rien. Exit les uniformes, omniprésents sur le reste du site. Ici, on était face à un assemblage de poutrelles métalliques, de roulements à bille, de tapis, de bacs, de robots et de rien d’autre. La machine et rien que la machine occupait tout l’espace.
Vera tenta une nouvelle fois de fixer son attention sur le tapis, un bac vide, une valise noire, un bac vide, deux bras, un ballot cartonné, un bac vide. Alors elle tourna la tête vers la porte par laquelle elle venait d’arriver, histoire de retrouver un point fixe, un repère, pour se reprendre, ne pas se laisser obséder par le spectacle. Elle n’était pas sûre en effet d’avoir bien vu, elle n’avait rien vu en fait, sinon un invraisemblable petit train qui montait, descendait, tournoyait, bifurquait, disparaissait, recommençait l’opération à un autre niveau et ainsi de suite. Elle se dit qu’elle avait rêvé ; puis son regard revint, lentement, vers la bête et cette fois elle chercha un bac en particulier. Elle retrouva finalement la cuvette qu’elle s’obligea à fixer, une cuvette gris pâle identique à des milliers d’autre, quoique … Celle-ci était à quelques dizaines de mètres de la jeune femme mais on y distinguait bien deux pieds qui pendaient sur le devant, ballotant un peu, et deux bras dressés vers l’autre bord, comme quelqu’un qui lèverait les mains pour se rendre. « Ne tirez pas ! » Vera scrutait le bac, plissait les yeux comme un myope, regardait le machin sans tout à fait saisir de quoi il s’agissait. Ça n’imprégna pas vraiment ses neurones. C’était quoi, cette espèce de mannequin égaré parmi ces colis ? Quand le bac disparut de sa vue, comme happé par une fosse, elle comprit où le petit véhicule allait logiquement ressortir, là haut, au dessus d’elle et comment il longerait ensuite sa tourelle avant de repartir dans les entrailles ; comme si cette cuvette était à la dérive, comme si, quelque part, dans le cerveau de ce Meccano géant, on n’avait pas encore décidé de son sort. C’est effectivement ce qui arriva. Cette fois, il ne lui fut pas trop difficile d’identifier la chose. Passa, tout ratatiné dans son bac, la tête et les jambes comme collés au tronc, le cadavre d’un homme tombé ou poussé là, au beau milieu d’une procession de valises juste sorties des soutes du Vienne-Paris de 21hoo, Terminal 2F. Il portait un long manteau noir tout chiffonné. A présent, elle ne remarquait plus que ça, ce gros escargot qui squattait une des cases du serpentin. Alors Vera dodelina de la tête, signe chez elle de grande contrariété ; elle se dit que ce n’était pas une si bonne idée de descendre dans la mine lorsqu’elle vit, au pied de la passerelle, un type qui semblait plutôt pressé, le seul humain à la ronde dans ces catacombes. Émit-elle un bruit ? Dégagea-t-elle des ondes particulières ? Ou une odeur de bête à part ? En tout cas, le passant leva les yeux, la repéra. De lui, elle retint surtout la tête, un bonnet de marin bleu nuit sur un visage tout en creux, les yeux comme des trous, les joues excavées ; elle ne remarqua pas vraiment ses fringues, genre bleu de travail peut-être, nota simplement qu’il portait un petit sac à dos ; il y avait dans son regard quelque chose qui crépitait. C’était comme une décharge, elle ne trouva pas un autre mot. Le temps d’encaisser, l’autre avait déjà disparu.
Chapitre 2
Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’appréhende le lundi matin. Dans mon enfance, à Fuveau, près de Marseille, quitter le cocon familial, retrouver le maître, la discipline, ces journées interminables, ennuyeuses, c’était un véritable calvaire, une souffrance que les mots doux de ma mère, m’accompagnant à l’école, n’arrivaient pas à soulager. Les dernières heures du dimanche s’écoulaient trop vite. Au grand étonnement de mon père, je restais longtemps à table pour essayer de retarder le moment fatidique du coucher. Aujourd’hui encore, adulte, le malaise rode ; il s’évanouit certes après quelques instants mais il est toujours présent.
En plus, cette semaine, j’hérite d’un dossier que je ne sens pas. La radio annonce les dernières nouvelles et répète les résultats du foot de la veille. Ça débute mal.
Face au miroir de la chambre à coucher, je finis d’ajuster mon nœud de cravate tout en regardant dans la glace Hélène qui s’étire dans le lit. Sa nuisette est relevée sur ses cuisses, la blancheur de sa peau me tente. Je la contemple puis je confie :
– Aujourd’hui ça va être ma fête.
– Pourquoi ?
– Tu n’as pas entendu ? Le PSG a battu l’OM hier soir au Parc des Princes.
– Et alors ? Tu t’en moques.
Je vais m’asseoir sur le rebord du lit, je la caresse lentement.
– Écoute, depuis que Marcel Pagnol a inondé la France de ses romans à l’eau de rose, les peuplades du nord de la Loire sont convaincues que les Marseillais passent leur temps à boire du pastis, à jouer aux boules, à faire la sieste, et bien entendu à parler de l’OM.
– Mais ce n’est pas toi, ça ?
– Oui…j’ai bien essayé de leur faire comprendre que Marseille, ce n’était pas que ça, je les ai bassinés sur Marseille, ville rebelle, ville populaire…
– Métissée…
– Ville métissée, oui ; et puis Marseille, ça se résumait pas au vieux port et à la Canebière mais rien à faire ! Ils me regardent comme si je venais d’une autre planète. Alors je rentre dans leur jeu ; la vérité les décevrait. Comme les enfants qui découvrent que le papa Noël n’existe pas. Aujourd’hui, ils m’attendent de pied ferme.
– Mon pauvre amour… fait mine de s’apitoyer la créature couchée devant moi.
Son odeur, au réveil, sucrée, on la dirait emmiellée, me fait chavirer. Ses yeux bleus, qui parfois passent au gris quand elle est en colère ou s’assombrissent quand je suis en elle, pétillent de malice. Elle tire sur ma cravate, me déséquilibre, me murmure :
-Il a besoin de réconfort mon petit Matéo…
Je vais être en retard mais, enfant, j’aurais aimé pouvoir imaginer qu’il existait aussi de tels lundi matin.
A l’intérieur de Paris, la durée d’un trajet d’un point à l’autre est, un peu comme la matière grasse sur l’étiquette d’un fromage corse, indéterminée. De la rue Traversière, dans le 12ème arrondissement, au Château des Rentiers, dans le 13ème, je mets, ce lundi-là, trente minutes. Cela aurait pu être cinquante-cinq minutes, cela aurait pu être vingt minutes, c’est trente minutes, on ne sait pas pourquoi. C’est ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette ville ; d’un jour à l’autre, je parle de jours ordinaires, où il ne se passe rien de particulier, aucun événement notable, on peut multiplier par deux le temps du transport. Chercher une place de parking dure encore dix minutes et j’arrive au bureau, au huitième étage de la BRDE, la Brigade de Répression de la Délinquance Economique, à dix heures. L’horaire « normal » de travail, 9h / 19h, est purement virtuel, personne ne le respecte. Tous, nous dépassons allègrement les 40 heures par semaine et personne ne s’en plaint.
Bien évidemment, dès la sortie de l’ascenseur, j’ai droit, comme prévu, aux plaisanteries du genre :
– Matéo, est-ce que tu as vu le match hier soir ? Matéo, est-ce que tu peux me dire quel est le résultat de l’OM ? Matéo ci, Matéo là…
Je fais front et j’accède à mon bureau.
Trois ans que je bosse ici. De la chance, je l’avoue. Après ma maîtrise d’histoire, j’ai passé, sur un coup de tête, le concours externe d’Officier de Police Judiciaire. Dans la foulée, un an de formation à Cannes ( Cannes l’Ecluse en Seine et Marne, je précise, pas Cannes sur la Côte d’Azur…). J’en suis sorti parmi les meilleurs de la promo, restez assis, je vous en prie, et j’ai postulé très rapidement pour cette place à la Brigade, rue du Château des Rentiers. On m’y a de suite admis. Trois ans donc sans regret. Les juges du pôle financier de la rue des Italiens nous saisissent régulièrement pour des enquêtes qui concernent parfois des élus de haut rang, voire des anciens ministres. Tous défilent dans nos bureaux vieillots, tout étonnés de se retrouver dans cet environnement. On a le sentiment d’être utiles, indépendants ; ici, l’argent ou le pouvoir ne permettent pas de s’affranchir de la loi.
Je me souviens par exemple de la mise en garde à vue de Patrick Kilkeny, pour une sombre affaire d’emploi fictif, et de son interrogatoire par Bati. Bati, c’est mon collègue de bureau, Jean-Baptiste Ordioni, mon aîné, 55 ans, trente ans de boîte. A deux doigts de la retraite, le bonhomme, une silhouette longue, étroite, la tignasse noire, un vrai casque de cheveux, on dirait une perruque, le visage pointu, l’oeil inquiet, trimbale en permanence une barbe de trois jours. Et toujours sapé comme un milord. Enfin, un milord, c’est peut-être beaucoup dire ; mais il aime l’élégance, ce vieux beau.
Pour en revenir à Kilkeny, je me souviens de la nuit que ce dernier a passée dans les cellules du commissariat du 13ème. On y envoie en effet les suspects lorsqu’on a des gardes à vue qui se prolongent, n’ayant pas la place nécessaire à la brigade. Aux questions des prostituées et des poivrots qui l’entouraient, « Mais qu’est-ce qu’il fait là lui ? », Kilkeny eut cette réplique : « Je suis ici pour le repérage d’un film. » Chaque fois que je le revois à la télévision, je l’imagine encore dans sa cellule, le camarade qui faisait un « repérage »…
Bati n’est pas encore arrivé. Il faut dire qu’il vient quand il le décide. A quelques mois de la retraite, il n’en a rien à braire, comme il dit. Je m’empare du dossier que le boss m’a confié il y a déjà quinze jours. Il y est question du Comité Central d’Entreprise d’Air France. Cela ne me dit rien. Pour moi, dès qu’on parle comité d’entreprise ou comité d’établissement, j’ai une pensée pour mes potes du temps de l’école. En septembre, ils parlaient tous de leurs colos et des vacances qu’ils avaient passées grâce au « comité d’entreprise » de la boîte de leur géniteur. Je les enviais un peu. Moi, je n’y avais pas droit. Mon père, qui avait fui le franquisme, était devenu ouvrier agricole. Il n’y avait guère de comité d’entreprise ni de colos dans ce milieu. En revanche, à quinze ans, je savais conduire les tracteurs, tailler la vigne, chasser les grives à la volée et j’avais même réussi à construire une fouine pour attraper les anguilles dans le ruisseau qui coulait derrière la maison. On ne peut pas tout avoir.
Retour au dossier : il s’agit d’une plainte pour faux, usages de faux, escroquerie et abus de bien social. Y est joint un audit de gestion du cabinet Sécafi Alpha. Cette affaire semble déplacée à la BRDE. Je finis une lecture rapide des pièces quand Bati fait son entrée. Midi approche. Aujourd’hui, il porte son trois pièces en denim, couleur bleue noir, des poches partout, sur la veste, le gilet, le pantalon, une petite chemise en coton col Nehru, ton parme. Simple et chic et il le sait. Ça compense un peu sa tête renfrognée, on dirait qu’il s’est couché très tôt ce matin. Il me serre la main sans ouvrir la bouche et va s’asseoir en regardant par la fenêtre Je me lève, je prends le dossier et le pose sur sa table :
– Vieillard, j’ai déjà fait ta part de travail. Alors pendant que je vais déjeuner, tu me convoques le Secrétaire général du CCE d’Air France, Bernard Boulineau et, dans la foulée, le DRH qui est cité, Jean-Pierre Hervé. Bon, moi, je vais me sustenter.
Il me scrute avant de répondre :
-Petit, écoute-moi : la vie ressemble à une échelle de poulailler, courte et pleine de merde. Réfléchis à çà.
Sur ces fortes paroles, il va fermer la porte et contempler deux reproductions épinglées derrière son bureau, « L’origine du monde » de Gustave Courbet et « L’autoportrait » de Vincent Van Gogh. Ces images mettent mal à l’aise tous ceux qu’on auditionne ici. Je dois reconnaître que la nudité du Courbet et le regard halluciné de Van Gogh ne me laissent pas insensible.
– Merci, Confucius, pour cette haute leçon de philosophie mais tente tout de même de gagner une partie de ta paye ; je te signale que ce soir, je ne ferai pas de rab.
Je sors, accompagné d’un sonore « Petit con ! ».
Chapitre 3
Roissy CDG.
L’impasse Christian Blanc formait un cul de sac, comme son nom l’indiquait. Mais les gens, dans l’attente de leur vol, y traînaient volontiers à longueur de journées, lesquelles pouvaient commencer très tôt et s’éterniser jusqu’au milieu de la nuit. Plus exactement, ils déambulaient, indécis, insouciants aussi, entre un magasin d’alimentation et une librairie qui occupaient une partie de cette galerie marchande de Roissy 2, avant de s’éloigner vers d’autres superettes ou boutiques de souvenirs. Cette impasse finissait sur un vaste miroir où les passagers, les équipages, les employés également se contemplaient, l’air de rien. Certains prenaient la pose, redressaient le pli d’un vêtement, lissaient la jupe, ajustaient le calot. D’autres s’ébouriffaient les cheveux, alignaient une frange effrontée ou plaquaient une mèche rebelle. Il arrivait que des passants, et pas forcément des enfants, tirent la langue ou fassent toutes sortes de mimiques. Cette cohorte de Narcisse se trouvait ou fort beaux ou très laids mais, curieusement, tous repartaient également rassurés. Et naturellement personne ne pouvait s’imaginer que le mur de glace qui leur faisait face était sans tain, et que, de l’autre côté du miroir, on pouvait les regarder se regardant, les voir sans être vus. Il serait plus correct d’écrire : elle pouvait les regarder.
Derrière la vitre, en effet, Vera, allongée sur une pile monumentale de couvertures estampillées « Air France », avait une vue panoramique sur la galerie, sorte de salle des pas perdus qui s’étendait devant elle. Elle était un peu comme l’unique spectatrice devant un écran géant, un cinémascope pour elle toute seule. L’espace où elle se trouvait, de forme triangulaire, aux côtés à peu près égaux de quatre mètres environ, était vide ; deux parois, en contreplaqué, enserraient donc une glace. La lumière de la galerie qui se diffusait en partie à travers le miroir répandait dans cette pièce une pénombre plutôt reposante. L’endroit était ignoré de tous, enfin presque ; il n’apparaissait sur aucun plan, aucun cadastre ; c’était un de ces lieux perdus, oubliés par les architectes lors du dernier aménagement de l’aérogare. Un angle mort comme on dit. Personne ne s’était jamais soucié de son existence, ni les voisins boutiquiers, ni les gens de la sécurité ou de l’entretien. Une petite porte étroite, dans un couloir en retrait, y donnait accès mais tout se passait comme si nul n’y avait jamais prêté attention. Exceptée Vera.
Vera Fanta venait de Roumanie. Et puis du ZAPI, la Zone d’Attente des Personnes en Instance, à Roissy 2E. Son arrivée en France avait été agitée ; elle avait fait le voyage, Bucarest – Paris, , accompagnée de son fiancé, que tout le monde au pays, là-bas, appelait Tricolori, ou plutôt Trico. Comme c’était un fana de l’équipe nationale de football aux trois couleurs, jaune, bleu et rouge, ce surnom lui était venu tout naturellement. Son vrai nom ? Finalement Vera ne le connaissait pas, ou elle l’avait oublié, Matriculu, ou quelque chose comme ça, mais même les flics locaux appelaient son compagnon Trico. Un petit gros, pas vraiment l’air d’un coureur de ballon, un visage d’apoplectique mais une vraie faconde ; tout rond, dans son éternel costar à carreaux – comme les jumeaux d’Alice au pays des merveilles, songea-t-elle - il inspirait plutôt confiance. Et de confiance, elle en avait toujours besoin, Vera, qui d’ordinaire doutait de tous et de tout. Avec le recul, elle se demandait ce qu’elle avait bien pu trouver à ce mec ; simplement, il l’avait tranquillisée. C’est peut-être idiot à dire mais c’était ainsi. En vérité Véra s’était laissée piéger comme une dinde. En Roumanie, du côté de Brasov, elle travaillait dans le tourisme, employée à l’Hôtel Castel Dracula. Sans blague. C’est vraiment ainsi qu’il se nommait : Hôtel Castel Dracula, 53 chambres, un attrape nigauds pour touristes. La direction prétendait que le vampire, l’empaleur, le suceur de sang de vierges avait vécu là. Et le syndicat d’initiative confirmait, bien sûr. Le « must » de l’établissement était la salle rouge sang, très prisée, allez savoir pourquoi, par les visiteurs français. Une nuit y coûtait bonbon, fallait-il être con pour casquer. C’était foutaise et compagnie. Or le coin, l’été surtout, ne désemplissait pas. Vera assurait des visites guidées ; le travail n’était pas trop mal payé mais un jour, elle eut envie de voir ce qui se passait au delà de sa Transylvanie. Surmontant sa peur chronique du nouveau, elle fila à Bucarest, via Brasov, l’herbe, disait-on, y était plus verte et elle se laissa vite séduire, comme une conne de provinciale qu’elle était, par Trico. C’était un bon baratineur, il faut le reconnaître, plutôt drôle, au début ; il lui joua le grand jeu des fiançailles. En une semaine, c’était fait, elle se retrouvait la bague au doigt, fiancée dans les règles. Il lui promit alors des lendemains qui chantaient à l’Ouest. Elle opina, bien sûr. Paris ?! Qui pouvait dire non quand on l’invitait à Paris ? C’est durant le voyage, une fois dans l’avion très exactement, que l’individu lui mit le marché en main : il l’amenait à Paris faire le tapin. Ni plus ni moins. Trico s’avérait être un maquereau et elle, elle serait sa pute. Il lui balança le message quelque part dans les airs, au dessus de l’Europe centrale, tranquillement, naturellement. Sans barguigner. Il connaissait la musique. Ce n’était sans doute pas la première fois qu’il opérait. Il ajouta qu’ils étaient attendus par la « famille », des compatriotes de Brasov, installés en France dans le même business depuis plusieurs mois déjà. Tout allait bien se passer, garantissait-il ; et de toute façon, elle n’avait pas le choix, insinua-t-il. Le gros d’un coup avait l’air sacrément méchant. Elle, pauvre poire, n’avait absolument rien vu venir, elle s’en voulait à mort. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu se jeter ainsi dans la gueule du loup. Que faire ? Boxer le bouffi ? Se planquer dans les toilettes ? Sauter en vol ? Prévenir l’hôtesse ? Trico semblait si sûr de lui ; et puis il détenait son passeport. A l’arrivée à Roissy, elle se sentait anéantie, désarmée. C’est au passage de la douane qu’elle fut saisie d’une impulsion. Remontant la file d’attente, elle se précipita sur la cabine d’une douanière, une Antillaise qui avait plutôt une bonne bouille, en criant « Pas de papiers ! Pas de papiers ! » Un coup de tête. L’esclave se cabrait. Ça n’avait pas traîné : des uniformes l’avaient aussitôt entourée, une demi-douzaine de flics qui agirent en vrais pros. Manifestement, cet incident n’était pour eux que pure routine. Elle fut mise à l’écart en un rien de temps, « exfiltrée » sous le regard sidéré du mac qui n’avait pas prévu ce scénario. On la conduisit dans des bureaux tout proches. Les témoins eurent même l’impression que les policiers et leur prisonnière avaient traversé le mur. Derrière les guichets des douanes, on ne voyait en effet qu’une vaste cloison où s’étalait une promo à la gloire d’une banque « pas comme les autres » ; mais un œil affuté pouvait repérer dans le panneau publicitaire l’encadrement d’une porte qu’il suffisait de pousser pour tomber en plein commissariat. Sans transition. Avec bureau d’accueil, salle d’attente, boxes, cafétéria, etc... Toute une vie parallèle et inattendue. Là, on l’avait longuement interrogée, elle s’était contentée de répéter « Pas de papiers ! » Elle parlait français mais se limita alors à ces trois mots « Pas de papiers ! » Elle n’avait qu’une idée, une priorité absolue, un seul et unique objectif, échapper à son « fiancé ». On l’avait finalement placée en zone d’attente. Adieu Trico ! Bonjour Zapi !
Chapitre 4
Le rituel à la Brigade est immuable. Et il a son importance. Que l’on soit au premier, au cinquième ou au dernier étage, c’est toujours le même fonctionnement : on est prévenu des visites par un coup de fil de l’hôtesse d’accueil, au rez-de-chaussée, et on descend, par l’ascenseur, accueillir l’individu convoqué. Ce sont des moments où le nouveau venu ressent l’atmosphère du service, il se dit que les choses sérieuses commencent. D’ordinaire, dans l’ascenseur, je ne dis pas un mot. Volontairement, j’évite de croiser le regard de l’autre. Disons que c’est une petite mise en scène. Très vite, je sens monter la tension, je devine les regards furtifs de l’invité. Dans le cas présent, c’est différent : Bernard Boulineau, secrétaire général du CCE, est partie civile ; il n’a rien à craindre. D’ailleurs, c’est un gaillard qui approche le mètre quatre-vingt-dix, une force tranquille. Pas facilement impressionnable à première vue. Quoique, comme disait, du haut de ses 160 centimètres, mon ami Aimé Musto, élevé à Frais Vallon à Marseille : « Plus t’es grand, plus tu tombes de haut ! »
Bati est je ne sais où, je commence seul l’audition ; je propose à Bernard Boulineau de s’asseoir sur une des deux chaises dépareillées qui me font face. J’attaque :
– Je suppose, Monsieur Boulineau, que vous n’avez pas trop l’habitude de ce genre de procédure… Alors, quelques mots. Je me présente, Matéo Montesinos. Le Juge, Monsieur Cros, de Bobigny, a confié cette enquête à notre brigade, la BRDE, et mon chef m’a donné le dossier. Voilà. Donc j’ai lu la plainte de votre avocat. Aujourd’hui, vous êtes là pour être auditionné en tant que partie civile. Nous allons d’abord faire un peu le tour de cette affaire. Ensuite je prendrai votre déposition et l’enquête démarrera dès que vous l’aurez signé. OK ?
Il acquiesce et je lui demande de me redire l’origine de la plainte. Boulineau s’éclaircit la voix, tente de se mettre à l’aise sur son siège, très inconfortable, il faut bien le reconnaître, un véritable instrument de torture qui n’est pas là par hasard…Il remonte au début de l’histoire.
– Pendant près de vingt ans, un syndicat, le syndicat des travailleurs libres, a dirigé le Comité Central d’Entreprise, le CCE, avec le soutien d’un syndicat corporatiste des personnels navigants. Il y a quelques mois, une majorité de syndicats s’est formée et a renversé la coalition en place ; elle a constitué une équipe plurielle et dirige à présent le CCE. L’une des premières décisions des nouveaux élus a été de commander un audit par le cabinet Secafi sur la gestion de l’ancienne équipe,. Notre avocat a du vous transmettre cette étude .
– Et c’est à l’issue de cet audit que vous avez décidé de porter plainte contre X ?
– Les auditeurs nous l’ont recommandé. D’après eux, il y a là assez d’éléments pour justifier une enquête. Ils soupçonnent clairement, ils ne l’ont pas écrit mais ils me l’ont dit, un détournement de fonds.
– Vous pouvez préciser.
– Il y a d’abord le licenciement d’un employé, un certain Argentino ; c’est un licenciement déguisé. Cela lui a permis de partir avec une jolie enveloppe alors qu’il aurait dû démissionner. Autre affaire louche : les contrats entre le CCE et la société Jetco, en Corse.
– Pour la location d’un centre de vacances ?
– Effectivement, le CCE, depuis huit ans, a un contrat, que les auditeurs ont qualifié de léonin, avec cette société. Alors que la fréquentation du centre ne cesse de baisser, les sommes que nous payons sont assez extravagantes. Manifestement, il y a quelque chose qui ne colle pas.
– Ok. Et ensuite ?
– Ensuite vient le plus gros morceau. Il s’agit d’investissements qu’a réalisés le CCE dans les opérations dites de time-share.
− Traduction ?
− Time-share ? Temps partagé. Le CCE a acheté la jouissance de semaines dans différents complexes hôteliers. Nous y avons investi 20 millions d’euros. Certains de ces appartements sont à l’étranger, d’autres en France. D’après les auditeurs, la surfacturation est évidente.
– S’il y a eu surfacturation, ça ne devrait pas être trop difficile de l’établir. Cela dit, ce n’est pas parce qu’on achète trop cher qu’il y a forcément une magouille.
– Je suis d’accord mais ici on ne parle pas d’un frigidaire ou d’une babiole quelconque. Il s’agit d’achat d’appartements pour un montant, je le répète, de 20 millions d’euros et avec un taux de fréquentation qui atteint à peine trente pour cent. Concernant les appartements achetés en France, les auditeurs parlent d’une surfacturation de plus de 50 pour cent. Si la même chose s’est faite sur l’ensemble des sites, le chiffre est énorme.
– Je résume. D’après l’acte de votre avocat, vous avez porté plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de bien social. Il est question de Visit France. C’est une filiale d’Air France ?
– Visit France était une filiale d’Air Inter. Air France l’a reprise lors de la fusion Air France / Air Inter. Elle l’a remise à flot puis l’a cédée pour un franc symbolique à Monsieur Argentino, mentionné plus haut.
– Mais quel rôle joue la compagnie ? Je ne comprends pas.
– D’après nous, l’ex PDG, en bradant cette filiale, a renvoyé l’ascenseur, pour services rendus, au patron du syndicat des travailleurs libres, M. Napolèse, dont Argentino est le porte-flingue.
– Vous n’avez pas l’air de trop apprécier cet ancien Président ?
– Disons qu’il est d’une arrogance et d’une prétention assez insupportables. Et je n’aime pas beaucoup les gens qui retournent leur veste.
Boulineau voit mon étonnement, il précise :
– C’est le genre qui a été étiquetté PS tout un temps avant de passer UMP après une escale à l’UDF, vous voyez.
Je souris.
– Vous savez, continue Boulineau, il fait partie de ces petits bourgeois qui, à vingt ans, veulent faire la révolution et, à quarante, ont peur qu’elle se fasse.
– Bien. Monsieur Boulineau, nous allons retranscrire tout ça. Une fois qu’on aura terminé, je vous ferai relire le texte. Si vous êtes d’accord, si vous n’avez rien à ajouter ou à retrancher, vous le signerez et je commencerai officiellement mon enquête. Par ailleurs, je vous dis tout de suite, avant de commencer à taper, que j’irai sûrement au CCE. On aura besoin de photocopies d’un certain nombre de pièces. Mais je vous préviendrai. De votre côté, si vous avez de nouvelles informations à me donner, n’hésitez pas à le faire. Vous avez mon numéro de téléphone.
Trois quarts d’heure plus tard, l’audition de Bernard Boulineau est terminée. Je recommence le rituel. Les couloirs, l’ascenseur, l’accueil, je lui serre la main, je remonte vers mon bureau où le camarade Bati n’est pas encore arrivé. Je dois l’attendre pour faire le point.
Chapitre 5
Roissy CDG.
Le lendemain de son arrestation, il y avait plusieurs semaines déjà, lors d’un transfert, ou d’un déplacement accompagné aux toilettes, Vera ne se souvenait plus très bien des circonstances exactes si ce n’est qu’elle n’avait qu’un garde sur le dos, elle avait réussi à s’enfuir du ZAPI, cette prison qui ne disait pas son nom. Vera avait faussé compagnie à son maton ; elle s’était mise à courir comme une dingue, avait traversé un hall gigantesque, longé un « espace de recueillement », remonté un très long tapis roulant à contre-courant, bousculé une procession de passagers matinaux, des retraités en short et jupettes, renversé un chariot, provoqué une belle pagaille, puis débouché dans un dédale de galeries marchandes, pris un passage, au hasard, le premier qui se présentait, emprunté une porte à gauche, une autre à droite, dévalé un escalier, débouché sur une petite place, s’était retrouvée face à une vache rouge juchée sur une estrade, qu’elle avait contournée, effrayée, s’était engouffrée dans un étroit couloir, lovée dans une espèce de placard, voisinant un extincteur, avec l’idée de se cacher, adossée qu’elle était à un mur comme pour s’y fondre ; miracle, c’était un portillon ; il pivota et elle glissa, sans comprendre ce qui lui arrivait, dans un petit espace désert. Un triangle magique. La petite porte s’était déjà refermée sur elle et la Roumaine se retrouvait dans un minuscule oasis, de l’autre côté du miroir. Tout aussitôt, elle put voir, derrière la glace, le flic qui la pistait depuis le Zapi jaillir sur la placette... et fulminer ; il avait failli la pincer et elle s’était volatilisée, c’était pour lui tout à fait inconcevable. Peu après, des uniformes avaient fouillé les magasins du coin, les toilettes, le bar, en vain. Ils s’éloignèrent. Vera comprit qu’elle était sauvée. Elle fit de ce miraculeux cul-de-sac sa tanière. Au fil des jours, elle réalisa, après moult déductions, où elle avait échoué : au point de jonction, en sous sol, des aérogares 2A et 2B. C’était une assez large galerie qui passait sous le monumental enchevêtrement de routes et de bretelles de dégagement séparant les deux aéroports et sillonnées en permanence par des armées de voitures et de bus. Mais dans ce terrier, on n’entendait rigoureusement rien de la cohue extérieure. Le point de jonction était éclairé tout à la fois par les néons du plafond et les vitrines des commerces ; le sol de marbre blanc réfléchissait toute cette lumière. En son centre, une sorte d’estrade en béton, servant sans doute à masquer un appareillage technique, un système de ventilation peut-être. Il avait été aménagé en point culturel. Sur les quatre parois on déclinait le fable du bœuf et de la grenouille « qui voulait devenir aussi grosse que… » et sur l’estrade, les statues d’un bœuf rouge parsemé d’étoiles dorées et d’un crapaud de belle taille s’affrontaient. LES-FABLES-DE-LA-FONTAINE : Vera sourit en repensant à son prof de français, au lycée de Brasov, la crème des hommes… Dans ce passage très fréquenté, le flux des piétons tournait tout naturellement autour de cette petite mise en scène. On arrivait par un double escalier, dont l’un était mécanique, depuis l’aérogare 2A et on remontait, de l’autre côté, par les mêmes moyens, vers l’aérogare 2B . Ou vice versa. Ça ressemblait, toutes proportions gardées, à une petite place de village. Tout un pan du forum accueillait des agences de location de voitures, Hertz, Avis, Europcar. En face s’alignaient une série de boutiques, un petit Casino, un café-« petite restauration », une pharmacie, un local assistance avec une batterie de fauteuils roulants, une librairie Relay... C’est là, coincé entre les toilettes et le service des objets trouvés, que se dressait ce mur de glace, surmonté d’une plaque, probablement sans intention malicieuse, avec l’indication : « Impasse Christian Blanc ». Dans l’entrée du corridor des WC, en retrait, un placard inoccupé, en trompe-l’oeil, faisait fonction de porte, il suffisait de pousser un peu fort, un petit coup d’épaule, et on accédait à la cache. C’était aussi simple que ça, encore fallait-il y penser. Une évidence cachée. Un peu le syndrome de la lettre volée de la nouvelle d’Edgar Poe, sous les yeux de tout le monde donc de personne.
Chapitre 6
J’achève la lecture de l’audit. Bati est en face de moi ; je lui trouve un petit air rétro aujourd’hui. Il a changé de trois pièces, il est en blanc, ou plus exactement en blanc cassé. Il lâche parfois quelques onomatopées, on ne peut pas appeler ça des paroles. Comme moi, il parcourt des extraits des documents que nous a laissés Bernard Boulineau. La porte s’ouvre, le Capitaine Famoz passe la tête :
– Les amis, demain on a une perquis’. Il nous faut un coup de main.
Famoz est le responsable de notre groupe. A la BRDE cohabitent trois groupes : l’un est chargé des marchés publics, corruption et fausses factures ; un autre des marchés immobiliers ; le troisième de la fraude à la TVA intra-communautaire. Dans chaque groupe, on compte environ huit officiers de police judiciaire, en général dirigés par un Capitaine. Tous, nous dépendons du commissaire responsable de la brigade, Christian Hirsch. Quadra décidé, mince, volontiers souriant, le visage gracile, mobile, cheveux blancs coupés courts, il a un côté intello martial. Sur son bureau trône une boule, genre boule à neige, qui a cette particularité d’avoir été l’arme du premier crime qu’il élucida, le coup de boule fatal. Comme ses collègues des neuf autres brigades, il est sous les ordres du sous-directeur des affaires économiques et financières, lui-même rattaché, au 36 quai des Orfèvres, au Préfet de Police. Vous savez tout.
Les perquisitions se font généralement à deux, sauf cas plus délicats. On croit souvent, en France, qu’il y a besoin d’un mandat pour cette opération. C’est valable dans les séries télés américaines mais ici, c’est l’OPJ chargé de l’enquête qui décide de l’opportunité de la perquisition. Celle-ci peut démarrer dès 6 heures du matin. Je me tourne vers le Capitaine :
– Demain on a une audition !
Bati me regarde :
– Moi, me lever à cinq heures, c’est plus de mon âge. Va faire la perquis’ et je t’auditionne Hervé, le DRH du CCE.
– Vieillard, tu crois que tu t’en sortiras ?
Bati sourit :
– Donne-moi ma chance...
Je me tourne vers Famoz :
– Ok. Pour la perquise, c’est moi qui m’y colle
C’est dit. Je m’étire, et continue pour le bénéfice de Bati. J’en ai assez pour aujourd’hui. Demain sera un autre jour, surtout si je dois me lever à cinq heures. Je vais rentrer. J’ai promis à Hélène d’aller au cinéma ce soir.
Il me regarde goguenard
– Qu’est-ce que tu vas voir ? Blanche-Neige et les sept nains ?
– J’ai pas encore l’âge, Bati. Moi, on m’autorise simplement à mater du Luc Besson.
– Oh, si c’est du Besson, attention à l’overdose.
– Je sais, je sais Bati ; mais de temps en temps il faut prendre des risques.
Je vais pour me lever quand il reprend :
– Sérieusement, Matéo, la sécurité sociale ferait des économies si elle programmait des séances de cinéma plutôt que des somnifères.
Bati fait pas trop dans le genre intello ; en même temps, je ne suis pas loin d’avoir la même opinion. Mais je ne veux pas me fâcher avec Hélène. En descendant les escaliers, je prie le ciel qu’elle n’ait pas choisi ce genre de réalisateur. En fait, elle m’amène voir « Le Capitaine Alatriste », tiré d’un roman d’Arturo Perez-Reverte. Une espèce de trois mousquetaires à la sauce hispanique, film de cape et d’épée avec de l’amour, des trahisons, des duels, des tonnes de codes d’honneur et quand Viggo Mortensen embrasse sa dulcinée atteinte de syphilis, Hélène me serre le bras, je l’entends soupirer. Moi je ne pense qu’une chose : qu’est-ce que ça doit être bon d’exploser la tronche d’un roi.
Chapitre 7
Roissy CDG.
Vera était un petit gabarit ; les seins à peine marqués, le corps menu mais pas vraiment maigre. Coupe garçonne, deux ou trois mèches qui lui tombaient sur les sourcils et le reste des cheveux ras ; des oreilles minuscules, des yeux bridés, étroits, on aurait dit des meurtrières, un nez discret et une grande bouche avenante. Cette androgyne ne répondait pas vraiment aux canons roumains ; elle s’imaginait fruit d’un lointain croisement d’une fille de la steppe et d’un nomade oriental. La jeune femme n’avait plus quitté l’aéroport depuis qu’elle avait échappé aux flics. Où aurait-elle bien pu aller, d’ailleurs ? Se rendre à Paris ? Elle n’y connaissait personne, à part Trico. Il lui avait réservé un bout de trottoir et devait être furax à l’heure qu’il était. Retourner au pays ? Jouer de nouveau au guide en Transylvanie, vendre du vampire de pacotille à des touristes benêts ? Elle avait donné. De toute façon, elle n’avait plus de papiers, alors ça limitait les mouvements. Ici au moins, elle commençait à prendre ses marques. Même si elle se méfiait de tout le monde et s’attendait, à chaque carrefour, à retomber sur un flic, sur son mac ou sur l’autre sournois au bonnet marin de l’antre mécanique.
Roissy ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait connu. L’aérogare n’était ni une ville ni un parc d’attraction, ce n’était pas non plus un centre commercial ni une usine, c’était peut être un peu de tout ça en même temps. Lentement, précautionneusement, elle fit le tour du propriétaire. Elle repéra vite les deux grandes tribus qui prospéraient ici : il y avait d’un côté les touristes ainsi que les hommes d’affaires, gens plutôt pressés, souriants, surchargés ; et puis les autochtones, avec leurs tenues et leurs grigris. Comme dans une société divisée en castes, derrière les comptoirs, dans les couloirs, sur les pistes, les locaux affichaient des vêtements typés, selon leur affiliation, du chemisier immaculé au futal à bande fluo ; ils portaient toutes sortes d’uniformes. Il y avait bien sûr les « vrais » uniformes, si l’on peut dire, stricts, classiques, martiaux, des gens de la PAF, de la BAC, de la GTA , des gendarmes, des douaniers, sans parler des CRS. 1700 flics en permanence. 6000 caméras. Roissy avait parfois des allures de défilé de mode martiale, ça pouvait ressembler à une caserne en vadrouille. Puis venaient les légions des services de sécurité, à dominante bleu marine et blanc ; on oscillait là, pour les garçons et les filles, entre le raide des militaires et la décontraction des civils. Eux, c’était un peu la famille blaser, cravate et boucle d’oreille (pour hommes). Plus coloré, l’uniforme des gens des compagnies apportait une incontestable touche de fantaisie. Personnels navigants, hôtesses, stewards paradaient en petits groupes et en vert, en bleu, en gris, en rouge. Mais tous, du plus gradé au dernier des obscurs, comme les fidèles d’une même confrérie, tous affichaient la même marque d’appartenance à la grande famille aéroportuaire, le même signe distinctif, le même talisman de reconnaissance, le Graal de la plate-forme CDG : le badge sur la poitrine. Ce grigri était une sorte de petite carte d’identité plastifiée avec photo, nom, statut, et code personnalisé, un sésame qui pendouillait au bout d’un ruban passé autour du cou et vous cataloguait d’office dans la nomenclature du site. Vera voulut tout de suite en être. Elle aimait cette espèce d’aristocratie de Roissy et comprit que si elle voulait durer dans ce petit monde, elle devait en adopter les us.
Elle quitta vite sa tenue roumaine désuette pour revêtir un costume piqué sur un porte-cintres mobile ; l’objet, orphelin, devait venir du pressing et attendait près d’un ascenseur. Son responsable s’était éclipsé. Vera se servit. L’ensemble tombait pile poil, on aurait dit du sur-mesure, c’était l’uniforme type des agents des services propreté, chemisette bleu clair, pantalon bleu marine et veste de même couleur, molletonnée, sans manche. Puis elle récupéra, oublié sur un lavabo des toilettes de l’aérogare 3, un fameux badge CDG. Le portrait était assez ressemblant, si on ne chipotait pas trop ; le nom, Valérie Bourguignon-Ngyuen, était difficile à retenir, une franco-vietnamienne probablement, mais l’essentiel était de pouvoir exhiber, de manière ostentatoire, l’objet sur la poitrine. Par chance, personne, jusqu’à présent, ne lui avait demandé d’explications.
Chapitre 8
La perquisition avec Famoz finie, je retourne au bureau. Juste en face de l’immeuble de la BRDE, une main a tagué sur une palissade : « Ce n’est pas toujours l’exploitation de l’homme par l’homme. C’est parfois l’inverse ».
Bati est absent, il a griffonné sur un morceau de papier quelques lignes, il ne connaît pas le post it. Je retrouve son style, enfin, façon de parler :
« Matéo, voici le P.V. du DRH Jean-Pierre Hervé. Je l’ai mis en garde à vue. Il s’est déballonné : il a tortillé du cul pendant une heure pour chier droit. Tout est très clair. A tout de suite. »
Je prends le P.V. et j’ai rapidement la preuve de la première accusation de Bernard Boulineau. Effectivement, JP Hervé reconnaît qu’il a maquillé une démission en licenciement économique. Cela a coûté au CCE 250 000 euros. C’est pas une paille. La porte s’ouvre doucement, mon Bati arrive. Il est en noir, veste à col Tyrol, pantalon à devant plat, chemise jaune pétant. Il me serre la main et va s’asseoir :
– T’as lu ?
– Yes. C’est clair. Et maintenant …
Bati me coupe
– Ecoute d’abord, gamin. Ce que je ne t’ai pas encore dit, c’est que j’ai eu un coup de fil de Mlle la Juge Laurence Rivière.
– Pardon ?
– Oui le Juge Cros a été muté au pôle financier de la cour d’appel de Paris et le dossier dont tu t’occupes a été transmis à Mlle la Juge Laurence Rivière ! Elle vient de m’appeler pour savoir qui est en charge de l’affaire. Elle souhaite que tu la rappelles aussi rapidement que possible.
– C’est quoi cette histoire ?
– Disons, mon petit Matéo, que c’est une toute jeune juge, qui a l’air de vouloir mériter sa paye…
– Et qu’est-ce que tu lui as répondu ?
– Je lui ai appris que c’est l’illustre Lieutenant Matéo Montesinos, figure de la BRDE, qui suit ce dossier et que, dès son retour, il va se faire un devoir de la rappeler.
– Et bien là, tu te mets le doigt dans l’œil, mon ami Bati ; ce n’est certainement pas aujourd’hui que je vais le faire.
– Mais c’est pas fini, Matéo. Je t’ai aussi fixé un rendez-vous avec le sieur Argentino, demain matin, à neuf heures.
– C’est quoi c’te connerie ?
– Matéo, crois-moi. J’ai eu un coup de fil de ce type tout à l’heure, il puait la peur. Je la sentais à travers le téléphone. Il veut absolument te rencontrer. Il a « d’énormes choses à te dire » qu’il prétend. Donc demain, à neuf heures, tu as rendez-vous avec lui ; c’est à Saint Mandé, dans le 94, au Bistrot 41, au croisement de la rue du Maréchal Joffre et de la rue Lagny. Il a ajouté que c’était à côté de son travail et qu’il pourra se libérer.
Ce soir, j’ai promis à Hélène de m’occuper du repas. Je récupère ma voiture, direction place d’Aligre, les halles couvertes Beauvau. C’est horriblement cher mais de qualité. Je fais mon marché pour concocter un des plats que je réussis le mieux, MA blanquette de veau. Un bon kilo dans l’épaule ou dans un morceau qui ne soit ni trop gras ni trop sec. La blanquette, tout le monde croit connaître mais ma blanquette, elle, elle n’a rien à voir avec le plat du même nom qu’on trouve partout. Je ne supporte pas cette blanquette servie dans les restaurants de la capitale, qui dégouline de crème, de champignons de Paris et d’autres choses encore. Non, ma blanquette à moi, elle est toute simple. Je fais revenir la viande dans une cocotte en fonte avec de l’huile d’olive, bien évidemment. J’attends que le veau rende son eau, qu’il roussisse bien ; j’ajoute de l’ail et du persil hachés menus, puis trois cuillères de farine. Je mélange avec une cuillère en bois, important ça, la cuillère en bois, pour que le tout soit homogène. Et très rapidement, j’ajoute de l’eau chaude pour couvrir la viande. Je sale, je poivre, ça doit mijoter deux bonnes heures. Ensuite je laisse refroidir ; j’incorpore délicatement à la blanquette bien réduite un jaune d’oeuf. Bien entendu, cela nécessite également de râper un peu de citron.
Sur le chemin, je passe chez « l’Ami Gérard », à Ledru Rollin, pour acheter un Pouilly Fumé. Ou pourquoi pas un Santenay Clos de Malte de la Maison Jadot. De toute façon, je dois étonner Hélène.
Chapitre 9
Roissy CDG.
Déguisée en employée modèle, Vera visita toutes les aérogares du site ; elle avait rapidement fait son choix, manifesté sa préférence et n’en avait plus changé par la suite : c’était les bâtiments 2ABCD qui l’attiraient le plus volontiers. Elle connaissait bien le Terminal 1, l’ancêtre, dit « le camenbert » en raison probablement de sa forme ronde. Tous ses étages, celui de la navette, des départs, des arrivées, des parkings et même des bureaux ; elle avait repéré dans le détail chacune des portes – la numérotation montait jusqu’à 32 mais il y en avait 16 en réalité car ça ne fonctionnait qu’au nombre pair ; elle connaissait chaque hall d’enregistrement, chaque espace accueil, chaque ascenseur, chacun de ses couloirs aériens, passerelles translucides, avec tapis volant et coque de plexiglas, menant aux salles d’embarquement. Elle avait passé des heures au Terminal 3, hangar des low-cost, refuge de sociétés au nom roucoulant, Ulyssa, Atlantida, Marmara, usine d’embarquement avec son petit « Bar de l’escale » qui ressemblait à un décor de téléfilm, sa salle de projection justement, ses installations informatiques. Elle avait arpenté de long en large le Terminal 2, les halls ABCD, au charme classique, déjà un peu vieillot, la nouvelle liaison AC, celle des cossus, « des passagers au pouvoir d’achat XXL » comme disait la promo, les faux jumeaux 2E et 2F ( l’européen), des cathédrales dressées au dieu Avion, aux dômes sublimes, flanqués de nouveaux satellites bling-bling ; et même le 2G, perdu au milieu de nulle part et dédié aux vols régionaux. Vera avait circulé aussi dans les entre-deux, les zones intermédiaires, les points de passage, comme la gare et les jonctions avec le TGV et le RER, les navettes reliant les différents terminaux, petit train ou bus. Elle devinait, plus qu’elle ne connaissait, tout un monde collatéral, des dizaines de kilomètres de bitume conduisant aux deux doubles pistes, des centaines de halls, de hangars, d’ateliers où l’on stockait, on réparait, on nettoyait, on préparait à manger, on trafiquait peut-être.
Toujours bouffée d’angoisse à l’idée de se faire prendre, toujours sur le qui-vive, elle bougeait beaucoup, cherchait tout le temps. A force d’emprunter des passages interdits, de s’esquiver par des sorties de secours, de pousser les portes de service, elle était vite devenue une experte du Roissy d’en-dessous. Elle aimait explorer le monde souterrain de l’aéroport, avec ses hectares de parkings, ses kilomètres de tunnels, de ruelles et de contre-allées réservées aux dessertes, aux arrivages de colis, tous les déposes taxis, les accès VIP ; elle arpentait aisément des labyrinthes où même des agents de sécurité se paumaient parfois ; elle connaissait un nombre incalculable de recoins, d’interstices, de galeries techniques, de quais de livraisons, d’entreponts. Les entrailles de Roissy et ses fantômes, tout ce gruyère de canalisations, cet entrelacs de liaisons étaient devenus familiers à cette femme-taupe. Jusqu’à la découverte, l’autre jour, de la « mine », de son colis suspect et du visiteur étique. Le surlendemain de cette expédition, elle était tombée d’ailleurs sur un articulet du journal « Le Parisien » qui faisait état de la trouvaille, par des bagagistes, d’un cadavre transitant au milieu des paquetages. Ils avaient pu récupérer le colis juste avant qu’il n’arrive en salle de réception. On imagine, disait le papier, la sensation qu’aurait pu provoquer la dépouille en chutant aux pieds des passagers, sur le tapis des valises du vol de Vienne de 21h10. Il s’agissait d’un certain Gérard Riquet, ancien steward d’Air France, qui pantouflait – ou aurait pantouflé, l’enquête devait le préciser - dans une agence de voyage privée, Visit France.
Chapitre 10
Au réveil, je suis plutôt rassuré de me retrouver collé à ma belle Hélène. J’ai l’impression d’avoir cauchemardé toute la nuit : j’étais au fourneau et quand je soulevais le couvercle de ma cocotte, je voyais la tête réduite et grimaçante de Bati qui me regardait en criant, en bêlant plutôt : il pue la peur, il pue la peur... Est-ce que je ferais une allergie au Sauvignon ? Dehors, le temps est lumineux, « a glorious day » comme disent les Anglais. Pour aller à mon rendez-vous, je prends le métro, ligne 1, arrêt à la station Saint Mandé - Porte de Vincennes. Ce coin de Paris ne m’est pas inconnu. Le Château de Vincennes, le Bois sont des endroits très agréables que je connais grâce à Hélène. Mais si Saint-Mandé et Vincennes sont hors de la ceinture, les habitants votent dans le XIIème arrondissement, à l’égal de ceux de la Gare de Lyon. Encore une bizarrerie.
L’avenue Joffre débute à la sortie du métro et Hélène m’amène régulièrement dans un restaurant chinois qui a la faveur de certains guides.
Je longe l’avenue et m’arrête à côté du cimetière de Saint Mandé. Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo, et sa fille Claire, qu’elle avait eue d’une première liaison, y sont enterrées, dit une plaque. C’est fou ce que l’on peut apprendre sur l’histoire de France en parcourant ses rues. Mitterrand, son jardin de l’Observatoire, sa grande bibliothèque ; Chirac, son Hôtel de ville aux emplois divers, son musée des arts premiers ; Sarkozy, sa rue Merkel et son Fouquet’s.
Le Bistrot 41 se situe bien au croisement indiqué par Bati. J’y pénètre avec un bon quart d’heure de retard, volontairement, comme me l’a appris mon Corse préféré. Lorsqu’un témoin vous attend, il faut le laisser mariner, surtout un témoin du genre d’Argentino.
Pas trop difficile de le reconnaître : il est neuf heures et quart, le bar restaurant est vide, Argentino est assis seul à la dernière table contre un mur. Je commande un café en passant et je m’assois en face du bonhomme. J’attends mon café, en le regardant dans les yeux. Il se lance :
– Monsieur Montesinos ?
– Oui
Jusque là, un dialogue très sobre. Le café arrive. Toujours en le fixant, j’en bois une gorgée. Je repose ma tasse, je laisse tomber :
– Je vous écoute
Il transpire. La peur se lit sur son visage. Une tête ronde, des cheveux filasses plutôt rares, une moustache ridicule avec des poils fins et clairsemés, des yeux ronds. Il fait penser à ces têtes qu’on dessine étant enfant : 0 + 0 = la tête à toto. Mais je sens chez lui cette autorité sèche qu’aiment exercer certains lorsqu’ils sont à des postes de responsabilité. Il doit être terrible avec ses subordonnés. Une tête à claques.
D’une voix fluette il susurre :
– Surtout ne le prenez pas mal mais j’aimerais voir votre carte professionnelle.
– Vous ne croyez pas que vous en faites trop, Monsieur Argentino ?
– S’il vous plait.
En soupirant, je prends mon portefeuille et sort le sésame. Il semble soulagé. J’aurais pu avoir une fausse carte, peu importe, les trois barrettes tricolores l’ont rassuré.
– Monsieur Montesinos, j’ai besoin de votre protection.
– Pourquoi ?
– Je sens que je suis en danger
– Appelez la police.
– Mais vous êtes de la police.
– Pas de celle qui protège les honnêtes citoyens.
– Monsieur Montesinos, je suis en danger.
– Monsieur Argentino, je commence déjà à regretter d’être venu. Dites moi ce que vous avez à me dire et je verrai ensuite ce que je dois faire.
Il déglutit et déroule très rapidement son argumentaire.
– Ce que vous a dit Hervé est vrai. Mon licenciement a été maquillé, pour que je puisse partir avec deux cent mille euros. C’était la « prime » que j’ai eue pour reprendre Visit France.
Je l’interromps.
– C’est Napolèse qui vous a demandé de le faire ?
– Oui, oui, c’est Napolèse. Je l’ai fait sur ordre de Napolèse. Je l’ai fait pour Napolèse !
– Et alors ?
– Mais ce n’est qu’un détail. J’ai été, pour le Comité Central d’Entreprise, celui qui a acheté tous les appartements en time-share.
– Et alors ?
– Ce que ne dit pas le Cabinet Secafi-Alpha, qui a fait l’audit, c’est que sur ces appartements, les surfacturations sont énormes. Soixante-dix pour cent en moyenne.
– Bon, et alors ?
Il semble étonné.
– Mais je suis en train de vous dire que tout a été surfacturé.
– Monsieur Argentino, vous ne m’apprenez rien. Votre licenciement déguisé, c’est clair. Les surfacturations ? Une simple étude de marché me les aurait montrées. Il suffit de constater ce que le CCE a payé, de comparer au prix moyen et d’en déduire ce qu’il faut.
Il soupire :
– Mais, je vous parle de sommes énormes ! Enormes ! Nous avons acheté pour près de 20 millions d’euros.
– La somme ne change rien au fait que les surfacturations seront facilement prouvées. Au fait, combien avez vous touché ? Car vous avez touché une commission ?
Il baisse les yeux :
– Oui.
– Combien ?
– Deux cent mille euros.
– C’est votre chiffre fétiche, on dirait ! Vous êtes un habitué des commissions de deux cent mille euros, dites donc. Jolie somme !
Il se tait.
– Mais encore, Monsieur Argentino ?
Il hésite puis ajoute :
-Cet argent, il était pas pour Napolèse.
– C’est à dire ?
– Je... je peux pas vous le dire, pas maintenant… parce que je le sais pas. Sinon je vous le dirais...
Un silence s’installe. Il reprend :
− Cet argent a servi....
Il s’arrête. J’attends. Ma tasse est vide depuis longtemps mais j’ai envie de reprendre un café seul, sans son regard de batracien. Finalement, je tente une question pour voir comment il va réagir.
– Quand vous avez signé le contrat avec Visit France, vous l’avez signé avec Christian Gry ?
– Non.
– Avec qui ?
– Un membre de la Direction Générale. Je me rappelle plus. Dupont ? Non, Durant ! Je me rappelle même plus sa tête
– Vous n’avez jamais rencontré Christian Gry ?
– Non.
– Lors de la signature, Napolèse était présent ?
– Non.
– Bon. Et d’après vous, quel intérêt avait Napolèse à vous envoyer à Visit France ?
– J’étais son poisson pilote. Son émissaire. Il ne pouvait pas faire ça directement, lui. Il devait se planquer. N’oubliez pas qu’il était, à ce moment là, le patron du syndicat STL. Même ses troupes, qui lui passaient beaucoup de choses, n’auraient pas accepté ça. Mais après avoir quitté Air France, il est venu me voir, dès son premier jour de « liberté ». Il m’avait envoyé là pour préparer son arrivée à lui. Et il n’a pas perdu de temps pour me le dire.
– D’accord. Bon, Monsieur Argentino, nous sommes jeudi. Lundi prochain, venez me voir, à 9 heures, à la BRDE, 122 rue du Château des rentiers, dans le 13eme. Et réfléchissez, car je suis sûr que vous pouvez d’ici là vous rappeler d’autres choses. Après votre déposition, je verrai ce que je ferai ou ce que je pourrai faire.
– Non, non, Monsieur Montesinos, je vous en supplie, protégez moi, maintenant !
– Monsieur Argentino, je vous le redis : lundi, 9h00, OK ? Et je verrai ce que je pourrai faire.
Je me lève, le laissant à ses pensées noires. J’ai du mal à le croire vraiment en danger. En même temps, quelque chose me dit que des intérêts autres que ceux de Napolèse et de Christian Gry sont en jeu. En sortant, je traverse la rue vers le restaurant bar Le Valmy. Sur la porte d’entrée est affichée une pub : « Le café + un croissant au bar jusqu’à dix heures : un euro ». J’ai envie de prendre une photo de cette promo et de l’amener à Bastille, où on vous sert des cafés à trois euros sans rougir.
Chapitre 11
Roissy CDG
Vera continuait d’arpenter à longueur de journée son empire roisséen. Comme une guerrière, l’évadée de la « zone », en permanence sur ses gardes, reniflait à distance le flic ou l’agent de sécurité trop curieux. Elle savait comment se fondre dans la gesticulation sécuritaire ambiante. Mais c’était dans son terrier, derrière le miroir, et là uniquement, qu’elle se sentait complètement apaisée. Dehors, elle avait toujours un peu peur des flics, des violeurs, des flics violeurs.
Elle avait vite identifié des zombies comme elle. Elle ne les cherchait pas, surtout pas. Quand ils se croisaient, ils se reconnaissaient et s’évitaient. Elle savait que l’un d’eux, par exemple, trouvait régulièrement refuge dans un placard à extincteurs, tout près de son impasse. Elle était probablement la seule nana du clan, se disait-elle, et s’imaginait que les autres étaient des mecs bagarreurs, violents, poivrots, pas vraiment son genre ; la moitié de ces passagers de l’ombre pouvaient aussi être des indics.
Chatte sauvage, toujours en mouvement, agitée perpétuelle, elle avait cependant un point faible : les livres. Elle ralentissait toujours devant les kiosques à journaux et les librairies. Vera pouvait y passer des heures à feuilleter, fureter, lire, décompresser. C’était un endroit dont les uniformes -et les macs- s’approchaient rarement, mis à part les clients de L’Équipe. Il y avait le centre Emmaüs : elle s’y était rendue deux fois, à peine, pour les douches ; elle avait trop peur d’y rencontrer des émissaires du Zapi. Solitaire de nature, elle fréquentait peu. Ou des ombrageux comme elle. Un vieux chinois mutique, qui tenait l’accueil d’un hôtel-restaurant, du côté de la gare RER, l’invitait parfois à partager son déjeuner ; le reste du temps, elle chapardait des provisions, un peu partout. C’est fou comme les gens pouvaient laisser traîner leurs affaires dans un aéroport. Avec son costume d’employé passe-partout, elle faisait mine de ranger les chaises, de vider les poubelles, en profitait pour se servir dans les pochons entrebaillés, les sacs plastiques sans surveillance. Elle tombait régulièrement sur les agents d’entretien, les vrais. Curieusement, ils – plus souvent elles – ne lui avaient jamais cherché chicane. Ils coexistaient, ils s’ignoraient plutôt. Suffisait de pas leur compliquer la vie en évitant de saloper le décor, par exemple. Et puis ceux qui s’approchaient de Vera devaient vite sentir que cette fille était une menace ambulante qu’il valait mieux éviter. Ainsi, l’essentiel de ses journées hors de son « studio », elle les passait à marcher. D’un bon train, elle arpentait les halls, elle cheminait le long des corridors, elle passait d’un terminal à l’autre et l’on pouvait ici tourner en rond et croiser sans cesse de nouveaux visages. Ça lui venait de loin, ce goût de la marche, ce curieux exercice où chaque pas ressemblait un peu au précédent ou au suivant et pourtant, tout changeait tout le temps.
Les librairies mises à part, le seul lieu où elle s’accordait volontiers des pauses, où sa vigilance retombait, où elle se laissait – un peu – aller, c’étaient les halls d’arrivée. Celui du terminal 1 notamment. Ces espaces de retrouvailles étaient de vrais bisoulands. Tout le monde y embrassait tout le monde tout le temps. Le spectacle était permanent. Et le film recommençait invariablement. Jeunes et vieux, grands et petits, gros, moches ou bellâtres, tous se bécotaient, se suçaient la pomme sans vergogne. Et Vera adorait voir ça, c’était son côté fleur bleue ; elle contemplait sans fin le public constamment renouvelé qui s’échangeait des bises, des poutous, des suçons. Elle trouvait ce coin absolument unique, magique, se disait que les êtres qui passaient là étaient peut-être disponibles pour toute embrassade, elle s’imaginait tendre les lèvres vers les arrivants ou les poireautants et participer à cette grande scène de « french kiss ». Un jour qu’elle était absorbée par ses rêveries, justement, elle se fit un ami, un vrai : Mehdi Tlisi. Leur rencontre s’était passée simplement. Ce matin-là, entre cent couples furtivement enlacés, elle avait repéré une chaise roulante à l’abandon. Ce n’était pas un objet estampillé ADP, Aéroports de Paris, comme la plupart des véhicules de ce genre qui pouvaient dépanner des partants ou des arrivants. C’est à dire que l’objet avait dû appartenir à quelqu’un qui l’avait, sans doute volontairement, laissé là. Etonnant. Elle contemplait l’appareil, se demandant comment on pouvait l’« oublier » lorsqu’une voix, dans son dos, lui dit, cordialement : « Prenez place, s’il vous plaît ! » Farouche, elle aurait du normalement s’enfuir. Mais elle était restée, un peu anesthésiée par l’atmosphère de convivialité maximum qui régnait ici. Elle attendit la suite. L’autre avait insisté ; le temps de se retourner, elle découvrit un grand mec, une vraie carrure, des biceps partout, enfin d’après ce qu’on pouvait deviner, le genre à soulever de la fonte dès qu’il avait cinq minutes. En même temps le personnage était plutôt coquet, chemise blanche à manches courtes, cravate orange, pantalons bleu noir moulants. Tout en haut de cette masse, il y avait une tête affable, le teint mat, les cheveux longs, noirs, rassemblés en katogan et surtout, sous des sourcils broussailleux, un regard très clair, gris bleu. L’effet était saisissant : ces yeux étaient un puits, les regarder donnait le vertige. Ce zèbre l’agaçait. « Prenez place ! » Du geste, il indiquait le siège. Elle haussa les épaules puis… s’affala sur la chaise ; illico il la propulsa dans le couloir, surfa entre les duos éphémères qui s’étreignaient et ils firent ainsi un tour complet du « camembert ». Penché sur son épaule, le cornac lui demanda si elle aimait les histoires ; sans attendre la réponse, il raconta :
« Il était une fois un passager, un infirme sur sa chaise, poussé par une hôtesse, qui franchit la porte Arrivée de Roissy 1. Là, le malade, qui avait juste une petite mallette sur ses genoux, fit timidement signe à l’employée de le laisser, il pouvait désormais se débrouiller, merci de l’aide, merci, vraiment, tout irait bien maintenant. L’hôtesse s’éclipsa, non sans hésitation ; l’homme, seul, sans se soucier le moins du monde du public, très dense pourtant dans le hall à ce moment là, se redressa, sans difficulté apparente ; d’une main, il tenait sa petite valise, de l’autre il défroissa son costume, d’un geste désinvolte, et abandonna son engin, en plein passage. Il n’était pas attendu, il le savait, et traversa la salle, bien assuré sur ses deux jambes, nullement troublé, puis il disparut vers la station de taxis. »
Vera se retourna, ouvrant de grands yeux, manière de demander si c’était une histoire vraie. Le garçon avait deviné et reprit :
« C’est vrai, tout ce qu’il y a de plus vrai, la chose s’est déroulée sous mes yeux il n’y a pas dix minutes, j’en suis resté baba !
« Un miracle ? Osa-t-elle. Elle réalisait que c’était le premier mot qu’elle prononçait depuis...bien longtemps. Et ça la mit de bonne humeur.
« Un miracle ? Je ne sais pas. Moi je pense plutôt ceci : ce gars a du quitter un pays hostile, ou détesté, ou bureaucratique, en prétextant une maladie, une infirmité, histoire d’obtenir plus vite un visa par exemple ; mais, parfaitement valide, il s’est libéré du fauteuil dès qu’il a pu.
Un silence. Et ils passèrent aux présentations :
« Vera !
« Mehdi !
Mehdi travaillait au P.I.F.
– Le PIF ?
− Poste d’Inspection Filtrage. Je suis agent de la sureté aéroportuaire. Au moment de l’embarquement, je scrute. Les corps, les bagages. 120 clients à l’heure en moyenne. Deux à la minute.
− Ça fait beaucoup !
− Beaucoup, oui ; et beaucoup plus encore l’été, avec les vacances. Ce job me stresse, tout le temps. J’arrête pas de me dire : si, au contrôle, je loupe un truc, un objet, un couteau, si je fais pas attention, alors il va y avoir un bonhomme dangereux qui s’installera dans l’avion et la vie des passagers sera en jeu. Et moi, je vais me faire virer !
Je pense à ça du matin au soir et si je l’oublie, on se charge de me le rappeler ! Pif, puisque c’est ainsi que la jeune femme allait désormais le surnommer, avait envie de parler, ça tombait bien, elle était toute disposée à l’écouter. Il raconta comment, chaque jour, il rejoignait le hall d’embarquement qui était inscrit sur son planning. Là, le chef lui précisait à quel portique il devait se placer. Plusieurs fois dans la journée, il pouvait changer de portique et de hall. Ça dépendait. S’il y avait un manque de personnel, ou un coup de chauffe, ou une arrivée imprévue.
− A chaque portique, j’ai plusieurs positions possibles ; ou j’accueille les voyageurs ; ou, assis, je lis sur l’écran la radioscopie du bagage qui passe sur le tapis ; ou bien je gère le passage sous le portique et je procède à « la palpation sur personne » comme on dit.
– Vous êtes palpeur ?
– Entre autres. Les hommes seulement, c’est le règlement.
– C’est dommage...
– Je parlais au plan professionnel.
Pif, le géant, semblait gêné, la petite Vera aussi, même si elle s’amusait de son embarras.
– Si ça sonne, je pelote, ajouta-t-il, histoire de parler. Je veux dire : si le portique de sécurité sonne, si ses loupiotes rouges clignotent, je pelote le passager. Remarquez, il y a aussi les « aléatoires », des passagers pris au hasard, qui passent pourtant sans encombre le portique mais à qui on impose une fouille un peu plus méthodique qu’aux autres clients.
Au portique, Pif pouvait aussi fouiller les bagages quand l’opérateur écran avait le moindre doute sur la présence de métal ou de liquide.
Mehdi avait été recruté en novembre 2001, quelques semaines après les attentats du World Trade Center, « une époque de parano maximum ». Il faut dire qu’un mois après l’effondrement des tours, en décembre, un Britannique, Richard Reid, avait tenté d’embarquer, ici, à Roissy, avec une bombe dans ses baskets. Pif n’était pas de service ce jour-là mais ses collègues présents ont ensuite été salement cuisinés par les flics.
– Heureusement, on n’avait rien à se reprocher. Ceci dit, j’en ai fait des cauchemars, pendant des mois. Un rêve noir où je passais et je repassais sous des portiques qui couinaient ; cinq, dix flics se jetaient aussitôt sur moi, me plaquaient, sortaient de mes poches toute la panoplie du parfait terroriste. J’avais plus rien à dire, mon compte était bon... Mais je vous saoule avec mes histoires ?
– Pas du tout !
– C’est un drôle de boulot, vraiment. On est nous mêmes tout le temps contrôlé, faut pas manger, faut pas boire, faut pas bavarder trop mais faut pas être désagréable, faut pas se montrer trop cool mais faut être aimable, faut pas s’asseoir, faut pas, faut pas... Nos chefs, et les flics, nous surveillent comme des gamins, ils nous testent, se déguisent parfois en touristes, avec des objets interdits dans les bagages, pour voir si on va le remarquer ou si on va être pris en faute. Et si c’est le cas, faut se retaper tout le cycle de formation. Un sacré job, je vous jure. Après huit heures, on est lessivé. Huit heures debout, la foule, les mômes qui braillent, les sonneries de portique, tout ça dans un espace réduit, sous les néons, la galère ! C’est simple, depuis que je fais ce job, je suis devenu allergique à la foule, je supporte plus les files d’attente, n’importe où ; on ne me fera plus rentrer dans une grande surface, un centre commercial, le populo me dégoûte, vous imaginez ?!
Le pire, semble-t-il, c’était le manque de respect. Les vacanciers étaient détendus, la tête déjà ailleurs ; mais les hommes d’affaires, les commerciaux, les bourges en général, prenaient les « Pifs »pour des emmerdeurs ; ces employés se faisaient injurier en permanence et il leur était interdit de répondre, il fallait encaisser.
– On fait un travail de flic mais on n’a pas leur statut, alors on nous prend pas au sérieux, et tout ça pour des salaires riquiqui.
Pif soupira :
– Bism Allah al-Rahman al-Rahim.
– C’est quoi, ça, s’étonna la Roumaine ?
− Un verset du coran.
− Vous êtes islamiste ?
− Non, pas islamiste, sourit le jeune homme, et à peine musulman. En fait je n’ai rien de religieux, j’aime bien la musique des mots, c’est tout, ça me calme.
Puis il reparla de son métier. Il était toujours de l’équipe du soir, il embauchait à midi, débauchait à 23 heures. Résultat : il finissait tard, il mangeait tard, se couchait tard, se levait tard. En gros, c’était le petit dej à midi et le déjeuner à 16 heures, voire 19 heures.
-Des journées de dingue ! Mais bon, j’me laisse pas faire ; je suis à la cégette...
« La cégette ? » Késaco ? Vera connaissait pas. Dans son glossaire perso, elle avait retenu des sons proches, des mots ordinaires, parfois des mots d’argot, cagette, lingette, minijet, pépettes, ou perpette, mais « cégette » n’y figurait pas ? Qu’est-ce que ça pouvait bien représenter ? Il avait dit ça sur un ton enjoué, un brin fiéreux aussi ; elle pensa, de manière fugace, à un sport de combat, un art martial ; il aurait pu dire « ...j’me laisse pas faire, je fais du karaté », ou « je fais du kung fu ». Peut-être avait-il dit aussi « alacégette » en un seul mot ? Etre « alacégette » ? Mais ça ne l’avançait guère. Il y avait finalement pas mal de mots qui étaient abscons, mais elle n’osait pas trop interroger le garçon, de peur de le décourager, ou de passer pour une débile. Fallait qu’elle se fasse une liste de mots à décrypter : galère, bourges, aléatoire, cégette, àlacégette...
Pif semblait déborder d’énergie et Vera, qui avait toujours du mal à terminer ses phrases, qui était toujours plutôt apeurée par le monde, jalousa presque son entrain. Il était en train de la retourner. Au figuré, bien sûr.
Chapitre 12
Ligne 1, station Saint Mandé, direction La Défense. Changement à Gare de Lyon, pour la ligne 14, vers la station Olympiades ; elle me met à 150 mètres du boulot. Je n’aurais jamais imaginé, quand je débarquais quatre ans auparavant, être aussi à l’aise dans les couloirs du métropolitain et les connexions avec le RER. Les premiers temps à Paris avaient été difficiles. Je ne pouvais pas sortir sans une photocopie du plan du métro et je passais de longues minutes sur le quai de chaque station avant de m’engouffrer dans une rame. Malgré toutes mes précautions, parfois, je me trompais. J’admirais cette foule qui circulait sans le moindre doute ; comme un vol d’oiseaux migrateurs, elle savait parfaitement où elle allait, sans carte, sans GPS, alors que moi, j’étais ballotté entre colère et résignation. Et progressivement, insidieusement oserais-je dire, je me suis habitué à cette circulation et je suis devenu moi aussi un de ces zombies déambulant sans voir et ne s’arrêtant qu’à destination. Je me suis rendu compte que chaque ligne avait sa particularité. Les rames de la ligne 8, Balard – Créteil, offrent, à chaque bout de wagon, un espace réduit en forme de U, comme un petit salon où l’on cause. La ligne 1 est ma préférée ; elle traverse Paris du château de Vincennes à la Défense en un raccourci de l’histoire de France BASTILLE-LOUVRE-TUILERIES-CONCORDE. La ligne 6 semble à tout moment vouloir se casser. L’horreur, c’est la ligne 13 aux heures de pointe. Au début, j’hésitais à rentrer dans les wagons, il m’arrivait d’attendre plusieurs rames parce que je ne voulais pas me faire bousculer, je ne pouvais pas me glisser au milieu de cette masse compacte. Et parfois, j’étais absolument émerveillé du spectacle qui s’offrait : apercevoir par exemple un bras émerger au-dessus des têtes et tenant fermement un livre comme un étendard au milieu d’une bataille. Que quelqu’un, dans ce magma, puisse lire relevait de l’exploit. Je dois même dire qu’aujourd’hui, je trouve une certaine beauté au métro parisien. Je ne le dirai pas à mes amis marseillais, ils croiraient que je suis complètement fada.
Je ne sais pas quel sociologue a dit que l’homme était une somme d’habitudes mais c’est la réalité et seuls les débuts sont difficiles. Il y a un code à connaître, ou plusieurs codes. Une de mes premières missions avait eu lieu au nord-est de Paris, à Bondy ou à Gonesse. En revenant par l’autoroute A3, j’ai vu un panneau indiquant « BP – 35 mn ». Plus loin, un autre précisait : « BP – 25 mn ». J’ai enregistré. Quelques temps plus tard, sur une autre autoroute de la région, les mêmes panneaux : « BP – 45 mn ». « BP - 30 mn ». Arrivé au bureau, je posai la question à mon voisin :
– Dis-moi Bati, c’est super, les autoroutes ici. On t’indique la distance restante pour la prochaine station BP. Mais pourquoi uniquement BP ? Pourquoi pas Total ou Esso ?
Il me regarda et éclata de rire. Je crois bien que c’est une des rares fois où je l’ai vu s’esclaffer de cette façon. Il pleurait, il tapait sur la table, il s’étouffait. Et cela dura. Je le regardai, vexé. J’arrivai à dire :
– Et alors ? C’est rigolo ce que j’ai dit, Bati ?
Il s’essuya difficilement les larmes, arriva à déglutir et lança :
– Tu es vraiment un paysan ! Même dans mes montagnes corses les plus reculées, le plus bourricot n’aurait jamais posé cette question.
– Mais encore ?
– BP signifie « Boulevard Périphérique », banane !
Et il repartit d’un rire fracassant.
Je dois avouer, après quatre ans d’exil, que sans trahir mon amour pour Marseille, j’aime de plus en plus Paris…
Au bureau, Bati – il a remis son costar denim - fume un de ses cigarillos qu’il est le seul à apprécier. Il sait que j’ai vu Argentino et me lance :
– Et alors ?
– Rien de nouveau. Effectivement, il a peur, notre Argentino. Je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, ses magouilles, ça commence à faire du chiffre. Vingt millions d’euros, rien que pour le « time share », ce n’est pas rien. Mais c’est quant même pas l’affaire du siècle… Je comprends pas bien ce lascar.
– Attends, tu connais pas la dernière ?
– Je t’écoute.
– Riquet, ça te dit quelque chose ?
– Il y a un Riquet qui figure au dossier. Et alors ?
– Gérard Riquet, en effet. Hé bien, il est refroidi, notre Riquet-du-dossier
– Quand ? Comment ?
– C’est le chef qui a noté ça ce matin sur la main courante. L’info a un peu traîné en route mais c’est bien notre homme. Mauvaise chute ? Ou dézingué ? Faut voir. Et tu devineras jamais où on l’a retrouvé… A Roissy ! Rayon bagages. Côté arrivée.
J’encaisse.
Si Argentino était au courant du destin de Riquet, je comprends mieux son agitation. Je choisis de ne pas faire de commentaires. Déjà que je passe pour un con, évitons de passer pour un con bavard. J’enchaîne :
– Argentino sera là lundi. Je l’ai convoqué. Rendez-vous ici à 9 heures.
– Putain, lundi, j’ai prévu d’aller au CCE d’Air France. J’ai eu le Directeur Financier. Il va nous préparer tous les documents. On va pouvoir ramener ce qu’il nous faut pour démarrer
– Ecoute Bati, vas-y avec Alain ou Miguel. Il faut quand même que j’auditionne l’autre pingouin et ça se fera lundi.
– Et puisque tu m’as contrarié, le déjeuner est pour toi.
Pour marquer le coup, on descend déjeuner chez Trassoudaine, place Nationale, à une centaine de mètres de la brigade. « Un bon restaurant ? La cuisine des familles » dit la carte. Déjà le nom est un programme. « Chez Trassoudaine » ! ça sent son terroir, ça appelle à la rime, Trassoudaine / bedaine, même combat ? Un nom trompeur en même temps, le « soudaine » de la fin, ça fait subit, brutal, rapide. Rien de tout ça ici. Au contraire, chez Trassoudaine, on prend son temps, au calme, on déguste, on apprécie. C’est boiserie, nappes, petits rideaux et compagnie, on ne dirait pas qu’on est dans le XIIIe mais à la campagne ou pas loin. Le lieu lui même est une belle incongruité, osons le mot. C’est un immeuble trapu, biscornu, une météorite posée au milieu des tours du quartier chinois, un vaisseau échoué, une bâtisse vaguement romane et récente cependant. Il y a là chien, chat, oiseau, un petit côté Arche de Noé, une arche qui échoua, comme chacun sait, au sommet du mont Ararat. Suivez mon regard : Ararat se trouve en Arménie, enfin presque. Disons que d’Arménie, on ne voit que lui. L’Arménie, justement, on y est un peu « Chez Trassoudaine » : la mère venait de là-bas, le père lui était correzien. Ça donna une cuisine mixte, un panachée entre l’aligot et la soupe au yaourt. Aujourd’hui opèrent les deux fils, Arakel et Haïgo. « Le père, il était finalement plus arménien qu’elle ! » dit Arakel.
Il faut traverser une verrière et accéder, par une porte étroite, à deux salons légèrement décalés, une quinzaine de tables. On s’installe et on attaque par un Mas de Daumas Gassac, un côteau du Languedoc, petite mise en bouche, histoire d’attendre les rognons au cognac avec pommes de terre sautées à la graisse d’oie. Sur les murs, des assiettes peintes, des livres, des vases, des bibelots incertains, des bougeoirs, des matriochkas et bien sûr l’inévitable reproduction de l’Ararat. Bati, qui a des lettres, rappelle cette vieille blague du temps de l’Union Soviétique. Un jour, Nikita Khrouchtchev recevait une délégation turque ; celle-ci regretta officiellement que sur le drapeau de l’Arménie soviétique figure notamment le mont Ararat, qui se trouvait pourtant, c’était notoire, en territoire turc. « Mais vous, répliqua le patron du Kremlin, vous avez bien la lune sur votre drapeau ! Alors... »
Au dessert, clafoutis maison, maxi portion, vraies cerises et raisins d’origine garantis. Pour le coup, clafoutis rime avec nostalgie.
A la table voisine se sont installés le commissaire Hirsh et son fiscaliste, Michel Delpech, un inspecteur des impôts détaché de Bercy pour traquer le malfrat, via sa déclaration fiscale. Entre autres. Vingt ans de maison, vingt ans de fréquentations régulières de Trassoudaine également. Ça crée des liens, de père en fils. « C’est pas vraiment la cantine mais on y est chez nous », dit Delpech. De fait, il y a ici une forte concentration de poulets au mètre carré.
Entre tables, on parle un peu métier. Hirsch fait part de l’étonnement d’un prévenu trahi par ses textos. Plus exactement, le partenaire de ce dernier, un entrepreneur lillois, avait bien pensé à effacer ses réponses à l’inculpé (« messages envoyés ») mais pas les questions posées par l’accusé (« messages reçus »). « Et même s’il avait tout écrasé, des logiciels sont fournis par les fabricants de smartphones pour restaurer les données, notamment le journal des appels. Un blackberry perd jamais sa mémoire ». Paraît que la gendarmerie technique et scientifique, à Rosny-sous-Bois, serait championne toute catégorie pour faire parler les composants détruits des puces ou cartes SIM des appareils.
Le fiscaliste rebondit sur une affaire de tueurs néonazis en Allemagne. Depuis une dizaine d’années, un gang d’extrême droite aurait tué au moins une dizaine de personnes. Neuf immigrés turcs et un flic allemand, en toute impunité. Notamment parce que la police était partie sur une fausse piste. Elle suivait la trace ADN d’une femme qu’on retrouvait dans une série de meurtres. Jusqu’à ce qu’on réalise que cette empreinte génétique était celle d’une employée de l’entreprise d’emballage des coton-tige utilisés pour les prélèvements d’ADN.
Le nom de Riquet vient dans la discussion ; j’apprends qu’il présentait une mauvaise plaie dans l’oreille, genre coup de poinçon. Fatal. Une autre bouteille de Daumas Gassac parait nécessaire. On parle polar. Hirsch dit le plus grand bien de « Seul le silence » de Roger Jon Ellory, un Anglais ; le fiscaliste, lui, aime bien Patrick Pécherot et son « Boulevard des Branques ».
De retour au bureau, Bati me rappelle à l’ordre :
– Matéo, n’oublie pas d’appeler la juge.
– Putain, je l’avais oubliée, celle-là.
Je tombe sur une greffière qui, comme beaucoup de ses collègues, est mal lunée. Après m’avoir fait attendre le temps nécessaire, elle daigne me passer « Madame le Juge ».
– Merci de me rappeler. Comme je l’ai dit à votre collègue, je suis chargée du dossier Air France après le départ de Monsieur Cros. Je vais faire un point avec vous.
– Ecoutez, ça va être très rapide. Nous démarrons à peine. Ça n’a pas l’air d’être une affaire particulièrement compliquée. Tous les éléments sont réunis pour qu’on puisse prouver des surfacturations au détriment du CCE d’Air France.
Sans l’avoir prémédité, je m’aperçois que je ne lui ai pas parlé de Riquet. J’attends qu’elle m’interroge. Elle ne mentionne pas ce nom. Je laisse passer.
– Vous en êtes où des auditions ?
– Nous avons auditionné le secrétaire du CCE et quelques seconds couteaux ; les choses sérieuses commencent lundi avec Monsieur Argentino .
– Lundi, vous dites ?
– Lundi matin, absolument.
– Parfait. Tenez moi régulièrement au courant. N’hésitez pas à m’appeler. Je vous donne ma ligne directe. Veuillez noter.
Je note. Elle raccroche. Bati me dévisage.
– Elle est jeune, Bati. Elle démarre, ça va lui passer avec le temps.
– OK.
– Matéo, ce soir je ne ferai pas de vieux os.
– Bati, comme d’habitude.
– Figure toi que j’ai un rendez-vous galant.
– Oh, à ton âge ?
– Qu’est-ce que tu crois ?
Mon sourire lui déplait, il riposte :
– Quel âge tu as ?
– Pourquoi Bati ? Tu veux m’offrir un cadeau pour mon anniversaire ?
– Quel âge tu as ?
– J’aurai 27 ans au mois de mai.
– Et bien je vais te faire en effet un cadeau.
Il se lève, regarde le Courbet, m’obligeant à suivre son regard ; il se tourne vers moi et laisse tomber.
– A ton âge Matéo, on baise. A mon âge, on fait l’amour.
Fier de la sentence, il retourne s’asseoir et fait semblant d’être occupé par ses dossiers.
– Bati, c’est quand ton anniversaire ?
– Pourquoi Matéo, tu veux me faire aussi un cadeau ?
– Bah, si je peux et si c’est dans mes moyens.
– J’aurai 55 ans au mois d’août. Bientôt la retraite.
– Bon. Mon père disait toujours : si à 55 ans tu bandes et que tu arrives à plier ton dard avec ta main, n’en conclue pas que tu as de plus en plus de force dans le bras. C’est peut-être que tu bandes mou...
Il lève la tête, me regarde et laisse tomber son fameux :
– Petit con !
Chapitre 13
Roissy CDG.
Vera et Mehdi se sont revus, souvent. Au début, ils ont parlé – enfin, lui surtout - de ce qui était le plus facile, ce qui leur était commun, de Roissy.
Il croyait tout savoir, antériorité oblige, elle lui fit découvrir son jardin. Vera en effet avait trouvé un bout de campagne sur le site, une campagne concentrée, miniature mais tout de même … A CDG1, les foules d’ordinaire passaient des quais du RER aux satellites d’embarquement ; quelques employés bifurquaient vers les immeubles de bureaux de RoissyPole ; très peu s’attardaient place Fernand de Magellan. Une allée pavée, bordée de plusieurs bâtiments colorés et futuristes, se prolongeait par une passerelle en fer, grillagé, donnant sur un parc paysager qui avait de l’allure. Une végétation abondante, massifs d’herbes folles quoique très entretenues, taillis de buis, buissons de lavande, alignements de bouleaux, explosions de fougère encadraient une pelouse doublement intrigante. La pelouse ondulait ; elle avait en effet la forme de grandes vagues, comme si un plissement de terrain avait eu lieu. Et elle était le royaume de lapins, plein de rongeurs taille junior, qui toléraient sa présence mais se montraient prompts à filer dans leurs terriers, nombreux, à la première alerte. Ce décor incongru la transportait loin des pistes et des avions, tout proches pourtant.
A charge de revanche, Mehdi lui livra quelques nouveaux secrets de CDG. Véra pénétra dans le pavillon de réception officielle, puis à « Fort Apache » (le bâtiment 7200 de la maintenance), dans le « gaufrier » ( bâtiment 7500 de la formation), le « Caprice des dieux » ( la douane), la caserne des pompiers, l’ « araignée » ( la centrale thermique)...
Elle apprit que l’aéroport, comme toute ville, avait ses coups de chauffe, au petit matin, quand ça venait de partout, vers midi, gros départ, en fin de soirée aussi ; le site avait parfois comme des envies de sieste, il s’offrait en fin de journée un très lent endormissement mais souffrait, depuis le début, d’insomnie. En fait ça ne s’arrêtait jamais.
Et puis Roissy, c’était aussi la frontière, la ligne de démarcation, mais ça, Vera, elle connaissait. Il y avait la zone verte et la zone rouge, partout, tout le temps. Dans chacun des aéroports, des terminaux, des satellites, tout était strictement délimité, il y avait le vert et le rouge, le permis et l’interdit, le in et le off, les torchons et les serviettes et ça ne se mélangeait pas. Canalisés, bordés, encadrés, les passagers oubliaient qu’ils étaient en permanence au bord de la ligne. Ils suivaient le courant, tout était programmé pour cela ; mais il leur aurait suffi de faire un pas de côté, de sortir du troupeau, aussitôt, comme le voleur détecté à la caisse enregistreuse, l’alarme aurait beuglé, le rouge se serait allumé et l’intrus aurait eu les gardiens aux fesses.
D’instinct, Vera avait vite compris comment tout ça marchait, où il fallait mettre ses pas dans ce champ de mines, avant même de connaître Pif. Elle avait presque apprivoisé le site, pensa-t-elle.
Il lui présenta son petit monde roisséen, les gens de l’accueil, le personnel des pistes, les placeurs (ou cascadeurs, rapport au casque), les contrôleurs, les bagagistes ( les bagos), les restaurateurs (Servair), les préposés aux objets trouvés (ou perdus)… « Et pis y a les clodos ! »
Clodos ? Elle ne comprenait pas. Oui, dit-il, les clochards, les clopinards, les cloches, les vagabonds, les sans-abris, les SDF, sans domicile fixe. Des mots laids et des gens dont elle se méfiait. Ils étaient trop proches d’elle. On abordait là un terrain glissant. Mais pourquoi lui parlait-il de ça ? Elle avait bien vu qu’elle n’était pas la seule marginale dans le coin et que d’autres « personnes en instance » devaient roder ici. « Une centaine de SDF errent sur le site » confirma Pif. La nuit, une quarantaine d’autres, des extérieurs, venaient les rejoindre. Chauffé l’hiver, climatisé l’été, Roissy attirait. Les terminaux étant fermés entre minuit et quatre heures du matin, ces nomades se rabattaient alors sur la gare SNCF, au milieu de l’aéroport. Un centre Emmaüs, installé dans des préfabriqués, sous la route de service du terminal 2A, leur assurait la douche et le petit déjeuner. Il y avait là pour moitié des gens de l’Est, « comme toi ». Les autres étaient des exclus chroniques, aliénés migrateurs, fuyards de toute sorte. Pif en connaissait personnellement quelques uns, comme Aristide, kimono blanc et boussole griffée Koh Lanta au poignet ; Diogène – il s’était donné le nom du philosophe clochard – qui accumulait les objets, des montagnes de sacs plastiques boursouflés sur un caddy ; Georges, 75 ans, qui n’en n’avouait que 35, accro de l’ordinateur au T3 ; Morad dont les affaires étaient restées enfermées dans un local technique au sous-sol de 2D et qui revenait chaque jour les réclamer, en vain. Le plus étonnant, insistait Pif, c’est que l’aéroport semblait agir sur eux comme une drogue, quand on y avait goûté, on ne pouvait plus s’en passer. « Faut pas rester longtemps ici car après on s’y laisse enfermer. » Des « institutionnels » y vivaient depuis des années, certains en couple. D’un côté, ils parlaient du temps passé à CDG comme des taulards évoquant la zonzon, genre « J’ai cinq ans ou dix ans de Roissy ! » ; en même temps, ils étaient volontaires ! Si l’on peut dire. Le plus fameux d’entre eux, sir Alfred, Alfred Mehran : il avait vécu près de vingt ans dans l’aéroport. « Record du monde battu ! C’était un irano-apatride. Tout le monde en parle encore ; il a servi de modèle pour un film américain, Terminal, de Spielberg avec Tom Hanks. Et il a empoché du coup un petit paquet de dollars. Mais tu crois que le gars serait parti au soleil avec son magot ? Pas du tout : accro de CDG, il a pris une chambre d’hôtel dans les environs et chaque jour, de sa fenêtre, il peut reluquer les tours de contrôle, les pistes, le tarmac, les avions et tutti quanti. » Vera était choquée. Elle se répétait in petto que ce n’était vraiment pas son plan de carrière. Elle allait se tirer d’ici, c’est sûr, dès qu’elle en aurait les moyens. Vingt ans à Roissy ? Non, merci !
« Remarque, dit sans transition le grand Medhi, il y en a qui restent à CDG de drôle de manière. T’as pas entendu parler de l’affaire du « macchabée du Vienne/Paris ? » Prudente, elle ne réagit pas, ne semblait pas intéressée. Lui se montrait bien informé. La presse, poursuivit-il, restait sur la thèse d’un accident mais il savait de bonne source que le lascar, un certain Riquet, avait été assassiné, plus exactement poinçonné. « Poinçonné ? » tiqua Vera. Absolument, le bonhomme serait mort d’un coup de poinçon, une tige d’acier effilée dont on se sert d’ordinaire pour graver ou percer. Riquet, c’est dans l’oreille qu’on l’aurait poinçonné. Le bulbe rachidien traversé. Le genre de pénétration qui ne pardonne pas. Une méthode utilisée par l’armée, en temps de guerre, pour liquider en douce des sentinelles par exemple.
« D’après ce qu’on m’a dit, tu te planques derrière ta victime, tu plaques la main gauche sur sa bouche et de la droite, tu plantes l’outil bien au fond du pavillon ; c’est propre et radical, paraît-il ! »
Il s’y croyait, il jouait les durs, lui aussi ; elle se sentit soudain découragée.
« Mais je parle, je parle. Et toi, tu fais quoi ? » Elle s’inventa un emploi fictif, une vie ailleurs, il fit mine d’y croire.
Chapitre 14
Il fait très chaud ce dimanche soir. Depuis toujours, j’aime dormir les fenêtres ouvertes, même par temps froid. Alors, quand il fait lourd, c’est une nécessité. On est allongés, Hélène au creux de mon bras, et moi sur le dos. Je dors nu. Depuis l’enfance. Je ne supporte pas les pyjamas. Je n’ai jamais supporté. Je trouve ça laid. La plupart du temps, ils sont trop grands, dans ces frusques on ressemble à des internés. Et puis ils empêchent le contact de la peau avec l’étoffe. Finalement, les pyjamas, c’est comme un préservatif pour le corps tout entier. J’aime prendre une douche et me mettre nu sous les draps.
Hélène a les cheveux blonds, la peau laiteuse qui laisse entrevoir ses veines. Moi, je suis brun, mat de peau. Joli contraste. Histoire d’origines ? Même si elle est née à Paris, elle doit avoir des ancêtres Vikings. Moi, j’ai uniquement des aïeuls latins, une mère du nord-ouest de l’Espagne, un père du sud-est ibère, probablement du sang arabe ou juif. Si c’est le cas, j’en serais fier. Petit, j’étais à l’école le seul fils d’immigré dans le village de Fuveau où mon père avait atterri, un village composé essentiellement de familles paysannes. J’étais le petit de l’Espagnol. Moi qui me croyais pareil aux autres enfants, j’étais, à leurs yeux, différent. C’est le regard des autres qui vous fait sentir la différence, ce sont surtout leurs paroles qui vous blessent. J’ai toujours dû me défendre, me battre contre cette imbécillité et souvent de manière violente. Un jour où j’avais été puni, je ne sais plus pourquoi, je fus privé de récréation et obligé de rester seul dans la salle de cours. Un enfant entra dans la classe et eut la mauvaise idée de ricaner :
– Oh l’Espagnol ! Encore puni ?!
Je venais de recevoir, comme cadeau, une belle plume. Une Sergent-Major ou quelque chose dans le genre. Je la lui jetais violemment au visage. La plume s’enfonça sous son œil. Comme la flèche d’un Indien impitoyable. Le sang commença à couler. Les cris attirèrent l’ensemble des gamins et les maîtres qui étaient dans la cour. A cet instant, je me foutais bien de ce qui se disait. Je pensais lui avoir crevé l’œil et je n’en avais rien à battre. Si j’avais pu lui mettre un coup de pied dans les couilles, en plus, je l’aurais fait volontiers. Je n’avais qu’une crainte : que cela cause du tort à mon père. Aujourd’hui je me dis que j’en faisais trop mais je sais que, dans certaines situations, je suis capable de ces explosions de violence aveugle.
Hélène me fait revenir à la réalité en désignant mon torse.
– C’est pas beau tous ces poils ! J’espère que nos enfants n’en auront pas !
– Pourquoi ? C’est pas mal pour un homme d’en avoir un peu là où il faut. Et puis ça protège du froid.
– Je n’aimerais pas que mes enfants soient poilus, c’est tout.
– Tout ce que je veux, moi, c’est que les cinq premiers garçons me ressemblent. Qu’ils aient des poils, ce n’est pas un problème. Après, les filles, qu’elles n’en aient pas, qu’elles te ressemblent, ça me va très bien.
– Je n’ai pas compris. Tu peux répéter ?
– Je te dis : je veux, minimum, cinq garçons ; ensuite, le nombre de filles, cinq ? dix ? je laisse ça à ta discrétion.
Elle s’agenouille devant moi après une gymnastique compliquée et se met à me caresser.
– Mon petit Matéo, je te propose de faire les deux premiers avec moi. Pour le reste, tu te constitueras un harem.
– C’est une idée à creuser, mon ange ! Mais bon, je prends l’engagement que tu seras ma favorite, avec tous les honneurs dus à ton rang.
Elle se saisit alors de mon sexe qui, tout honoré, se redresse benoîtement. Elle affiche un sourire carnassier, me regarde dans les yeux :
– Finalement, j’ai une autre idée. Une fois que tu m’auras fait les deux premiers, ça ne te servira plus à rien, ces choses !
D’un mouvement brusque, elle me broie les parties, je hurle de douleur. Le coup de grisou, la sidération totale. Je n’arrive plus à parler et elle continue à me torturer en souriant.
– T’es d’accord Matéo ?
Tout ce que je suis capable de faire, c’est dodeliner du chef, les genoux ramenés vers mon ventre pour me soulager. Elle lâche son étreinte, je soupire. Puis, sans transition, elle commence à m’embrasser, ses lèvres enveloppent ma verge. Oublié le supplice. Le plaisir monte par vagues et quand elle estime que je darde suffisamment, elle m’enfourche et se penche à mon oreille :
« Tu pourrais peut être essayer de me donner ton premier héritier ? »
Lundi matin, au bureau. Je suis tout de suite absorbé par la lecture de mes mails ; au bout de trois quarts d’heure seulement, je me rends compte que le Sieur Argentino n’est toujours pas là. Va-t-il venir en retard ? A-t-il oublié ? Je ne le pense vraiment pas vu l’état d’anxiété où je l’ai trouvé, l’autre jour. Je téléphone au siège de Visit France à Montreuil, je demande à lui parler. Après plusieurs « Attendez, nous allons voir », une dame me répond :
– Monsieur Argentino n’est pas là. Monsieur Argentino n’avait pas prévu de venir ce matin. Monsieur Argentino doit arriver cet après-midi.
Je raccroche et je me replonge, un peu plus attentivement cette fois, dans le rapport de l’agence Secafi, page par page. Je m’attarde sur les comparatifs de prix, les taux de fréquentation des différents villages vacances du CCE. Midi. Argentino ne s’est toujours pas pointé mais c’est l’heure où Bati, en trois pièces blanc cassé, arrive avec Miguel. Il est chiffonné comme son costard.
– Argentino m’a posé un lapin, camarades.
– Ah bon ? Pas vraiment étonnant, non ? L’histoire Riquet a du lui mettre les boules.
− Et toi ?
− Mes boules ?
− Le boulot, papy !
– Mission accomplie. On a rencontré le directeur financier, Daniel Celce ; il travaille au CCE depuis trente-cinq ans, le genre qui-sait-tout, rigoureux. Il a pu nous donner des dossiers sur chaque achat, une photocopie de tous les chèques, tout est répertorié. Regarde, le paquet que ça fait. J’ai réfléchi en venant. Voilà ce que je te propose.
– Bati, c’est toi qui mène l’enquête ou c’est moi ?
– Ta gueule, gamin. Voilà ce que nous allons faire. Tu suis la piste de Visit France. Et moi, une fois que j’aurai étudié ces documents, je prends la direction Le Canet. C’est là où le CCE a fait ses premiers achats. Je vais y aller avec Miguel. En plus, je veux essayer la catalane, je connais pas !
– Essayer la catalane ?! Bati, t’es qu’un vieux macho !
– Oh, petit coq, c’est toi qui me donnes des leçons de féminisme ?
– Oui, parfaitement ! Mais ma voix manque d’aplomb. Bati, tu t’es jamais fait taper sur les doigts ? T’as pas remarqué que les temps ont changé ? et les femmes aussi ?
– Pas les miennes, petit, pas les miennes.
Chapitre 15
Roissy CDG.
Vera remontait tout l’aérogare 2D. De loin Pif la suivait. Il se cachait d’elle, il l’espionnait ; il n’aimait pas trop ça, il se trouvait même un peu crapoteux, ou pervers, mais il voulait savoir ce qu’elle faisait réellement, sa petite roumaine, qui elle voyait, où elle se rendait. Il se doutait bien que la fille l’embobinait ; il était à peu près sûr qu’elle n’avait pas de vrai job et peut-être même qu’elle squattait l’aéroport. Ce n’était pas possible autrement : lui qui avait des horaires improbables pouvait la croiser à peu près à n’importe quelle heure, tôt, tard, très tard même. Il avait bien essayé de la provoquer, lui demandant si elle n’avait pas planté sa tente à Roissy. Quand ils avaient parlé des « clodos », il avait senti que le sujet la turlupinait. Elle lui avait assuré qu’elle habitait Paris, rue Amila-Meckert. Il était à peu près sûr qu’il n’y avait pas de rue Amila-Meckert à Paris mais il n’avait pas insisté. Ni vérifié sur un plan d’ailleurs. Il la surveillait aussi pour le plaisir de la voir car il était prêt à tout lui pardonner, à sa Transylvanienne. Cette manière de marcher, le visage légèrement de biais, ce petit corps nerveux, ces fesses sublimes, tendues et souples à la fois, pivotant avec une sorte d’allégresse. Mordu de chez mordu qu’il était, Mehdi. Vera de son côté avait décidé de faire confiance à Pif, pourtant elle ne lui avait pas révélé l’existence de sa « garçonnière » - elle ne savait pas s’il existait un équivalent féminin à ce mot, genre la « fillière » ?
Le garçon donc la suivait ; ils passèrent d’un terminal à un autre, ils venaient d’entrer dans l’aérogare 2B, il y avait encore pas mal de monde devant les bureaux d’enregistrement. Elle allait vite, une vraie pro de la marche, mais il tenait le rythme, scotché, il faut bien le dire, par son bouleversant balancement du bassin, son déhanchement désarmant, bref son petit cul impertinent. Il se dit un moment qu’il était en train de faire une belle connerie. Il était à peu près sûr que cette nana n’était pas nette. Qu’est ce qu’il foutait alors avec elle ? Lui, un gars de la sécurité, assommé chaque jour de sermons par ses petits chefs sur la « déontologie » ceci et la « déontologie » cela, un homme de la fouille, de la palpation, des contrôles et tout le bazar, lui qui était – à son petit niveau mais n’empêche - chargé de l’ordre sur ce territoire, voilà qu’il fricotait avec une pas-claire, une louche, une dissidente ! Une terroriste peut-être ? Il déconnait grave. Valait mieux que sa relation ne s’ébruite pas. Bonjour la faute professionnelle. En plus, il n’était même pas « avec » cette fille, il la draguait, c’était tout, et pour l’heure, esclave, il la suivait. Misère. C’était du suicide, côté boulot en tout cas. Pourquoi la pistait-il ? Déformation sécuritaire ? Excès de zèle ? Harcèlement sexuel ? En fait, ce bout de femme l’intriguait un peu. L’amusait beaucoup. Et l’attirait passionnément. Il avait envie d’elle ; depuis des jours, il se faisait un cinéma pas possible dans sa tête, il la déshabillait, la pelotait pour de bon, pas pour un contrôle bidon, pour de vrai. Elle se donnait, faussement docile... Assez ! Tout cela était ridicule. En plus, cerise sur le gâteau, il voulait la protéger. Il se sentait envahi d’une immense sollicitude pour cette fille, et c’était bien la première fois que ça lui arrivait. Il allait la défendre, il serait son armure, son blindage, sa carapace, son bouclier, absolument : son bouclier. « Pauvre con ! » Mehdi s’en voulait, l’idée d’être responsable de cette fille était tout simplement débile. Et pourtant... Il ruminait mais persévérait dans l’erreur. Un moment, il s’aperçut que quelque chose clochait. Il hésita à comprendre, se troubla. Il y avait un blème, un gros. Un gaillard, devant lui, suivait Vera. C’était maintenant évident, l’autre, avec ses coups d’oeil en douce, ses précautions répétées, ses manières d’accélérer puis de flâner, était bel et bien en train de filer la Roumaine. Ils étaient donc deux à la suivre. Dit autrement, lui à présent suivait un type qui suivait Vera. Il ne connaissait pas ce mec, il ne faisait pas partie du décor habituel de l’aéroport. C’est à dire qu’il n’avait ni une allure de voyageur, on les reconnaît tout de même, ni un look d’employé d’ici. C’était pas un flic ou un privé de la sécu, Mehdi les connaissait à peu près tous. Un dragueur ? Un maniaque ? Ou le mari ? Il se sentit dépassé. Au propre et au figuré. Il s’était amusé à suivre sa copine, une sorte de jeu, un peu trouble, il se retrouvait dans un ménage à trois, peut-être scabreux, le nouveau venu n’avait pas vraiment l’air affable. Du coup, il ne savait plus ce qu’il devait faire. Mais l’autre eut alors un moment d’inattention. Le concurrent en effet se laissa surprendre, une poignée de secondes, par le spectacle d’une télé géante, dans une brasserie bondée ; sur l’écran, des furieux se disputaient un ballon. Tout allait si vite que Mehdi, qui n’entendait que la rumeur mélangée du poste et de la salle, aurait été bien incapable de dire s’il s’agissait de foot, de rugby ou même de handball. Il y avait une pelouse au fait ? Il n’avait même pas tilté. Lui et les sports d’équipe, ça faisait deux. En tout cas, il profita de ce bref moment de relâchement du challenger pour le doubler et recoller à la roue de Vera. Au risque de se faire repérer. Elle venait d’emprunter un escalator la conduisant, en sous-sol, à une galerie marchande. Il connaissait le coin, la placette, l’estrade avec le boeuf, l’impasse sur la gauche pour le coup, fermée par un miroir géant. La fille s’éclipsa vers l’entrée des toilettes, Mehdi eut à peine le temps de repérer le portillon dérobé, à la fois évident et trompe-l’œil parfait, où elle se fondit. Il accéléra le mouvement, se jetant en fait sur la jeune femme, la poussant en avant. Vera paniqua, il lui claqua la main sur la bouche. Emboîtés l’un dans l’autre, ils s’étaient déjà engouffrés dans le local et s’adossèrent à la porte refermée.
Elle tenta de lui mordre les doigts. « Sale flic ! » râla-t-elle. Le son était étouffé. Il lui glissa à l’oreille :
« Tais-toi ! T’es suivie ! »
Elle le regarda, égarée, pensa qu’il la prenait pour une conne, ou alors qu’il était vraiment cinglé. Il lui montra d’un mouvement de menton le drôle, derrière la glace, qui déboulait de l’escalator, très contrarié. Celui-ci contourna le piédestal avec son bovin rouge et sa grenouille, scruta toutes les vitrines, détailla les clients du bar, se dévisagea dans le miroir, grognant de rage. Vera le reconnut. De surprise, elle en attrapa le hoquet. Mehdi la libéra, elle se laissa aller sur le monticule de couvertures. L’autre continuait de virevolter comme un animal pris au piège. Pourvu qu’il ne donne pas un coup de pied de dépit dans la glace, s’affolait Vera, imaginant déjà celle-ci en train d’exploser et elle se retrouvant soudain face à lui. L’homme hésita, jura, il était comme déséquilibré, ballotté puis il repartit, impétueux, dans l’autre sens, vers l’aérogare 2A.
« C’est qui ? » Murmura Mehdi.
Elle prit son temps pour réagir, ouvrit la bouche, rien n’en sortit. Elle tendit le bras vers Pif, hocha la tête, comme pour dire : attends, une seconde, tu veux bien... Pendant qu’elle récupérait, Mehdi lui expliqua, doucement, qu’il avait compris, depuis quelque jours déjà, qu’elle squattait l’aéroport, il avait simplement eu envie de voir où elle se cachait. D’où son arrivée surprise.
« J’étais à peu près sûr de te trouver sur le site ; mais l’autre, c’est qui ? »
« C’est le type de la mine ! » Pif ne comprenait pas. Elle parla de sa descente à la trieuse, de la machine gigantesque, du corps dans le wagonnet, celui que la presse appelle Riquet certainement, puis de ce gars décharné à peine entrevu aux pieds de la tourelle où elle perchait, l’anguleux au bonnet. Le jeune homme compatit, chuchota :
« Il a du te reconnaître dans la foule, te suivre ; et pas pour de bonnes raisons, à mon avis. Il pense que t’as vu ce que tu devais pas voir...
« Mais j’ai rien vu, Pif, j’ai rien vu. Juste un macchabée dans un bac, c’est tout. Protège-moi, Pif, j’ai peur. »
Un ange noir passa. Vera était prostrée ; on aurait pu penser qu’elle s’était endormie. Du regard, Mehdi fit le tour de son antre. « C’est plutôt spartiate chez toi... » C’était le moins qu’on pouvait dire. Un paquet de couvertures Air France, une chaise en plastique blanc crème et puis tout ce qui faisait l’ordinaire d’un aéroport, des flacons de shampoing, des lotions, des sandwiches emballés, des bouteilles d’eau. Elle devait sans doute faire ses emplettes devant les postes de contrôle avant l’embarquement ; les passagers y abandonnaient tout ce qui ne franchissait pas la barrière de sécurité. Depuis un attentat déjoué en 2006, les liquides étaient interdits en cabine. Mehdi connaissait bien le problème, il lui arrivait de jouer les « greenpifs » chargés du recyclage aux postes d’inspection. Au sol encore une tache noire, un livre de poche, « Le boucher des Hurlus » de Jean Amila-Meckert. Il l’ouvrit, au hasard, lit sans lire « …acculée à répondre, à se battre au corps à corps, avant de craquer ainsi sous l’énorme poids de la noire bêtise d’un monde enlarbiné au service de la Mort. »
Chapitre 16
La sonnerie du téléphone ne me surprend pas, je sais que c’est Bati. On ne reçoit pas trop de coups de fil dans nos bureaux et puis j’attendais qu’il se manifeste. Je le sens excité comme une puce :
– Ça va Matéo ?
– Alors, et ces vacances, Bati ?
− Petit con ! Je crois qu’on a trouvé le gros lot.
− Vas y.
- Les PV d’audition sont aussi épais que le petit Larousse illustré ! Le directeur du centre a été très coopératif, il nous a ouvert tous les livres de compte. Mais pour que tu ne te fatigues pas, j’ai rédigé un résumé de l’enquête. Je te l’envoie par fax. Quand tu l’auras lu, tu me rappelles. Et toi ? Qu’est-ce que t’as appris sur Visit France ?
- J’ai été reçu par la nouvelle Directrice de la boîte, parce que figure toi : Visit France a été racheté par un tour opérateur alsacien. En fait, Air France a cédé sa filiale, pour un euro symbolique, à Mossieur Christian Argentino. Dans le même temps, elle a comblé un passif de trois millions d’euros et accordé un prêt de la même somme avec une clause de retour à bonne fortune !
-Mais, c’était quoi l’accord ?
-Il s’agissait d’une cession complète. Air France se désengageait totalement. Napolèse, en partant à la retraite, a voulu prendre le contrôle de Visit France. Il y a eu une bagarre entre lui et ses associés, Argentino et Riquet !
− Le Riquet qu’on a retrouvé zigouillé à Roissy ces jours-ci ?
– Exactement. C’était, paraît-il, un gars discret, un ex steward, le troisième larron de l’équipe. Pour calmer le trio, Air France imposa alors une partition de Visit France : Argentino en gardait une partie, Napolèse prenait le reste qu’il baptisa Tourisme France International. En fait, la partie juteuse était pour Napolèse. Au bout d’un an, Visit France a creusé un trou d’un million et demi d’euros et a été racheté par les Alsaciens. La directrice m’a confirmé que cette agence n’était pas viable, vu la façon dont ça fonctionnait. Argentino est devenu employé de la nouvelle société et Riquet a dégagé. Pour la petite histoire, Argentino s’était calculé un salaire de 7500 euros par mois et de 5000 pour le sieur Riquet. Tu me diras, ça n’explique pas le trou de Visit France. Mais quand même, c’était joli.
– Ok. Et qu’est-ce qu’elle dit, ton alsacienne, sur Argentino ?
– Que c’est un honnête professionnel mais elle ne comprend pas son absence. Plus de nouvelles de lui depuis la semaine dernière. Ils ont téléphoné chez lui. Sa femme non plus ne sait pas où il est passé, c’est pas trop dans ses habitudes de décamper comme ça. Elle a signalé sa disparition à la gendarmerie de Versailles.
– Ecoute Matéo, c’est évident que tout est lié. Riquet, Napolèse, Argentino. Il y a eu un engambi entre eux, comme tu dis à Marseille. Et quand tu liras mon rapport, tu verras que c’est un système de détournement de fonds bien ficelé. au détriment du CCE. Ça dépasse le simple détournement classique. Vu les sommes, c’est du lourd. Je t’envoie ça illico. Tu regardes mon pensum, tu me rappelles et on fait le point, OK ?
Je raccroche ; quelques minutes après je récupére le fax. Deux pages. Du lourd, comme dit Bati .
« Le CCE d’Air France a proposé l’acquisition de semaines en multipropriété (Time-Share) dans des appartements de la région de Perpignan, au Malibu centre, dépendant d’un club, le « CLC Developments Limited », dont le siège social se situe sur l’ Ile de Man ( Grande Bretagne).
1- Une promesse de vente est signée pour 70 semaines moyennant un prix d’un million d’euros, paiement effectué par chèque du Crédit Lyonnais, au nom de Landmark Title Agency, Compte séquestre « Club La Costa », sur un compte de : La Banque Populaire, 55, avenue Aristide Briand, à Montrouge, 92542.
Nota : il faudra demander à cette banque la copie des statuts de la société, le destinataire des fonds, ainsi que les personnes ayant eu pouvoir sur ces comptes.
Il apparaît une anomalie supplémentaire : Landmark Title Agency, immatriculée en Angleterre sous le n° 2105882, n’a rien à voir, si ce n’est la ressemblance de nom, avec Landmark Title and Trust Limited, immatriculée en Angleterre sous le n° 01112603, titulaire du droit réel de propriété des immeubles de Perpignan. Or, c’est Landmark Title Agency qui est bénéficiaire du paiement. Pourquoi le versement se fait en France ? Et pourquoi cette société anglaise a été liquidée peu après l’encaissement du chèque ?
2- Puis une nouvelle promesse, portant sur 31 semaines, est signée avec une autre société, la CLC International Marketing Limited, sise Ile de Man (même adresse). Pour 1 500 000 euros, paiement effectué par chèque, tiré sur le Crédit Lyonnais, au nom de First American Title Insurance Company – UK – et non plus au nom du Club La Costa.
La First National Trustee Company Limited a son siège à l’Ile de Man, elle est titulaire des titres de propriété, et est enregistrée sous le n° 37018.
La First American Title Insurance Company a son siège à Londres, 63 Victoria House, enregistrée sous le n° 1112603 ; son unique activité est l’assurance vie ; elle est le bénéficiaire du chèque. Le plus étonnant reste le fait que ces deux transactions ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société française, dont le nom semble avoir été curieusement modifié.
La société TFSC – Time Share France Communication, SARL - a son siège 34, rue Beaujon, Paris 8e ; elle est immatriculée au registre du commerce de Paris sous le n° B 347 507 014, et est représentée par Franck Romin, c’est le signataire des deux ventes avec le CCE ; elle figure sous cette appellation dans les contrats de vente.
Or cette société n’existe pas. En effet, le numéro d’inscription B 347 507 014 correspond à une boite dénommée Sport France Communication, qui a pour activité « les services annexes à la production », dont le siège était d’abord au 75, avenue Parmentier, Paris 11e, transféré ensuite au 34, rue Beaujon, Paris 8e, et dont le gérant est Jean-Luc Bartarri . Celui-ci dispose curieusement d’une société immatriculée en Irlande : La Galestar Investments Ltd, 101 Furry Park Road, Howth, Dublin. D’après nos vérifications, le gérant statutaire, Jean-Luc Bartarri, est inconnu du CCE ; l’intermédiaire connu, tant vis-à-vis de l’acheteur que du vendeur, reste Franck Romin ».
Je rappelle Papy Bati.
– Beau boulot Papy, beau boulot .
– C’est grâce aux copains de Perpignan et à la coopération du directeur si on a pu faire tout ça, et si vite. Sans eux, il nous aurait fallu un mois de recherches. Ils ont mis à notre disposition une équipe complète. On a travaillé à six là-dessus. Ça nous a permis d’avancer à une vitesse incroyable. Alors ?
– C’est clair, si l’on peut dire. C’est un sacré système de détournement. Je sais ce que tu vas me dire, Bati, alors c’est pas la peine. Pendant que tu finis ta mission, je vais faire une perquisition chez le dénommé Bartarri dont il est question dans ton PV.
– Matéo, je sens que je ne t’ai pas formé pour rien. C’est exactement ce que j’allais te demander.
– Tu en as pour combien de temps encore à Perpignan ?
– Au moins deux jours. Peut-être que je ne remonterai que samedi. Je vais essayer de finir notre dossier avec Miguel et on fait le point en début de semaine prochaine.
– Ok. Je vais voir avec qui je peux aller chez Bartarri.
– Prends Alain avec toi, ce petit jeune démarre, faut qu’il se forme un peu.
– Ok. Bati. Allez je t’embrasse. A bientôt.
Je vais voir le boss pour programmer la « perquis ». Ce nom de Bartarri ne m’est pas inconnu.
Chapitre 17
Roissy CDG.
Pif habitait Goussainville. Vera voulut répéter ce nom, hésita.
– Tu connais pas Goussainville, tu peux pas connaître. Personne ne connaît. En plus, toi qui vient de Brasov...
– Goussainville … La fille désarticulait lentement ce toponyme, comme s’il s’agissait d’un lieu prestigieux, elle souriait.
– Le coin a eu son heure de gloire, fanfaronna Medhi. Il y a des années de cela. Lors d’un salon aéronautique, au Bourget, un Tupolev flambant neuf, c’est le cas de le dire, orgueil de la flotte soviétique, les Français l’appelait le Concordski, si tu vois ce que je veux dire..
– ?!
– Bref, le Concordski, donc, s’est crashé après un looping loupé. Et il est tombé... à Goussainville, justement. Le journal Hara-Kiri en avait fait sa Une. Mon père avait mis sous cadre ce dessin des deux pilotes dans le cockpit, alors que l’engin plongeait, l’un qui demande à l’autre : « Tu crois qu’on trouvera de l’essence à Goussainville ? »
Vera ne réagit toujours pas. La Roumaine semblait hermétique à l’humour français. Pas rancunier, Pif passa à autre chose.
– Donc j’habite Goussainville. En fait un quartier un peu à part, un ancien village, appelé Vieux Pays.
Ce bourg, au bord des pistes de l’aéroport, était abandonné. Les anciens résidents, assourdis par le boucan des flottilles, à longueur de journées, avaient fui ; restait un champ de ruines, quelques 200 pavillons aux fenêtres et aux portes murées. Et quelques dissidents, des durs à cuire, des têtes brûlées qui demeuraient là, malgré tout. Dont Tlisi sénior, aujourd’hui décédé, et Mehdi donc. Le coin ressemblait, avait dit un journaliste, à « un village de prospecteurs déserté après la disparition de la mine d’or ».
– Tu me montreras Vieux Pays, Pif ? Promis ?
Au service Sécurité où travaillait le jeune homme, il se passait toujours quelque chose. Chaque jour, il avait de nouvelles anecdotes à raconter. Des histoires de faux passeports, en pagaille. Celle de l’Africain qui se présentait à l’embarquement avec un « Passeport du monde ». Le document ressemblait plus ou moins aux papiers en vigueur un peu partout, format, couleur, tampon, données biométriques, photo et compagnie. Mais il était mentionné sur la couverture « Passeport du monde ». Comment son propriétaire avait-il pu arriver avec ça jusqu’ici ? Mystère. A l’accueil, l’hôtesse, plutôt aimable, lui signala l’embrouille, l’autre ne broncha pas. Elle insista, parla d’un faux grossier mais lui, il y croyait à son laissez-passer. Tout son village s’était cotisé pour obtenir le sauf-conduit, 10 000 dollars, ça leur avait coûté, alors il se sentait porté par son clan, par ce formidable espoir mis en son déplacement. Il était leur messager, leur envoyé spécial, leur mandataire. Il fallait que ce putain de passeport serve. « Je ne suis pas flic, ajouta l’employée, embarrassée ; alors vous avez le choix : vous partez, vous disparaissez, vous en avez encore le temps, je ne veux plus vous voir, ni rien savoir et il ne se passera rien ; ou alors je serai obligé d’appeler la police. Et là... » Le gars resta en place, impassible, sûr de son droit. Les flics l’ont embarqué. Avec son passeport du monde.
Pif déroulait ses historiettes, Vera en redemandait.
« Des faux passeports, il y en a beaucoup plus qu’on ne croit, prétendait-il. Et comment tu les remarques ?
Il aimait se faire désirer, elle attendait la suite.
« Dans une file d’attente, les employés expérimentés peuvent repérer d’un coup d’oeil les suspects. Me demande pas comment ils font exactement, mais il paraît qu’il faut être attentif, par exemple, à ceux qui portent des costumes -et des chaussures- trop neufs... C’est un peu comme s’ils se déguisaient. Mal. Et se trahissaient. Quand ils ont un doute, les contrôleurs jouent avec des questions pièges.
– Du genre ?
– T’as le passeport du passager entre les mains, tu lui demandes son âge. D’ordinaire on va te répondre : 22 ans ou 63 ans, enfin, peu importe. Le suspect, lui, dira : 1990 ou 1949... Il ne donnera pas son âge, il dira la date mentionnée sur le document. Il l’a apprise par cœur, la date, il la donne telle quelle. Persuadé que ça fait vrai.
– C’est qu’il a été mal briefé, alors ?
– Ou qu’il panique. A sa façon. Autre question piège que peut poser l’employé : quel est le numéro de votre passeport ?
– ?!
– T’as raison, personne, en principe, à part les maniaques peut-être, ou les névrosés sévères, ne connait son numéro de passeport. Mais le fraudeur, lui, il le sait. Il est tellement anxieux qu’il apprend tout par cœur. Comme si c’était une garantie. Or c’est exactement le contraire qui se passe : de cette manière, il se démasque, il vend la mèche. Et puis il y a d’autres trucs encore, qui ne sont pas des preuves mais, disons, des indices. Un voyageur qui n’est muni que d’un aller simple, c’est louche. Quelqu’un qui a payé son billet cash, c’est pas net. Idem s’il vient de l’acheter juste avant le vol... Après, bien sûr, il faut faire la preuve que le bonhomme arnaque, que ses papiers sont faux, et ça, c’est une autre paire de manches.
Pif pense qu’en fouillant les bagages, on comprend souvent mieux les gens.
– L’autre jour, j’avais un vol pour les Émirats. Arrive une Américaine, grande, distinguée, plutôt cordiale. Elle aurait pu être aussi bien prof de fac que cadre commercial. Or dans sa valise, son unique valise, il y avait tout un attirail de poule de luxe, sous-vêtements de parade, corset, bottes, sex-toys divers, fouet et compagnie. Et uniquement ça. La dame était une prof d’un genre spécial, sans doute apprécié d’émirs à la libido agitée.
– Elle devait être gênée ?
– Pas du tout. Elle a assisté à la fouille imperturbable, avec un sourire de Joconde. Absolument impavide. Elle nous faisait comprendre ainsi qu’elle faisait son job et nous le nôtre et que tout était bien ainsi.
Pif parlait volontiers des sans-papiers de Roissy. Il pensait, à tort, que le sujet branchait Vera. Il trouvait perverse la chasse qui leur était donnée. C’était, disait-il, une politique à deux vitesses. Il y avait les refoulés et les tolérés, les indésirables et les nécessaires. A deux pas du ZAPI, par exemple, il connaissait une blanchisserie industrielle, RapidEclair, 50 salariés, qui était chargée du nettoyage des linges d’avion. Depuis des années, le patron y faisait trimer des sans-papier justement, taillables et corvéables à merci. Pour eux, le choix, si l’on peut dire, était simple : l’esclavage ou l’expulsion. Et une expulsion qui pouvait se matérialiser au bout du couloir où ils bossaient. Tu trimes (dur) ou tu te trisses (vite). Les salariés se sont finalement mis en grève, ils ont obtenu leur régularisation et une augmentation de salaire dans la foulée. Bingo, fromage et dessert. Mais le patron était un revanchard : on racontait qu’il faisait nettoyer à présent le linge dans d’autres centres, employant des travailleurs handicapés largement pourvus d’aides publiques. Du coup, les gens de Roissy risquaient de se retrouver sur le carreau : perdant leur (autorisation de) travail, ils seraient à nouveau expulsables.
Chapitre 18
Je soigne mon procès verbal de l’entretien avec Jean-Luc Bartarri. Dans les affaires pénales comme celle-là, les avocats cherchent toujours la petite bête pour tout foutre en l’air ; ils guettent les erreurs de procédure pour sauver leur client. Et c’est malheureusement le cas dans quatre-vingt-quinze pour cent des enquêtes, annulées pour des conneries. Je vérifie donc si tout est en place, les petites virgules, le protocole et tout le bastringue : « Nous, Mateo Montesinos, lieutenant de police en fonction à Paris..., poursuivant l’exécution de la Commission rogatoire...., Vu les articles..., assisté du lieutenant....et de l’attaché d’enquêtes...., nous étant préalablement transporté..., où étant à l’heure figurant en tête du présent..., sommes reçues par Monsieur Jean-Luc Bartarri... »
Jusque là, ça va, comme dit l’autre. Les identités, le transport, l’heure... Je passe à l’interrogatoire :
« Question : Pourriez-vous nous donner des précisions sur le ou les marchés passés avec le CCE d’Air France ?
Réponse : Il s’agit d’achat de semaines à temps partagé avec le Club Le Canet. De mémoire je n’ai passé qu’un seul marché par l’intermédiaire de Franck Romin avec le CCE d’Air France. Pour cette opération j’ai été rémunéré pour un montant de 150 000 euros par virement de la Banque Populaire de Montrouge. »
Ce qui m’intéresse, c’est le rôle de Franck Romin dans ces ventes. Selon Bartarri, Romin s’est pointé chez lui « en voulant des renseignements sur le time-share ». Il assurait avoir le contact avec plusieurs comités d’entreprise et se disait attiré par du produit haut de gamme. « Concernant le CCE d’Air France, j’ai très vite senti que c’était sa chasse gardée, qu’il me tenait à l’écart des premières transactions. » Mais dans la phase finale des négociations, histoire aussi de se donner plus de poids, Romin a demandé à Bartarri de l’accompagner. Cela ne se serait produit qu’une seule fois. « Sur place, j’ai rencontré MM. Napolèse et Argentino. » Par la suite, Argentino se serait déplacé rue Beaujon. C’est Romin, apparemment, qui faisait tout ; c’est lui qui préparait le contrat, qui le présentait pour la signature. « Je ne me souviens pas si c’est moi qui l’ai signé en premier ou Monsieur Napolèse. » Bartarri touche alors 150 000 euros et reverse la moitié, 75 000, à Monde Evasion, la société de Romin. Comme je lui demande s’il trouve que cette rémunération lui semble normale, il répond : « Je récupérais vingt pour cent et je rétrocédais dix pour cent à Monde Evasion. » Quelques mois plus tard, Bartarri conclut une deuxième opération de time-share avec le CCE Air France, cette fois pour un montant de 400 000 euros. C’est moi qui le lui signale. Sans se démonter, le bonhomme me dit : « J’avais oublié cette opération. Maintenant je m’en souviens. J’ai invité Franck Romin autour d’une grande table parisienne pour fêter ça. »
Pour ce nouveau contrat, Romin a fait du copier-coller de la première tractation et Bartarri a empoché 30 000 euros. « Pour le portage. » Romin était rémunéré à la fois par le promoteur et
par lui-même.
Romin, à l’époque, disposait d’un grand appartement à Rosny-sous-Bois, il gardait un pied-à-terre en province et vivait le plus souvent en Autriche. « J’ai été invité une fois là-bas, me dit Bartarri. Ses affaires marchaient bien à l’époque sur Radstadt. »
Concernant la B.I.C.S. de Montrouge, Bartarri prétend ne s’y être rendu qu’une seule fois, avec Romin, afin de déposer le chèque du CCE, et dit ne rien connaître sur le fonctionnement du compte lui-même.
Romin aurait eu également des contacts avec le CE de Renault mais n’aurait pas fait d’affaires avec.
« Après lecture faite personnellement, Monsieur Bartarri persiste et signe avec nous et nos assistants le présent acte » : la formule de conclusion est à sa place, toutes les signatures itou. Parfait. A la relecture, je trouve qu’on avance vite. Etape suivante : procéder à une réquisition à la banque de Montrouge. Ce que je fais dans les formes. Avec le numéro de compte séquestre, le listing des mouvements bancaires. Je leur indique que c’est urgent, que c’est pour hier, qu’ils m’envoient tout ça par fax.
Chapitre 19
Roissy CDG.
Vera avait froid au crâne ; elle sentait comme un courant d’air sur le pariétal ; elle se tâta la calotte glaciaire : elle était complètement rasée, lisse, la boule, le caillou ! Sa main caressait un galet, ou de l’émail, l’émail d’un lavabo par exemple ou encore une peau d’anguille. Mais qu’est-ce que c’était que cette mode de tout raser ? La vogue « Lager » ? La coupe THX 1138 ? Elle ne se souvenait plus d’être allée chez le coiffeur, encore moins chez le tondeur ; par réflexe, elle se palpa aussitôt le visage, le menton, le cou, la poitrine ; comme si elle s’attendait à ce que ses poils aient migré par là ; elle se découvrit couchée, nue, dans un lit étroit ; pas de drap sur le sommier, juste une couverture sur sa peau, une couvrante rêche, couleur kaki, qui la protégeait à peine ; d’ailleurs ses pieds dépassaient. Au dessus d’elle, un petit panneau gris clair, perpendiculaire au mur, indiquait, en lettre et chiffres blancs, E 82. Pas vraiment de quoi la rencarder, ni la rassurer. E 82 ? Elle avait l’impression de se retrouver dans un film de Georges Lucas. Elle redressa légèrement la tête. A sa droite, à sa gauche, une enfilade de lits semblables, presque collés les uns aux autres, tous occupés, d’où émergeaient les mêmes crânes rose gris pâle, tondus. De l’autre côté d’un étroit couloir, cette rangée de lits se répétait à l’identique ; cette fois c’étaient les pieds, ceux des voisins, qu’elle remarqua. Le dortoir ressemblait à ceux qu’on pouvait voir parfois au Journal Télévisé, après une catastrophe, une inondation, un tremblement de terre, un feu nucléaire, quand des secours d’urgence s’organisaient. Mais Vera ne se souvenait pas avoir traversé un tel enfer. Encore que…
Elle avait beau mobiliser sa machine à souvenirs, rien ne venait. Elle était confuse de chez confuse. Elle se redressa à nouveau, sur ses coudes cette fois, la salle ressemblait à un long couloir, compartimenté par des panneaux gris. Une seule porte, à une extrémité, gardée par une fliquette. Vera était trop loin pour distinguer son visage mais elle crut deviner une petite bonne femme blonde avec une queue de cheval ; la dame était assise derrière un comptoir comme une hôtesse de l’air d’un genre particulier. Au dessus de la porte, un panneau lumineux annonçait : « Mesnil-Amelot (CRA). Embarquement immédiat ».
Une prison ? un dortoir-prison ? la Zone ? Merde ! Elle s’était faite piquer et de nouveau cloîtrer dans la ZAPI. (A ne pas confondre avec Zappy Max, aurait pu dire Medhi qui, à la différence de Vera, avait de l’humour et une solide connaissance des jeux radiophoniques d’antan...) ZAPI, ZAPI, ce sigle était imprimé sur la couverture, sur les montants du lit, le dossier des chaises. Elle était donc redevenue une personne en instance… Instance : quel drôle de mot. Ce n’était pas vraiment la première fois qu’elle l’entendait mais elle ne le comprenait toujours pas. Son français était assez basique, finalement. A l’école, elle avait appris cette langue, elle était assez bonne côté tchatche. Il y avait eu tout de suite des « sons » qu’elle aimait faire rimer, genre amour, toujours, bonjour, abat-jour… Dans son travail d’interprète, en Transylvanie, elle usait surtout de mots pour touristes, comme « voici la chambre », « regardez le lit du vampire », « l’empaleur est passé par ici, il repassera par là », « montez dans le car », « n’oubliez pas le guide ! » C’était un vocabulaire assez maigre et répétitif. Depuis quelques semaines, grâce à Mehdi, tout lui revenait, tout s’accélerait. N’empêche, instance, ça ne lui disait toujours rien. Une personne en instance était une personne en danger, ça, c’était ce qu’elle sentait. Une instance était un truc à fuir. De toute manière, le résultat était là : elle s’était faite pincer. Comment avait-elle pu se laisser avoir ? Elle se sentait lourde, droguée sans doute. Elle bougea, un peu. « On se calme ! » dit aussitôt, d’une voix chantante, la queue de cheval derrière son comptoir. La gardienne regardait Vera puis quitta lentement sa place, remonta le long couloir, s’arrêta au pied du lit. Surprise : il ne s’agissait pas d’une nana, ni même d’un flic. C’était le malingre de l’autre fois qui faisait face à la Roumaine, le mec au bonnet breton et à la face creusée, le cadavre ambulant du fond de la mine, celui-là même qui la pistait l’autre jour. Le bonhomme sourit, c’est fou comme il inspirait confiance. La jeune femme chercha ses yeux, ne distingua que deux trous noirs. Le personnage avança son bras droit, son poing était fermé sur un drôle d’instrument. Ses doigts étaient passés dans un poing américain et dans le prolongement du pouce, il y avait un stylet. Elle sentit bientôt la tige de fer qui cherchait son oreille. Un peu comme le furet qui repère sa canalisation. Ça faisait un drôle de bruit, comme si on froissait du papier. Elle hurla …et se réveilla, toute hérissée. Elle respira très fort, soufflant comme un vieux phoque bronchiteux. Ses voisins de chambrée avaient disparu, le cinoque itou. Vera retrouvait ses marques, et son antre. De l’autre côté du miroir, la farandole des touristes avait repris son rythme ordinaire. Une nouvelle journée commençait à Roissy-Charles de Gaulle.
Chapitre 20
Ce matin là, j’arrive en retard. Bati, exceptionnellement, est à son bureau. Il n’a pas eu le temps d’enlever son chapeau et prend des notes tout en écoutant une conversation au téléphone. Je lui fais un petit signe de la main et m’assois. Je ne peux m’empêcher de l’observer. Albert Uderzo a du le croiser et le prendre pour modèle quand il a dessiné Ocatarinetabellachitchix, le chef de clan, dans « Astérix en Corse ». Sous son bitos dépassent des mèches noires, je crois qu’on dit volontiers noir corbeau. A 55 ans, l’animal n’a pas un seul fil blanc. Ce qui m’impressionne dans ce visage, c’est son nez fin, long comme une lame, qui partage, net, sa face aux joues glabres, émaciées ; ses pommettes saillantes ; ses oreilles à côté desquelles celles de Bernard Thibault passent inaperçues ; et surtout, son regard, noir, sombre, sous des sourcils broussailleux. Je ne suis pas du genre cœur tendre mais je dois dire que je n’aurais pas aimé l’avoir comme ennemi.
Il pose le téléphone, voit bien que je le dévisage, persifle :
– Tu es amoureux de moi, petit ?
Je rentre dans le jeu.
– Avec un peu de rouge à lèvres, des faux cils, ça pourrait aller.
– Petit con... C’était Mlle Laurence Rivière au téléphone. Elle souhaite qu’on lui fasse un envoi partiel des P.V.
– Pas de problème. Je garde les photocopies et je lui prépare le dossier.
– Figure-toi qu’il y a eu du bazar au TGI de Bobigny, genre dégât des eaux ; tous les bureaux du rez-de-chaussée ont été inondés, ils sont impraticables. Bref, Mme la juge compte travailler toute la semaine chez elle et demande si on peut lui amener les documents à son domicile.
– Oh putain ! Tu veux pas t’en charger ?
– OK... si le déjeuner est pour toi ! J’ai noté son adresse. Bon, et bien, je lui apporte tout ça ce soir, en partant. Maintenant, allons voir le boss.
Le boss ! J’avais oublié qu’on devait lui faire signer nos ordres de mission pour rencontrer ce brave Mr Romin. Par correction, il faut appeler nos collègues de Pau, dernière adresse connue du Romin en question, si Bartani nous a dit vrai...
Bati se lève pour m’accompagner :
− En plus, à Pau, c’est Daniel Dubar, un bon pote, qui est aux affaires.
Chapitre 21
Roissy CDG.
Parano, Vera l’avait toujours été. Déjà toute petite, elle voyait des loups partout... Alors, aujourd’hui, elle s’estimait harcelée par les flics, les macs, les machos et compagnie. Et même parfois par des macchabées en gabardine noire. Depuis qu’elle se savait suivie par le décharné de la grande trieuse, elle flippait vraiment et tout le temps. Elle sortait moins ou en compagnie de Mehdi ou alors elle marchait. Elle qui déambulait déjà pas mal, voilà qu’elle se déplaçait sans arrêt. Ce matin, elle avait rendez-vous avec son ami dans le camembert. En arrivant à l’étage de la « navette » de Roissy 1, elle trouva qu’il y avait dans l’air comme un bourdonnement inattendu. Ce n’était pas le murmure ordinaire des bureaux d’accueil ni la simple musiquette des annonces de vol par haut-parleur. Ce bruit de fond était insolite : il était provoqué par l’agitation de plusieurs groupes, trois en fait, qui semblaient faire la course dans le couloir circulaire, entre les cafés-restaurants d’un côté et la petite terrasse centrale, ronde, derrière sa baie vitrée, de l’autre.
Ces équipes s’ignoraient absolument, chacune opérant sa propre ellipse comme autant de satellites gravitant autour de l’étoile-mère. Pourtant ces bandes se ressemblaient, conduits par un mâle dominant, bavard, bronzé, tenant de manière désinvolte la veste jetée sur l’épaule, entouré d’un premier cercle de journalistes, des femmes en majorité, micro ou caméras tendus vers le gourou, cercle lui même encadré par une rangée de collaborateurs du chef présumé et d’inévitables badauds qui avaient pris le train en marche, pour voir. Ces roitelets et leur cour tournaient sans désemparer, suscitant sur leur passage un brouhaha aussi spectaculaire que fugace. Le premier noyau s’était formé autour de l’Architecte, Pierre Envieu. A toutes les questions qu’on lui posait, « Est-ce que la signalétique vous paraît efficace ? » ou encore « Que vous inspire l’anniversaire de l’effondrement du toit de l’aérogare 2 E ? » ou bien « Sait-on qui est ce fameux mort de 2004 que personne n’est jamais venu réclamer ? », le gourou répondait avec ravissement : « La lumière ! Suivez la lumière ! » Et les journaleux consignaient aussitôt l’info avec componction. Le deuxième groupe, si l’on considérait que l’Architecte était en tête de la course, présentait exactement la même structure, un meneur qui rassemblait des baveux et des courtisans, et deux ou trois parasites. Il suivait de peu Envieu. Au centre, une sorte d’imprécateur illuminé, un sourire carnassier vissé une fois pour toutes, Philippe de Voilier, martelait, sur un ton faussement doucereux, on sentait que le bonhomme avait envie de hurler mais son éducation ne le lui permettait pas, il martelait donc sa « révélation » : Roissy était truffé de mosquées secrètes. La direction le savait et, complice, elle se taisait ; mais lui parlait, il brisait l’omerta, il n’avait pas peur de dire ce qui se passait car lui avait vu, personnellement, de ses yeux vu des mosquées partout, près des pistes, dans les sous-sols, les vestiaires, les aires de repos, il les avait même comptées, il y en avait vingt-cinq ! VINGT-CINQ lieux de cultes pleins de barbus analphabètes ; Roissy devenait une annexe de La Mecque, s’étranglait-il ! Mais que faisait la police ? La police justement, la gendarmerie plus exactement, était au centre du troisième cénacle qui arpentait le même espace ; un officier de la GTA, Gendarmerie des transports aériens, qui refusait de donner son nom, « On joue collectif, nous ! » clamait-il, en visant on ne savait trop qui, annonçait avoir démantelé une bande de bagagistes véreux, membres de la société « Trap/piste », dénomination parfaitement idiote, soit dit en passant. Ces employés donc pillaient sans vergogne les bagages les plus ostentatoires. Le pandore précisait qu’on avait retrouvé dans la voiture du chef de la bande 80 paires de chaussures de luxe. « 80 paires, vous imaginez ? » s’indignait l’uniforme. On ne savait pas trop si c’était le nombre, ou le fait qu’il s’agisse de chaussures, qui l’énervait ainsi.
Vera, toujours aux aguets, et déçue de n’avoir pas vu son Mehdi, renonça à tout saisir de ce maëlstrom et passa à l’étage Arrivée. Elle tomba sur un autre type d’agitation, pareillement confuse. Deux manifestations venaient d’y éclater à peu près en même temps, mais apparemment sans rapport. Des chauffeurs de taxis, en colère contre les flics qui vérifiaient avec un peu trop de zèle leur horodateur, bloquaient une des portes au cri de « Non au harcèlement ! Liberté de travail ! » De premiers gnons avec des policiers étaient échangés alors qu’à une centaine de mètres à peine, à l’arrivée d’un vol de Tel Aviv, débarquaient des militants pro-palestiniens ; ils avaient été retenus par les autorités israéliennes pour leur participation à une flottille de solidarité avec Gaza. Ils étaient accueillis par leurs partisans aux cris de « Palestine vaincra », lesquels suscitèrent aussitôt dans l’assistance quelques « Israël vivra ». Le ton montait, des biles s’échauffaient, des coups se préparaient. A l’écart de cette cohue, un représentant d’une firme suisse ( si l’on se fiait à son badge) brandissait, tout seul, une feuille où il avait griffonné : « J’ai égaré un colis ; 40x40, emballage papier kraft ; il contient de l’iode radioactif ; merci de m’aider à le retrouver … » Mais il avait le plus grand mal à se faire voir, bousculé qu’il était, et sa pancarte itou, entre des mouvements de foule divers.
Toujours pas de Mehdi en vue. Vera retourna au rez-de-navette. Au pied d’un ascenseur était adossé un homme sans âge, visage imberbe, presque poupon, qui portait, pour tout vêtement, si l’on pouvait dire, un tee-shirt ample et des bas de femmes. Personne ne semblait lui prêter la moindre attention, même si les passants le mataient l’air de rien. La jeune femme retrouva enfin Pif ; celui-ci la salua à peine et lui désigna, au centre du hall, plusieurs membres de l’état-major de l’aéroport en grande discussion ; ces gens d’ordinaire impavides, professionnels à sang froid, étaient agités comme des traders devant une manif d’indignés. Mehdi traduisit : « Ils viennent d’apprendre l’arrivée, de Vienne, je crois, de 300 Tchétchènes sans-papiers. 300 d’un coup, ça fait beaucoup ! »
Chapitre 22
C’est la deuxième fois que je viens à Pau en avion, c’est toujours aussi agréable. Aujourd’hui, des masses de nuages recouvrent les Pyrénées, seuls émergent les pics acérés. Les Espagnols parlent de « Sierra », littéralement des « scies ». C’est exactement ça : les Pyrénées, de l’Atlantique à la Méditerranée, c’est une scie. Pau fait partie de ces aéroports de province, comme Lorient, Brest, Biarritz, Grenoble, où on a l’impression, en arrivant, que tout le monde se connaît. Rien à voir avec l’anonymat de Roissy-Charles de Gaulle ou d’Orly.
Daniel Dubar m’attend. Il n’a pas eu besoin de brandir une pancarte avec mon nom. Les flics ont un sixième sens. Je ne le connaissais pas mais Bati m’en avait parlé ; je l’ai reconnu tout de suite. Grand, plus d’un mètre quatre vingt cinq, dans les quatre vingt dix kilos, un physique agréable, l’impression d’avoir une barbe de trois jours alors qu’il a dû se raser ce matin ; les cheveux bruns, frisés. Le genre à aimer le rugby, les bonnes bouffes entre copains. Sa poignée de mains est franche, le tutoiement aussitôt adopté :
– Tu prends un café ?
– Non je viens d’en prendre déjà deux.
– Ok, alors on y va ! C’est à une demi-heure.
En route, Dubar me demande des nouvelles de Bati :
– Il va très bien. Tu as longtemps travaillé avec lui ?
– Huit ans, les huit années que j’ai passées à la brigade. On n’était pas dans le même bureau mais on a travaillé dans le même groupe. C’est un numéro… mais un très bon flic.
– Je le pense aussi.
– Il a toujours derrière lui la fameuse affiche vantant la méthode PIPE ?
– Non. C’est quoi cette méthode ?
– PIPE ? C’est : Pas d’Initiatives, Pas d’Emmerdes !
-Il a évolué. Maintenant, derrière lui, il y a des reproductions de Courbet et de Van Gogh. Un sexe féminin, une oreille coupée. Lorsqu’il interroge des prévenus, il se tient tout près de ces images de sorte que le regard de ses invités tombe sur ces tableaux…
– Bati est devenu philosophe avec le temps, je vois. Maintenant, dis-moi, pourquoi m’a-t-il demandé de te recevoir ? En quoi l’histoire d’un zigue qui a cramé dans une caravane sur mon « territoire » peut t’intéresser ? Car tu es bien venu pour ça, non ? Bati m’a juste précisé que tu savais des « choses » qui pourraient m’être utiles. C’est vague.
– D’abord, merci de m’accueillir. Je n’ai pas parlé de cette visite au Juge, on est là entre collègues, histoire d’échanger, c’est tout. Comment te dire ? Je suis sur une affaire qui ne me plaît pas beaucoup.
– Tu m’expliques ?
– Disons que plus j’avance, plus j’ai des emmerdes. D’abord, un des prévenus, un certain Riquet, est retrouvé mort à Roissy. Il est question d’accident. Un petit trou dans l’oreille. Tu parles ! On peut toujours se dire que le gonze est tombé à la renverse et s’est pris un tournevis dans le pavillon, ou un gros clou qui dépassait. Mais ça tient pas longtemps. On apprend vite qu’il s’est fait buter, un coup de poinçon. Comme au temps des Apaches ! Du boulot de professionnel, non ? Tu fais pas ça sur un coup de colère, faut de la préparation, du savoir-faire, pas vrai ?
– C’est clair.
– Bon, je te passe les détails. Un autre témoin, peu après, disparaît avant son audition. Pas moyen de lui remettre la main dessus. Où il est passé ? Mystère ! Sa famille panique. Il avait rendez-vous au siège de la BRDE avec moi. Volatilisé !
– C’est une affaire qui concerne Air France ?
– Oui, pardon, j’aurais dû commencer par là : le CCE d’Air France, partie civile, a été victime de surfacturations dans la location et surtout l’achat d’appartements ; cette pratique a duré cinq ans, le dernier achat a été conclu il y a trois ans.
– Ça monte à combien ?
– Le total des achats s’élève à 20 millions d’euros.
Mon chauffeur siffle, admiratif.
– Jolie somme !
– Oui, assez jolie somme, en effet. Et je crois bien que l’intermédiaire, un certain Franck Romin, celui par qui sont passés les chèques, le médiateur numéro un, ce pourrait être ton gus, je veux dire : c’est certainement celui qui a brûlé dans la caravane.
Dubar se tait, il attend la suite.
– Ce citoyen a du réaliser une plus value entre 10 et 12 millions d’euros. Il a été très difficile de le retrouver. On a fini par le localiser, à Pau, ruiné, vivant dans une roulotte. On pense donc l’auditionner, perquisitionner chez lui, enfin dans sa remorque... Mais on a à peine le temps de prendre cette décision qu’on apprend que son véhicule vient de brûler. Et lui avec, très certainement. Bizarre, non ?
Le collègue digère l’info. Il conduit tout en douceur. Pendant qu’on sort de la ville, il me relance :
– Mouais. L’incendie nous a été signalé, je vais t’en dire deux mots. Mais si je résume ton affaire, on a donc un gus qui claque, un autre qui s’évapore avant son audition et un troisième larron, richissime puis lessivé, qu’on retrouve – si c’est lui !- cramé dans sa caravane.
– Bati, mon maître, me dit : « ça pue »
– Il a pas tort.
Au terme d’un trajet relativement rapide, nous voici stationnés en face d’une ferme imposante, en forme de U, avec un bâtiment d’habitation, des halliers pour le foin, des écuries, le tout encadrant une grande cour centrale. De l’autre côté de la route, comme un étron dans le décor, trônent les restes calcinés de ce qui a du être la caravane de Franck Romin. A part la ferme, la première maison en vue doit se situer à 800 mètres, peut-être plus. Tout autour de nous, il n’y a que des champs, des bosquets, la campagne, quoi, la vraie, la profonde. Dubar explique :
– Avant-hier, vers trois heures du matin, le couple de paysans qui habite ici a été réveillé par les aboiements du chien. Leur chambre donne sur l’arrière de la maison, sur les champs. Le chien était très agité, pourtant ils ont mis du temps à comprendre que quelque chose de grave se passait. Ils sont sortis dans la cour et ils ont vu la caravane de leur locataire en flammes. Ils ont appelé les pompiers. Ceux-ci n’ont rien pu faire. Le feu avait pratiquement tout consumé.
Je l’interromps :
– Personne d’autre n’a vu ces flammes ? Je suppose qu’une caravane qui brûle, ça doit faire un sacré bûcher, non ?
Je comprends à son regard que j’ai déconné. Quand on mène une enquête, on n’aime pas qu’un étranger, même un collègue, puisse soupçonner qu’on n’a pas fait un bon travail.
– Tout d’abord, cette nuit là, il y avait un léger brouillard, donc, si tu veux, c’était pas la visibilité d’une nuit de pleine lune. Et puis le couple de paysans en question, tu vas voir, c’est pas vraiment des jeunots ; ils ont 70 ans passés, ils vivent seuls.
– Seuls ?
– C’est classique dans le coin. Les enfants ne veulent pas trimer toute leur vie pour gagner moins que le SMIC. Ils préfèrent partir travailler en ville ; ils sont à Lourdes, je crois, mais je ne sais pas ce qu’ils y font. Peut-être que la chanson de Ferrat, tu sais, la Montagne, s’applique aussi à la campagne.
Dubar sourit et continue :
– La seule chose qu’ils m’ont dite, c’est que le soir précédent, en rentrant du village où le pépé avait fait sa partie de cartes, l’aïeul a remarqué une grosse voiture noire garée sur le chemin, là-bas. D’après lui, c’était une Allemande.
– Pourquoi une Allemande ?
– Pour notre grand-père, il semble que toutes les grosses voitures noires soient allemandes et elles ne peuvent être que des Mercedes. Il ne sait pas que depuis la guerre, il y a aussi Audi et BMW qui font des véhicules. Non, pour lui une grosse voiture noire, c’est une Mercedes, point.
– Je vois.
– Quand les pompiers sont arrivés, je t’ai dit, il n’y avait plus rien à faire. Juste constater qu’il y avait un corps calciné à l’intérieur des restes de l’habitacle.
D’un dossier qu’il garde sous le coude, mon hôte me montre des photos. De grands clichés, 21x29 cm, réalisés par l’Identité judiciaire. J’ai toujours été bluffé par le travail des photographes de la PJ. C’est précis, hyper cadré, sans fioriture, sans jamais chercher à faire joli. C’est la mort, en gros plan, obscène et envoutante, c’est un PV en images, si j’ose dire. A cette différence près, c’est qu’on aura du mal à trouver de l’attrait à un compte-rendu alors que pour moi, ces photos, en règle générale, sont plutôt belles. Mais je me garde bien de le dire, je passerais pour un pervers. Ici, le corps humain est parfaitement reconnaissable. Comme tous les brûlés, il ressemble à un morceau de charbon. On devine la tête, les bras, le torse. De l’intérieur du véhicule, il ne reste rien, tout a disparu, emporté par le feu. Je regarde les images, j’attends les commentaires de Dubar.
– Evidemment, le bonhomme est tout ratatiné mais on voit bien qu’il est sur le dos, les bras en croix, comme s’il dormait. C’est assez étonnant pour quelqu’un qui se trouve dans une caravane en feu.
Je le remercie intérieurement de cette remarque :
– Quand est-ce que tu auras les résultats de l’autopsie ?
– Le corps a été envoyé à Lourdes.
Je me garde bien de toute allusion laïque, ça pourrait être mal pris.
– Dès que j’aurai des infos, je te ferai signe ; et si le parquet décide d’ouvrir une information, tu en seras averti.
Le couple de paysans vient d’apparaître devant leur ferme. Difficile de leur donner un âge, 70 ans ? 75 ? 80 ? Plus ? Ils sont ridés, leur visage ressemble à un dessin esquissé à grands traits, avec des plis au front, aux coins des yeux et de la bouche, à partir des ailes du nez, on dirait de beaux fruits mûrs. Je regarde leurs mains. Les mains, disait mon père, montrent quelle a été la vie d’un homme, ou d’une femme. Les mains de ces paysans sont enflées par le travail ; ils ont du trimer dur pour arracher à la terre leur subsistance. Curieusement, je me dis que ce ne sont pas les mains de responsables de la FNSEA (Fédération Nationale du Syndicat des Exploitants Agricoles), eux qui finissent leur carrière Ministre ou Secrétaire d’Etat ou au minimum députés…
Ces mains, cette ferme, mon père... Voilà que je régresse vitesse grand V, je me souviens. Je devais avoir 14 ou 15 ans et j’aidais mon vieux. Il était ouvrier agricole. La dureté de ce genre de vie est difficilement imaginable pour un citadin, aujourd’hui. Si bien que je n’en parle à personne, même pas à Hélène. Mais c’est cette vie qui m’a durci. Les rapports avec les animaux de la ferme pouvaient parfois être d’une violence incroyable. Mon père élevait, pour un patron, près de 800 porcs, dans une trentaine de loges et deux grands enclos. Deux fois par jour, il fallait nourrir la troupe. Mon géniteur n’avait que le dimanche après midi de repos. Ce jour-là, les animaux avaient donc double ration le matin mais il arrivait qu’en fin d’après midi certains s’énervent, ils avaient faim. Ils s’en prenaient alors à un de leurs semblables et c’était toujours le plus gros. Agacé, harcelé, traqué, mordu, incapable de se défendre face au groupe, il pouvait mourir de crise cardiaque. S’il arrivait à entendre les cris de la bagarre, mon père débarquait avec un manche de pioche et brisait les groins de tous les cochons de la loge pour les empêcher de mordre. Il y avait un autre cas de figure, si j’ose dire : un animal pouvait prendre le vice de mordre la queue d’un congénère jusqu’à lui arracher le cul et il s’attaquait ensuite aux entrailles, qu’il pouvait tirer comme on dévide une bobine de fil. Avant qu’on en arrive là, mon père isolait l’agresseur qu’il tenait serré entre ses cuisses, il lui casait une barre de fer dans la gueule ou pouvait lui casser les dents à coups de marteau. Et moi, avec un gros bâton, je devais protéger le père du reste de la meute, surexcitée, en frappant aussi fort que je pouvais sur leurs têtes, leurs flancs, leurs cous. Je me disais : père, garde-toi à droite, père, garde-toi à gauche. Tout ça faisait un vacarme épouvantable, les cris, les coups, ce bruit infernal me résonne aujourd’hui encore dans le crâne…
Je redescends sur terre, j’oublie mon père, la porcherie, l’orgie des cochons ; personne n’a remarqué mon « absence ». Daniel Dubar s’avance vers le vieux couple :
– Bonjour Monsieur Bonnefous, bonjour Madame. Comment allez-vous ?
Les deux vieux se regardent, répliquent :
– Très bien, Monsieur le policier. qu’est-ce qui se passe ?
– Routine. Nous revenons pour terminer notre dossier. Est-ce qu’il y a quelque chose que vous auriez oublié de me dire depuis avant- hier ?
Le petit vieux consulte sa femme :
– Non, rien de nouveau, mais j’insiste : il y avait une voiture, une grosse voiture noire, une Allemande ! J’en suis sûr, une Mercedes.
Sa femme se tourne vers lui :
– Mais comment tu le sais que c’est une Mercedes ?
– Mais je les reconnais les Mercedes.
– Oh toi, à part les tracteurs, tu n’y connais rien en voiture.
Dubar me regarde, sourit.
– Bon, écoutez, si vous vous rappelez de quelque chose d’autre, vous avez mon numéro de téléphone. N’hésitez pas à m’appeler.
Sous les yeux des vieux qu’on laisse après les salutations d’usage, on se dirige vers l’endroit où la fameuse Allemande aurait stationné. Sur le chemin, Dubar me répète :
- Le couple Bonnefous louait un morceau de terrain avec la caravane, laquelle était branchée sur le tout électrique. Il n’y avait pas de gaz. Donc il ne peut s’agir que d’un court circuit… ou bien alors… d’autre chose.
Il se tait, je ne réagis pas. Je ne veux pas faire des remarques qui l’indisposeraient. Au lieu indiqué par Bonnefous, des traces de pneus sont parfaitement lisibles. Dubar, sans me regarder, précise :
– Le moulage a été fait, on va voir ce que ça donne. Les empreintes sont assez claires. J’espère que ce ne sont pas les pompiers ou d’autres véhicules qui les ont laissées.
On retourne vers notre voiture. Autour de la caravane, l’herbe a été brûlée et piétinée. Les pompiers ont fait leur boulot et n’ont pas pensé que les policiers allaient, peut-être, essayer de trouver ici des indices. Comme d’habitude, ils ont paré au plus pressé et essayé de sauver ce qui pouvait l’être. Il me semble qu’il n’y a rien d’autre à faire. J’ai dit à Dubar ce qui me semblait important. A lui de jouer.
– Je vais attendre le résultat de l’autopsie. On va déjà voir si c’est vraiment Romin qui était là. Je te tiens au courant. Maintenant, je ne sais pas s’il y aura assez d’ éléments pour écarter la thèse de l’accident et déclencher une enquête plus approfondie ?
Je soupire ; il y a décidément quelque chose qui ne me plait pas là-dedans. Avec Dubar, on se comprend sans avoir besoin d’en rajouter.
– Ton avion est à quelle heure ?
– Seize heures.
– On va déjeuner. Il y a un petit resto dans le coin, tu verras.
L’endroit ne paye pas de mine mais le ventre du patron plaide pour une connaissance approfondie de la nature humaine.
– Ici c’est une cuisine simple, traditionnelle, me souffle Dubar. Je te conseille une viande au feu de bois.
Je lui fais confiance.
– Et est-ce que tu connais les Madiran d’Alain Brumont ?
– J’en ai entendu parler mais je n’en ai jamais bu.
– Les produits des Brumont sont d’une complexité et d’une finesse qui égalent les grands Bordeaux. Sauf qu’ils sont cinq fois moins chers. Je te propose, plutôt que le Château Bouscassé, un Montus 2005.
– Je te suis.
Je ne le regrette pas.
A côté de nous, des Anglais descendent avec constance et régularité des tonneaux de bière. Je pense à Alexandre Dumas, dans « Les trois mousquetaires » ou « Vingt ans après » ; à propos des insulaires, il parlait de « ces êtres vulgaires, comme tous les buveurs de bière ». J’aurais aimé connaître Alexandre Dumas.
Chapitre 23
Roissy CDG.
« Le point faible de la sécurité, c’est le personnel de sécurité ! » répétait Mehdi. Ce matin-là, histoire de prouver qu’il ne parlait pas pour ne rien dire, le sécuritaire-fouilleur-palpeur « àlacégette » conduisait Véra, au volant d’une camionnette de SécuFrance, jusqu’au parking des airbus A 380. « Normalement, c’est interdit » murmura-t-il, un brin vaniteux. Un de ces monstres était au repos, le 12h30 de Montréal, qui venait à peine de se vider de ses passagers. En escaladant une double volée de marches, Pif affichait un sourire de lou-ravi et, les bras tendus vers le fauve, il s’exclama : « L’A380 ! Deux étages. 538 places. Mach.85 ! » Il avait l’air fier de la bête, comme s’il en avait été le concepteur.
Elle le regardait s’agiter et ça lui faisait un bien fou, ça la rassurait. Elle en oubliait presque ses idées noires, elle qui se voyait persécutée par le type de la mine notamment. Vera en effet était sûre qu’il était revenu. Elle hésitait à en parler à Pif, il l’aurait encore traitée de parano. Pourtant l’autre soir, en rentrant « chez elle », elle avait vu quelqu’un traîner dans l’impasse, se contemplant dans le miroir. C’était peut-être pas lui, après tout, mais disons qu’il lui ressemblait salement. Elle n’avait guère eu envie d’aller y voir de plus près, de s’approcher du gonze pour lui demander ses intentions...Vera s’était éclipsée mais elle se disait que l’autre n’était pas du genre à lâcher le morceau. C’était là, sur la placette, qu’il l’avait perdue de vue, c’est de là qu’il allait repartir en chasse. Dans la peau du gibier, elle voyait le prédateur partout.
Indifférent aux angoisses de son amie, Pif vibrionnait sur l’escalier d’accès au mastodonte. Difficile d’imaginer, pour qui ne le connaissait pas, que ce gaillard, fou d’avions, n’avait jamais volé. Trop peur. Il pouvait parler des heures durant de toute la gamme des Boeing et des Airbus, de l’Embraer 145, de l’ATR 72, du Bombardier CRJ 1000, de l’AVRO RJ 85 ; il connaissait par cœur à peu près toutes leurs coordonnées techniques, longueur, envergure, nombre de sièges, vitesse de croisière ; il était capable d’ergoter sur les mérites réciproques des engins russes, américains ou européens, avouant en dernier ressort que son chouchou, c’était le 3 fois 7, le 777 de Boeing. Bref, il était incollable et pourtant, … il n’avait jamais pris l’avion et ne le prendrait sans doute jamais : il en avait une trouille carabinée, et entretenue. Son héros était un certain Eric Moody, pilote de la British Airways : alors qu’il survolait, en 1982, un volcan d’Indonésie, tous les moteurs de son avion tombèrent en panne. Il adressa aux passagers ce message, que Pif connaissait par coeur et se remémorait avec la ténacité d’un bon sado-maso : « Mesdames et messieurs, c’est votre capitaine qui vous parle. Nous avons un petit problème. Les quatre moteurs de l’avion se sont arrêtés. Nous faisons tout notre possible pour en reprendre le contrôle. J’espère que vous n’êtes pas trop inquiets. » La dérive dura un quart d’heure mais Moody réussit un atterrissage d’urgence près de Djakarta. PIF ne ratait jamais les émissions sur les catastrophes aériennes, collectionnait avec minutie les coupures de presse sur le « Korean Airlines » de 1983, le « Mont Saint Odile » de 1992 ou encore le « Charm El Cheik » de 2004 et confessait volontiers une émotion toute particulière pour le « Rio-Paris » de 2009. Une dégringolade de 12 000 mètres en quatre minutes et 22 secondes. Là encore, comme un acteur qui connaît parfaitement son texte, il pouvait ressortir sans peine tous les échanges entre pilotes de l’Airbus en perdition :
– On a perdu le contrôle de l’avion, on comprend rien, on a tout tenté, on n’a plus aucune indication qui soit valable...
– Qu’est-ce que vous en pensez ? Qu’est-ce qu’il faut faire ?
– Je ne sais pas, là ça descend...
– Tu descends...Stall, stall ... Je suis en train de descendre, là ? Non tu montes, là... Stall, stall... Là, je monte. OK, alors on descend. Stall, stall... »
Ce dialogue l’emplissait d’effroi. Il lui était même arrivé, un week-end où il n’avait rien d’autre au programme, de se rendre au Père Lachaise, pour se recueillir devant l’alignement des monuments funéraires consacrés à ces crashes, à deux pas du Mur des Fédérés.
Ce jour-là, l’A 380 s’offrait un lifting. Des agents d’entretien allaient le récurer et des mécaniciens l’inspecter ; tout ce petit monde, une douzaine de jeunes gens, bavardaient, au rez de chaussée de l’appareil. Mehdi semblait tous les connaître. Personne ne s’étonna de la présence de Vera, elle était avec Pif et ça suffisait. Quelqu’un parlait d’appel syndical, de grève, Pif se mêla un instant à la conversation. Puis le couple s’éloigna ; Mehdi fit visiter les lieux. Au premier étage, en classe Affaires, chaque fauteuil semblait à la jeune femme aussi vaste que les plus grands lits qu’elle avait pu connaître. Elle s’accrocha au cou du garçon et le déséquilibra. Ils chutèrent. « Je vais te trousser, Mehdi » lui glissa-t-elle à l’oreille. « C’est dans Meckert que t’a appris ce mot ? » répliqua le garçon. La question resta sans réponse. D’ailleurs, il avait déjà oublié ce qu’il venait de demander, trop occupé à se laisser faire.
Chapitre 24
Dimanche soir. Je suis seul dans l’appartement, j’attends le retour d’Hélène. Son laboratoire pharmaceutique lui a offert deux jours de thalasso en Bretagne, au Croisic ou quelque chose comme ça, un centre Louison Bobet. Hier j’ai reçu d’elle un SMS que j’ai du relire dix fois, au moins : « Envie de toi. Laide sans toi. Femme qu’avec toi. »
Frédéric Mordanti, dit Teddy, m’a apporté jeudi un jeune lièvre qu’il a chassé dans la Crau. Il vient régulièrement à Paris à des réunions de son syndicat, la CGT de la SNCF ; avec sa voix nasillarde, due à un nez astronomique, il m’a dit :
– Tiens ! Et pour le sang tu verras avec ton boucher !
Il croit qu’à Paris, les bouchers sont comme dans nos villages, des amis de l’école maternelle... Malgré tout, je me suis débrouillé. J’ai réussi à avoir une tasse de sang de cochon. Hier, j’ai préparé la marinade. La recette que je vais faire est celle de Michel Herrero, grand chasseur devant l’Eternel. On organisait régulièrement chez lui, quand j’étais encore à Marseille, après les parties de cartes, et avec les deux autres Michel, Muller et Fauré, des soirées de bouffe gibier absolument mémorables. A Paris, ça me manque terriblement. La recette ? La première chose à faire, c’est mettre dans la marinade une bouteille et demi de Côtes du Rhône, un Coudoulet de Beaucastel par exemple. L’erreur à ne pas commettre, c’est de prendre un mauvais vin sous prétexte que c’est une marinade. Faute, ânerie, boulette... Je choisis donc un excellent Côtes du Rhône, j’ajoute deux carottes coupées en rondelles, une tranche de céleri en morceaux, deux oignons en rondelles également et un bouquet garni. J’ai laissé mariner la viande toute la nuit, ajouté du poivre en grains, du poivre moulu, un trait de vinaigre et un peu d’huile d’olive. Les morceaux ont été recouverts et surtout, surtout… pas de sel. Herrero me l’a bien répété quand il m’a appris à faire ce civet, surtout pas de sel. Je lui ai demandé pourquoi.
– Tu demanderas à ma grand-mère.
– Et où elle est ta grand-mère ?
– Elle est enterrée depuis dix ans.
– Ah ? Mais tu lui as demandé, toi, à ta mamie ? Et qu’est-ce qu’elle t’a répondu ?
– Elle m’a dit que c’était comme ça.
Je ne comprends toujours pas pourquoi il ne faut pas de sel dans la marinade mais je ne la sale pas. En cette fin d’après-midi, je finis d’égoutter les morceaux dans une passoire. J’ai enlevé tous les légumes qui ont servi à mariner, j’ai mis de côté le jus. Tous les morceaux de lièvre ont été séchés avec un torchon. Herrero, lui, le cuisinait dans une grande poêle. Moi, je suis traditionaliste, j’opère avec une cocotte en fonte. Je commence à faire revenir les morceaux de lièvre mélangés à deux cent cinquante grammes de petit salé, à l’huile d’arachide - l’huile d’olive lui aurait donné un mauvais goût – quand la sonnerie de l’entrée retentit. Hélène entre. Splendide. Elle est en tenue de voyage, m’embrasse, regarde la table. Ses yeux brillent :
– Je prends une douche et je reviens.
J’ai à peine eu le temps de la respirer, elle a déjà disparu. Toujours au fourneau, je fais revenir quatre gros oignons. Ensuite, je rajoute les morceaux de lièvre et je fais cuire l’ensemble quelques minutes. J’ajoute quatre gousses d’ail émincé, je mélange bien, je verse une cuillère à soupe de farine et un demi-verre de cognac. Je flambe le tout.
Hélène réapparaît, avec une simple robe d’été, démaquillée, les cheveux en chignon. Elle ressemble à la première femme, celle qui était là tout au début du monde. Son regard pétille de malice. Elle me touche le bras, une décharge m’envahit. Cette femme m’électrise.
– Qu’est-ce que tu fais là ?
– Tu vois, un civet de lièvre.
– Tu ne l’as jamais fait ?
– C’est la première fois.
Elle perçoit mon trouble, le désir qui me traverse. Sa main caresse mon bras, elle fait semblant de s’intéresser.
– Raconte-moi.
– Et bien j’ai déjà fait le plus gros. Maintenant je vais rajouter le jus de la marinade dans la cocote, je mets à feu fort pendant cinq minutes pour faire évaporer un peu l’alcool du vin.
– D’accord. Et ensuite ?
– Et bien, ensuite je mettrai à petit feu, je rajouterai un bouquet garni et je vais laisser cuire. Quand ce sera bien cuit, je prendrai une louche du jus, je mélangerai une tasse à café de sang, et je l’ajouterai à la sauce, je touillerai le tout et j’arrêterai la cuisson.
– Ça a l’air très facile... Et qu’est-ce que tu nous a mis sur la table ?
– Un Château de Beaucastel, un Chateauneuf-du-Pape ; ma paye de lieutenant ne me permet pas d’avoir un Château Rayas. Tu devras attendre que je passe capitaine.
– Tout ça sent bon en tout cas.
Je la prends par les bras et lui murmure en lui baisant le cou :
− Je ne t’ai pas tout dit... Pour la cuisson, il va falloir attendre une heure.
Je commence doucement à la pousser hors de la cuisine vers le divan du salon. Elle me repousse faiblement en souriant.
– Mais qu’est-ce que tu fais ?
Je la couche, elle répète :
– Mais enfin, qu’est-ce que tu fais ?
Son sourire dit qu’elle a très bien compris le mode d’emploi, que je précise à tout hasard :
– Je t’ai dit qu’on avait une heure.
Je soulève sa robe ; je m’y attendais, elle est nue dessous. Mes lèvres suivent un chemin connu d’elles jusqu’à son sexe, mon origine du monde à moi. Elle a posé ses mains sur mes cheveux ; ma langue caresse en petits va et vient, elle soupire :
– Tu en auras passé du temps entre mes jambes.
Je fais l’étonné :
– Un reproche ?
Pour toute réponse, elle ramène, d’une légère pression de ses doigts dans mes cheveux, mes lèvres sur sa faille.
Chapitre 25
Roissy CDG.
Le hasard. De l’arabe az-zahr, le dé, aurait pu dire Mehdi, si on le lui avait demandé. Mais ce jour-là, Pif n’était pas là et le dé, lui, s’était arrêté sur le terminal Roissy2 F, porte 40… Au cours de ses interminables marches, Vera passait ici deux à trois fois par jour. Aujourd’hui, elle y croisa une longue liane blonde, fine, visage parsemé de taches de rousseur, chemisier court dégageant un petit ventre pas frileux, un bijou dans le nombril, mini-short en jean sur collants noirs, manteau sur le bras, une belle plante comme il en passait des légions dans ces couloirs mais l’instinct souffla à la Roumaine qu’il y avait danger. Trop tard, elle avait vu juste : la blonde était suivie de près par … Trico. Il y avait une chance sur dix mille, cent mille, un million pour que leur chemin se recroise ainsi. Une minute plus tôt, plus tard et ils se loupaient. La chance, ou plutôt la déveine, le hasard Baltazar !
Vera et le mac se découvrirent au même moment. Ils auraient très bien pu ne pas se reconnaître. Elle, avec son uniforme bleu, genre Armée du salut, était assez passe-partout. Et lui avait tout à fait la tête ailleurs : ses patrons le trouvaient négligent, ils le lui avaient fait comprendre. Et surtout leur réseau rencontrait sur Paris quelques problèmes. Le groupe de Brasov faisait turbiner les filles, une vingtaine, Boulevard des Maréchaux (18e et 19e) et au Bois de Boulogne (16e) sept jours sur sept. Pas question pour elles de refuser sous peine de se faire méchamment esquinter. Les cadences infernales dans les coins les plus sordides. Les filles devaient tout reverser à leur « fiancé », lequel réglait au clan, chaque jour, une taxe de rue. D’ordinaire, la journée, les femmes des petits chefs surveillaient leurs congénères et les proxos se planquaient. Les couples mac/pute, « fiancés », vivaient dans des conditions misérables, le plus souvent dans de petites caravanes qui offraient, pour tout confort, de vieux matelas et un chauffage au gaz. Les rapports dans le clan, chef/vassaux, père/fils, homme/femme, étaient violents. Avec un tel régime, les « Roumaines » cassaient les prix et raflaient les clients à leurs concurrentes plus installées, y compris Allée de Longchamp. Après le plombier polonais, la pipeuse roumaine. L’un dans l’autre, le groupe réussissait un assez joli chiffre d’affaires, un magot aussitôt rapatrié via Western Union à Brasov et investi dans l’immobilier local. Mais justement les « Brasov » faisaient un peu trop de jaloux, ça jasait dans le milieu, ça dénonçait à tout va et les flics commençaient à s’intéresser à cette prostitution « low-cost ». Bref Trico était légitimement soucieux, tout habité de pensées sombres. Et puis il y avait foule dans le hall Arrivée ce jour-là. Bref, le mac et son ex auraient effectivement pu se louper, ou faire semblant de s’ignorer, pourquoi pas, chacun après tout avait assez de chats à fouetter. Mais non ! C’était probablement trop simple. Il fallut que Vera, repérant le proxo, pousse un cri, un feulement rauque d’indignée, gesticule malgré elle, à son corps défendant, comme le dit si bien l’expression. Et l’homme de Brasov, lui, au lieu de regarder ses chaussures, de presser le pas en relevant le col, de pousser son petit cheptel vers la sortie, décida de jouer le justicier. Sfântu Gheorghe ! Par Saint Georges ! Véra était de retour ! Il allait donner une leçon à cette pute indocile, se dit-il immédiatement. Une fille qui s’échappe, c’était jamais bon pour l’autorité patronale et pour le moral des troupes. Il se voyait déjà se vanter, auprès de ses chefs, pour la correction donnée à la fuyarde. Devenu imprudent, car les douaniers n’étaient pas loin, les policiers non plus, oublieux de la fille dont il avait la charge, il se précipita sur la déserteuse. Il était puissant, redoutable mais elle connaissait le terrain mieux que lui. Elle prit la tangente vers le terminal 2E, slalomant entre des groupes de passagers et des équipages au grand complet, remonta en sens inverse de la marche un escalator pourtant bondé, heurta de plein fouet un amas de sacs et de valises, un monticule de deux mètres de haut, tous les biens que Diogène transbahutait à longueur de temps dans un équilibre improbable sur son caddy et qui s’éparpillèrent, elle poussa deux portes vitrées à la suite qui auraient du exploser sous le choc et qui résistèrent pourtant, se retrouva dehors, traversa une route à deux voies heureusement peu fréquentée à ce moment là, enjamba une barrière de protection, se retrouva sur une dalle. On devait être alors au dessus d’un parking. Elle sut tout de suite ce qu’elle allait faire ; elle n’avait plus le choix. Elle s’arrêta à un point très précis de cette surface bétonnée et vide, de la taille d’un terrain de football, elle se retourna, attendit. L’espèce de sanglier qui la pistait, haletant et concentré, fut très vite sur elle, se voyait déjà la saisir, la triturer, la déchiqueter, l’agonir. Déjà ses bras se tendaient vers l’infidèle. Au tout dernier moment, Véra s’esquiva, juste un petit pas de côté ; et lui tomba comme un con, la tête la première, dans un trou qui s’ouvrait au ras du sol et glissa, dans un certain désordre, un bras en avant, un autre qui se repliait et se brisa ; il termina au fond de ce tunnel, une canalisation d’aération de cinq ou six mètres qui était comme un entonnoir, coincé, la nuque cassée. Il était mort sans dire un mot.
Son corps désarticulé resterait bloqué près d’une semaine à la hauteur du faux plafond d’un bureau de gardien de parking. L’employé du sous-sol avait fini par remarquer des traces qui suintaient à travers les dalles plastifiées, au dessus de sa tête mais il avait laissé faire ; c’est l’odeur qui l’avait finalement alerté et permis de découvrir, dans un triste état, le citoyen Trico.
Exit Trico. Le monde se porterait mieux sans lui, et Vera n’en eut pas de remords.
Chapitre 26
En poussant la porte du bureau, j’ai dans les narines l’odeur du cigare de Bati ; pour une fois, il est arrivé avant moi. C’est sa journée trois pièces denim. Je lui serre la main. Il a l’air absorbé. J’ouvre la fenêtre et je me tourne vers lui :
– Dis-moi, morceau d’italien, si tu achetais des vrais cigarillos faits avec des feuilles de tabac et non avec des poils de cul de bouc.
Il me regarde, fait semblant de ne pas m’entendre et m’annonce tout de go :
– J’ai eu Dubar, mon pote de Pau, au téléphone.
Je contourne mon bureau pour m’asseoir :
– Tu m’intéresses là !
– Il m’a commenté les conclusions de l’autopsie. Le gars incendié, c’est bien Romin. Le schéma dentaire est formel. Avant que ton bonze ne soit transformé en charbon à bois, il a eu droit à une petite opération à l’oreille, si tu vois ce que je veux dire, genre introduction d’une tige rigide, de 10cm environ. Conclusion : il était mort lorsqu’il a été cramé. Pour moi, il ne s’est pas suicidé.
– Limpide !
– Et puis ton paysan papi, tu te souviens ? Figure-toi qu’il avait raison.
– Bonnefous ?
– Papi Bonnefous, oui. Le moulage des pneus a révélé qu’il s’agissait de pneus Continental, dimensions 225/55R16. Ce sont des pneus de série qui équipent les Mercedes classe E et S, 6 et 8 cylindres en V moteurs, 3 litres 5 à 5 litres. En moyenne 300 CV sous le capot.
Bati attend que je lui pose des questions. Je rentre dans son jeu :
-Tu as d’autres analyses, camarade ?
Il se lève, tourne comme un ours en cage :
– Matéo, on a affaire à un tueur droitier. Le corps a été trouvé sur le dos. Romin a probablement été maintenu au sol dans cette position. Peut-être a-t-il été frappé auparavant mais les ecchymoses ne se voient plus dans son état. Le tueur l’a sans doute immobilisé avec les genoux sur la poitrine, il lui a plaqué le visage au sol et lui a enfoncé le tournevis ou un engin proche dans l’oreille gauche.
Bati marque un temps d’arrêt, tête le bâtonnet qui lui tient lieu de cigare, en vain car l’objet hideux est éteint ; il poursuit en me regardant sans vraiment me voir :
– Je repense tout d’un coup à Argentino. A mon avis, on ne retrouvera jamais son corps. Je parie que le tueur l’a transformé en pâté et qu’il a été avalé par des chats ; ou alors il a été balancé au zoo de Vincennes, en chair à fauve.
– Vincennes est fermé !
– Alors c’est les chats qui ont gagné. Et manque de pot pour Argentino, tu me diras, il s’en fout un peu là où il est : c’est « la quenelle » qui enquête sur sa disparition.
– Qui ça ?
– Jean-Yves, dit « la quenelle », un camarade, de la promo 68.
– Qu’est-ce que ça signifie, « la promo 68 » ?
– Matéo, je sais bien que tu étais dans les couilles de ton père en mai 68, mais figure toi qu’il y a eu certains événements, en France, alors, qui ont eu des conséquences sur la police. En 68, notre administration a ouvert 400 postes et il y a eu 258 prétendants. Autant te dire que même un bourricot avec trois paires d’oreilles aurait été reçu et notre ami « la quenelle » faisait partie de cette promo 68. Je précise que je suis, moi, de la promo 67...
– Mais comment il s’appelle, ton mec ?
– Je ne me rappelle plus son nom exact. Nous, on l’a toujours appelé la quenelle.
– Et pourquoi ?
– J’ai pas trop cherché à approfondir, prétend le Corse avec une parfaite mauvaise foi, mais à mon avis, ça a sans doute à voir avec ses orientations sexuelles, si tu vois ce que je veux dire…
– ?!
– Enfin bref, c’est comme ça et donc pour nous, pour ceux qui sont à peu près de sa génération, Jean-Yves, c’est pas Jean-Yves, c’est la quenelle.
– Mais est-ce que c’est un bon flic au moins ?
– Tu parles, il ne trouverait pas d’eau dans la mer.
Je me lève à mon tour, je regarde par la fenêtre, la rue est déserte, pas une bagnole, à croire que tous les riverains se sont tirés. Seul un taxi en maraude cherche le client. Je ne me sens pas à l’aise. La tournure de cette affaire m’inquiète.
– Tu veux que je te dise, Bati, avec la mort de Romin, « ils » nous ont coupé tous les ponts. Voilà ce qu’ils ont fait, ils nous empêchent de remonter aux bénéficiaires des surfacturations des apparts du Canet. Et le pire, c’est qu’ils ont l’air rudement bien informés ! Comme s’ils avaient chaque fois un coup d’avance... Regarde : on se met sur l’enquête et Riquet casse sa pipe. On cible Argentino : Argentino s’évanouit. On repère Romin : Romin est réduit en cendres. Qu’est-ce qui nous reste ? Bartani ? Il nous a dit ce qu’il savait ; l’argent déposé à la banque de Montrouge a été récupéré ; la banque en Angleterre a été fermée. Je te jure : on nous coupe l’herbe sous les pieds, mon vieux. C’est la politique de la terre brûlée. On nous épie, on connaît notre jeu et on nous fauche nos pions ! Il nous reste plus personne. Sauf Napolèse.
– Attends Mateo, si Napolèse n’a pas disparu, il y a deux solutions : soit il ne sait rien et c’est peu probable. Soit il fait partie des décideurs qui ont envoyé le tueur. Mais à quoi ça servirait de le convoquer maintenant ? Tu peux me le dire ? Que peut-on lui reprocher précisément ? D’avoir été un con dans la gestion du CCE ? et un brillant administrateur une fois qu’il est arrivé à Visit France ?
– Il y a le licenciement déguisé d’Argentino ? On peut toujours le lui mettre sur le dos ?
– Arrête, ça va chercher quoi en correctionnelle, Mateo ? Avec son casier vierge, ce sera une peine symbolique.
– Et le dossier JetCo en Corse ? Faudrait peut-être qu’on aille y voir de plus près ?
– Mateo, je vais faire faire des économies aux contribuables français. A mon avis, pas la peine d’y aller. En Corse, tout se sait. Là bas, il y a de tout. Des partis de gauche, des partis de droite, des nationalistes, des modérés, des « canal historique », il y a même une espèce en voie de disparition : les radicaux de gauche. Au fait, sais-tu la différence entre un radical et un libéral ?
– ?!
– Un radical est un libéral qui ne va pas à la messe.
– C’est de qui ?
– De Jaurès ou d’un de ses amis. Bref, figure-toi que sur mon île, tous ces braves gens s’écharpent régulièrement entre eux, mais lorsqu’ils ont affaire à un étranger, quand il s’agit d’un « pinzutu », alors là, ils se mettent tous d’accord. Et donc, s’il y a un baisé, ce sera lui ! J’ai passé quelques coups de fil, en toute discrétion, et il ressort qu’en Corse, tous les hôteliers savaient que le CCE se faisait avoir. Mais du moment que c’était le CCE d’Air France, on s’en foutait. Et figure-toi que messieurs Napolèse et Riquet avaient acheté, dans un complexe édifié par le patron de JetCo – celui-là même qui organisait les vacances pour le CCE - deux appartements à moitié prix ; des appartements estimés actuellement à 100 000 euros et qu’ils ont eu pour 30 000. Tu vois, c’est pas la peine d’y envoyer une escouade de flics pour arriver à cette conclusion.
– Tu es en train de me dire qu’en échange d’un chiffre d’affaires garanti à JetCo, Napolèse et Riquet ont eu leur récompense ? On verra bien comment la juge va qualifier cela mais c’est pas tellement ça qui nous intéresse.
Je me rassois, je laisse le silence s’installer. Bati s’acharne à rallumer son espèce de racine, sa tubercule malodorante, mais elle résiste, c’est bien pour moi, mais lui s’agace. Je repars à l’attaque :
– Dis-moi Bati, vue la tournure des événements, il vaudrait mieux qu’on passe l’affaire à la crim’, non ?
Il fronce les sourcils.
– Petit, cette affaire on l’a, on la garde et on la mène jusqu’au bout ! Tout n’est pas fini. Dans les pièces que m’a données Daniel Celce, il y a également tous les documents concernant l’achat de lits en Autriche : 10 millions d’euros. La somme est énorme. Il apparaît que cet argent a été versé par chèque à la société MOZART dont le siège social est à Salzbourg et l’unique actionnaire en est le sieur Romin. Celui ci ensuite a acheté, pour le CCE, 135 semaines en time share. Donc, on va demander une commission rogatoire à madame la juge ; ainsi on va pouvoir accéder aux comptes de la société que Romin a créée en Autriche et sur laquelle a été versée la totalité des chèques, les 10 millions en question. La surfacturation ici est au minimum de 50 %. On va bien finir par savoir qui ont été les bénéficiaires de cette putain de somme !
– Bati, tu m’étonneras toujours. Ceux qui disent que tu es un bourricot, je ne les ai jamais crus. Tu es un génie, tu es le Sherlock Homes de la BRDE !
– Petit, je peux te donner un conseil ?
– Bien sûr, Sherlock
– Va te faire tâter la raie. En attendant, moi, je te suggère d’aller voir le boss puis de bigophoner à la juge.
– Ok, Bati, ok, je vais faire tout ça. Enfin, presque tout !
Cette affaire me plaît de moins en moins. J’aurais vraiment souhaité refiler le bébé à la Criminelle, mais bon... Je sens bien que mon Corse veut taper un grand coup avant de partir à la retraite. Alors…
Je suis sur le point de sortir quand le téléphone sonne. Hélène. Son appel est bref mais quand je repose le combiné, je plane, j’ai l’impression que le monde m’appartient. Bati, devant ma mine, attaque :
– T’ as gagné au loto ?
– Mieux Bati, beaucoup mieux : Hélène est enceinte.
Un petit nuage passe dans son regard puis rapidement le Bati de toujours reprend le dessus.
– Et qui est l’heureux papa ?
Chap 27
Roissy CDG.
30 ans, fallait fêter ça ! Pif avait invité Vera au restaurant « Chez Paul », terminal 2E. Sandrine, cordiale et plantureuse antillaise, leur prépara un steak tartare pommes sautées épatant. Surtout pour Vera qui ne connaissait pas la musique. Mais la jeune femme chipotait, pignochait. Il savait son amie troublée, inquiète. Elle lui avait raconté la course-poursuite avec Trico et la chute finale de ce dernier. Apparemment le mac était toujours au fond de son trou car personne sur le site ne parlait de cette affaire. Mehdi, blindé, ne fit pas de commentaires. Sa copine lui disait qu’elle avait jeté un mec dans les oubliettes et il trouvait ça quasi normal. Ça commençait tout de même à devenir chaud, son ménage avec la Roumaine. Il était en train de se ligoter, complicité et tout le toutim. L’aurait été plus prudent de contourner cette fille de l’Est, de se tirer, mais Pif n’avait plus du tout envie d’être prudent ; c’était con mais c’était comme ça. Complice, donc, il était allé faire un tour dans le parking, sous la dalle, l’air de rien. La bouche d’aération donnait sur les bureaux du gardiennage, il n’y avait pas moyen de se rencarder mieux. Il n’allait tout de même pas rentrer dans la loge et tâter le plafond. Si le gardien avait été à la « cégette », c’était envisageable mais la tête du surveillant ne lui disait rien.
A table, il multiplia les anecdotes pour tirer son amie du stress où elle s’engluait. Tous les sujets lui semblaient bons à prendre. Il bavardait, il jaspinait. Il venait de dénicher une étude d’une fondation américaine du sommeil qui était formelle : de tous les professionnels des transports, c’étaient les pilotes d’avion qui manquaient le plus de sommeil ! Un pilote sur dix se plaignait de manque grave. « Tu entends, Vérouchka ? T’as une chance sur dix de monter dans un avion avec un pilote crevé ! Ils prétendent que plus de 250 accidents d’avion ces vingt dernières années étaient dues à la fatigue... » Il parlait un peu trop fort et ses voisins de table commençaient à le regarder avec colère, moins pour le bruit qu’il faisait que pour ce qu’il disait. Tous ou presque étaient d’imminents passagers... Mehdi, indifférent au malaise qu’il suscitait, continuait d’aligner ses chiffres : un quart des pilotes reconnaissaient que la fatigue les perturbait en vol « au moins une fois par semaine ». Un sur cinq admettait avoir fait une grave erreur à cause de la somnolence. « Non mais, tu réalises ? » Manifestement c’était pas un souci pour elle qui regardait son Pif s’agiter sans vraiment le voir. Déçu, il changea de sujet, passa à Tintin, racontant que le dernier album d’Hergé aurait du se passer dans un aéroport, l’aventure se serait déroulé dans les halls, sur le tarmac, c’est ce que l’artiste voulait. Pour le décor, il se serait certainement inspiré d’Orly, le summum de la modernité dans les années soixante. Mais il n’a eu ni le temps ni les moyens de le faire. Véra soupira. Hergé ? Tintin ? Bof. « Tu me défendras, Pif, tu me défendras si on me fait du mal ? » lui demandait-elle pour la énième fois. Cette fille crevait de peur, attendait tout de lui ; or, sans pouvoir se l’expliquer, il ne se sentait pas à la hauteur. Se croyant obligé d’étourdir sa compagne de fariboles, il passa au scabreux. Un collègue lui aurait dit dernièrement que les mammifères, en général, portaient un os pénien, ce qui leur permettait d’être tendu en permanence. Huit centimètres chez les ratons-laveurs, douze chez l’ours brun, un mètre chez le cachalot.
« T’imagines ?
« Un os ? Pourquoi faire ? Pourquoi tu me parles d’os ?
Pif commençait à se décourager. Le contact ne passait plus avec sa commère. Sandrine était venue prendre des nouvelles de son tartare. Côté boisson, c’était vite fait : ils étaient tous les deux à l’eau plate. Et la voilà qui raconte, par une association d’idées très culinaires sans doute, un crime qui faisait la Une chez elle, en Seine et Marne. Pif eut beau lui faire des petits signes agacés pour l’inviter de changer de sujet, la serveuse était lancée. Un homme avait été retrouvé mort chez lui ; étaient présents sur les lieux sa femme et un ami du couple. Ces deux-là affirmèrent que la victime s’était évanouie subitement puis avait trépassé. Mais l’autopsie montra vite que les amants avaient étouffé le cocu avec un énorme morceau de beurre. Ils pensaient bêtement que la matière allait fondre, qu’il ne resterait aucune trace de l’arme du crime...
« Vous comprenez ça, vous ? Goinfrer à mort votre mari, l’asphyxier à coup de motte de beurre ?
Sandrine s’esclaffa. Pif ronchonnait et Véra était, pour le coup, complètement désarçonnée. Perplexe et déçue, l’employée s’éloigna. Pif se disait que ce repas, finalement, était une fausse bonne idée. La Transylvanienne, à présent, voyait des Roumains partout. Elle se demandait ce qu’était devenue la jeune blonde qui accompagnait le mac, l’autre jour. Est-ce que cette pimbêche l’avait vue ? Au début de la cavalcade, très certainement. La demoiselle s’était-elle à son tour émancipée ? Etait-elle repartie à Bucarest ? Ou avait-elle rejoint le clan, à Paris, pour la dénoncer ? Allaient-ils tous s’y mettre, débarquer en rangs serrés à l’aéroport ? « Tu me défendras, Pif, tu me défendras si on veut me faire du mal, dis moi ? Protège-moi, Pif ! »
Ce qu’elle ignorait, et qui aurait pu la tranquilliser, c’est que le réseau dit de Brasov venait d’être mis sous les verrous, vingt personnes déférées devant la justice.
Chapitre 28
Je sens l’énervement me gagner. Je raccroche le téléphone brutalement. Je crois que je n’ai même pas dit au revoir à mon interlocutrice et je m’exclame « Mon vier ! » avec une telle force que Bati, qui est en train de discuter avec le dernier nouveau, Alain Barbier, s’interrompt. Barbier se retourne, étonné, me regarde puis fixe Bati ; il répète deux ou trois fois ce mouvement en signe d’incompréhension. Le papy commente :
− Ecoute Barbier, lorsque tu entendras cette expression : « Mon vier ! » ou bien « Et mon vier ! », tu dois en conclure deux choses : un, tu as en face de toi un Marseillais, pas un Niçois, pas un Corse, un Marseillais ! Deux, ledit Marseillais est très, très, très contrarié.
Barbier se hasarde à poser la question :
− D’accord, et c’est quoi un Vier ?
Bati fait deux pas vers moi, me regarde et précise :
− Chez les Marseillais, cette espère si particulière de bipède qui vit dans les Bouches du Rhône, le Vier est au choix, la bite, la queue, le membre, bref tout simplement le sexe masculin. Et ils le mettent à toutes les sauces, si je puis dire. Le concombre de mer, cet invertébré des fonds marins qui régale entre autres les Chinois, est baptisé par nos amis « vier marin ». Capito Barbieri ? Et nous allons demander maintenant à notre ami phocéen pourquoi il est si contrarié.
− Figure-toi, Bati, que cette conasse de juge nous refuse la commission rogatoire pour aller contrôler les comptes de Romin en Autriche.
Bati encaisse :
− De quoi, de quoi ?
− Ah, tu vois, Toi aussi !
− Et pourquoi ?
− Parce que tout simplement, lieutenant – j’essaie de refaire la petite voix doucereuse que j’ai eue au téléphone – tout simplement parce que nous avons suffisamment d’éléments pour envoyer Monsieur Napolèse en correctionnelle pour faux, usage de faux, et que nous n’allons pas perdre du temps et l’argent des contribuables ; cette affaire a suffisamment duré, j’ai envie de la clore.
Bati rebondit :
– Mais attends, tu m’as bien dit que le plus gros du morceau, ce sont les surfacturations de plusieurs millions d’euros, c’est bien ça, le plus important ?! Si on convoque Napolèse, il va nous faire la danse du ventre, jouer l’abruti qui ne sait rien et il va s’en sortir blanc comme neige.
− Bati, c’est exactement ce que je viens de lui dire, et pas qu’une fois mais trois fois ; elle ne veut rien entendre.
− Putain !
− Ah tu vois !
Barbier nous regarde étonné. Prudent, il sort du bureau sur la pointe des pieds.
− Bon, qu’est-ce qu’on fait ?
− Ecoute, il n’y a qu’une solution : auditionner Napolèse, lui mettre la pression. Mais je ne crois pas qu’on va en tirer grand chose.
− Capitaine Ordioni, VOUS allez vous le farcir, le Napolèse, moi, j’en ai plein le cul, je m’en vais.
Je pars en claquant la porte.
Chapitre 29
Roissy CDG.
La fin de Trico, loin de calmer Vera, l’avait durablement bouleversée. Le jour du drame, Pif n’était pas là et il s’en voulait. Désormais, chaque soir, les deux amants avaient pris l’habitude de se retrouver dans le repaire de la jeune femme, après le service de Mehdi. Il terminait toujours tard, à vingt deux ou vingt trois heures. Il quittait discrètement ses collègues et, alors que CDG s’assoupissait lentement, il rejoignait, après moult précautions, leur tanière. Là, ils se livraient à une même et étrange cérémonie d’amour. Seul le miroir séparait leur petit nid de la ruelle passante. Il leur était pratiquement interdit de parler, d’émettre trop de bruit ; tout ici se chuchotait, se murmurait. Le duo était pareillement condamné à la pénombre sous peine d’être deviné de la placette, comme des ombres chinoises. Alors, dans une lenteur précautionneuse et mutique, un peu comme deux infirmes, deux aveugles et muets tout à la fois, deux êtres égarés mais comblés de se retrouver, ils s’approchaient l’un de l’autre, se palpaient, se flairaient, s’examinaient, se reconnaissaient. Ils mettaient un temps fou, calculé, savouré à se déshabiller, à soulever les étoffes, déboutonner chemise et chemisier, descendre robe et pantalon, faire glisser le sous-tif. Posément, ils s’allongeaient, se caressaient, se mangeaient, se manipulaient, s’imbriquaient, s’emboitaient, s’exaltaient, se possédaient, frissonnaient. Puis, béats, vidés, stupides, ils plongeaient et s’endormaient. Parfois, à telle ou telle étape des opérations, un soupir pouvait leur échapper mais le grognement se perdait heureusement dans le murmure de la nuit aéroportuaire.
Chapitre 30
L’analyse de tous les documents que nous a fournis le Comité Central d’Entreprise prend du temps. Le rapport Secafi, les expertises privées que Bernard Boulineau a confiées à la société Euroexpert, à propos d’appartements achetés en time-share en Autriche, en Espagne, au Canet, toute cette littérature me sort par les yeux. A midi, j’apprécie que Bati sonne la récré et me propose de faire un tour chez Trassoudaine.
– Je t’invite ! On va continuer ce labeur devant un petit vin dont tu me donneras des nouvelles.
Comment refuser, ce serait de l’ingratitude, non ?
Le rituel au restaurant est respecté, salamalecs d’usage, installation cosy, détente assurée. On passe commande et Bati sort d’un sac une bouteille. Ça se fait ici, pour les habitués, et à condition de partager le breuvage. Tout en servant, le Corse se confie :
– Ecoute Mateo, pour Napolese : avec la mort de Morin et le refus de la juge d’autoriser la commission rogatoire en Autriche, on va avoir du mal... S’il ne craque pas, le zèbre, on est marron.
Je goûte son cru, j’apprécie, je me renseigne sur le produit.
- C’est un Lubéron, cuvée les Ménines, du domaine Ruffinatto. Grenache, syrah, mourvèdre, carignan et counoise.
Mon Bati, quand il parle pinard, on dirait un académicien ! -Certaines vignes ont plus de 50 ans...Tu vois, il n’y a pas que le Châteauneuf-du-pape dans la vie.
Je vois pas pourquoi il me dit ça, le rustre. Je fais semblant de ne pas entendre et je réplique, sans transition :
-Au fait, t’as des nouvelles de Dubar ?
-Exact, j’avais oublié de te le dire. Il se sent dans une impasse. Il a exploré toutes les pistes, tous les individus interrogés ont un alibi en béton .
-Même Napolese ?
-Quand Morin s’est envolé vers les terres saintes, Napolese était en croisière en Polynésie française... Bon, affaire classée !
Il renifle son Lubéron, prend un visage grave pour goûter, laisse passer un ange puis ajoute :
- Alors, voilà Matéo ce que je te propose.
Je le vois venir, je le pondère :
-Affaire classée ?! Attends un peu, qu’est-ce que tu fais d’Argentino ?
-Je t’ai déja dit que La Quenelle est sur le coup ; et ce type est le plus mauvais flic de France et de Navarre, je te jure. Mise à part la chasse aux bites. Bref, il se passera plus rien, côté Argentino, capito ? Bien, alors voilà ce que je te propose, répète-t-il, cabochard. Cet après-midi, disons vers quinze heures, on va chez l’ami Napolese, on le met en garde à vue et on perquisitionne. On, c’est à dire Miguel ou Alain et moi. Toi, c’est pas la peine de venir, tu continues de potasser les documents. Je fais durer le plaisir jusqu’à six ou sept heures, je ramène le bonhomme à la maison, direction le commissariat où il va passer une nuit au frais. Demain matin, on va le chercher assez tard.
-Je t’arrête : demain, Bati, j’ai pris ma journée. On va avec Hélène chez le gynéco.
-D’accord, d’accord.
Le Corse opine, cherche une alternative, me demande, pour la forme :
-Au fait, ça se passe bien ?
-Parfait, merci.
-Dans ce cas, demain, on le laisse mariner, on lui pose une batterie de questions classiques toute la journée, on traîne. Je ne pense pas que la juge nous refusera de continuer la garde à vue, ou alors il va falloir une explication ! Bref on ramène le gonze demain soir pour une seconde nuit au frais. Et après-demain, c’est là que les Athéniens s’atteignirent, que les Perses se percèrent, que les Satrapes s’attrapèrent....
-Et que les Mèdes s’emmerdèrent, j’ajoute, pour lui montrer que moi aussi, j’avais des lettres.
-Exact. Donc c’est là où on passe aux choses sérieuses. On va le chercher très tôt et s’il doit craquer, ce sera à ce moment-là. Je ne vois pas d’autre méthode.
Dans notre havre de Trassoudaine, on papote encore un bon moment avant de se décider à retrouver le bureau. On fait comme on a dit. Bati part avec Alain, je me replonge dans les rapports, ceux de Francis Felgate notamment. Les chiffres à nouveau valsent, je m’indigne tout seul : « C’est tout de même extraordinaire que des sommes aussi importantes aient pu être facturées sans, au moins, un contrôle. Il va falloir qu’il s’explique ». Vers dix-huit heures, Bati est de retour avec son co-équipier et le sieur Napolèse. Ce dernier ne manque pas d’allure ; une tête puissante, les cheveux raplatis et gominés, à l’ancienne, bien sapé, il a tout l’air du type qui aime diriger, dominer. Il me dévisage, découvre nos locaux, regarde à peine les deux reproductions que Bati a épinglées au mur et esquisse une moue totalement dédaigneuse. Il laisse entendre qu’il n’est vraiment pas à sa place ici, qu’on ne joue pas dans la même catégorie. Une Rolls égaré sur un parking de Lada ! Bati lui propose de s’asseoir et me demande d’appeler le docteur, « pour la visite de Monsieur Napolèse, qui se trouve en garde à vue depuis quinze heures. »
Je prends la liste des toubibs de permanence, j’appelle. Une heure plus tard, le médecin signe le certificat médical assurant que « l’état de santé du prévenu est compatible avec une garde à vue ». Bati consulte sa montre. Il est près de vingt heures. Il fixe, tout sourire, notre prisonnier :
« Monsieur, nous allons vous emmener passer la nuit au commissariat du 13ème. Nous n’avons pas de cellule ici. Cela vous permettra de vous reposer un peu et demain matin nous viendrons vous rechercher. »
C’est dit d’une voix douce, affable. Genre hôtesse d’accueil appelant à un embarquement immédiat. Ou portier de palace qui vous invite dans son établissement cinq étoiles. J’évite de regarder à ce moment-là Napolèse. Est-il choqué, narquois, blasé ? On descend récupérer la voiture de service, direction le commissariat de l’arrondissement. Un moment, Bati stationne devant une sandwicherie ; il se tourne vers le détenu :
-Le sandwich, vous le préférez jambon-beurre ou saucisson-beurre ?
La suggestion semble sans malice. Napolèse le regarde, impavide, silencieux, ailleurs.
-Je vous conseille quand-même d’en prendre un, parce que vous savez, là-bas, à part l’eau du robinet, ils n’ont pas grand chose. Le mis en garde à vue semble se réveiller, il maugrée :
– Deux sandwichs.
Bati avait gardé l’argent que Napolèse avait sur lui, à son arrivée à la BRDE ; il me tend un billet :
– Matéo, tu veux bien t’en occuper ? et n’oublie pas la note, STP !
Je vais chercher les deux sandwichs ainsi que la facture demandée et on repart. Au commissariat, on remplit les formulaires circonstanciés. On leur laisse notre gus.
Quinze minutes plus tard, on est de retour au bureau. Bati me rend compte de la perquisition.
– Fallait pas s’attendre à des miracles. On est tombé sur deux comptes bancaires normalement approvisionnés, une B M W série 5 au garage. R.A.S. Un retraité bien propre... Demain, Matéo, prends ton temps. J’ai mis Alain sur le coup. On va toute la journée retenir le bonhomme. Mais après-demain, attention, rendez-vous à six heures !
Comme prévu, je passe la journée suivante à bichonner Hélène : gynéco, resto, balade. J’ai un peu de mal à me faire à l’idée qu’on va avoir un enfant. C’est incroyable, comme ça me remue, un peu comme un gamin qui attend ses jouets pour Noël. J’ai l’impression que ma vie va changer, que je vais devoir changer. Tout cela reste très confus, passablement troublant. Je ne pensais pas qu’une telle nouvelle me toucherait autant. Hélène est radieuse. Et le soir, je lui fais l’amour avec une tendresse dont je ne me croyais pas capable.
Le lendemain, six heures pétantes, je pointe au bureau. Bati me fait un bref compte-rendu de la situation pendant que nous roulons vers le boulevard de l’hôpital, pour récupérer notre ami Napolèse.
-La juge n’a fait aucune difficulté, elle a autorisé vingt-quatre heures de garde à vue supplémentaires, on l’informera dès qu’il y sera mis fin.
-Et les interrogatoires, hier, comment ça s’est passé ?
-Ecoute, on n’a pas trop poussé le bouchon, mais ce qui est sûr, c’est qu’il fait l’idiot : « Je comprends pas ce qui se passe, j’ai rien à voir avec votre affaire, mais de quoi vous me parlez... » Lui, il n’est jamais concerné. Lui, il ne sait rien. Lui, il n’a rien fait. Ce sont les autres qui sont en cause. Il ne pige pas ce qu’on lui veut. Lui, il gérait pour le bien des salariés et il ne s’explique pas cet acharnement. Il ne saisit pas ce qu’on peut lui reprocher.
-Je vois le genre.
-Espérons que cette nouvelle nuit au poste va l’attendrir un peu sinon on n’aura pas grand chose contre lui. A part le licenciement déguisé d’Argentino, mais bon... Faudrait le coincer sur du lourd, sur cette question d’argent détourné via les surfacturations mais ça, j’y crois pas trop.
-T’es pessimiste, Bati ; c’est l’âge ?
Sept heures : on est tous les trois de retour au bureau. La scène se présente ainsi : Bati fait face à Napolèse, lequel tourne le dos à mon bureau, où je me suis calé. Bati ouvre le feu :
-Bon, Monsieur Napolèse, nous allons reprendre la conversation que nous avons eue hier.
Il s’énerve :
-Mais je vous ai déjà tout dit.
-Et bien, recommençons. On va tout re-écrire, si vous le voulez bien. On a le temps. Je vais vous reposer les mêmes questions et j’aimerais que, peut-être, vous réfléchissiez à vos réponses, que vous nous donniez différentes versions. D’abord, sur le licenciement de Monsieur Argentino. Est-ce que vous maintenez votre version ?
-Je vous ai dit et redit que c’est Hervé qui gérait ce dossier.
-Monsieur Hervé nous dit, lui, que c’est sur votre ordre, expressément, qu’il a monté cette démission en licenciement, c’est sur votre ordre que la procédure a été engagée.
-Hervé, il dit ce qu’il veut et moi, je dis ce que je veux. C’est sa parole contre la mienne.
-Mais quel intérêt aurait eu Hervé à faire ce montage de sa propre initiative ?
-Je ne sais pas, moi. Hervé et Argentino étaient peut-être copains.
-Mais vous étiez le patron ? C’est quand même vous qui contrôlez les licenciements et les embauches dans votre entreprise ?
-Je suis au-dessus de tout ça, monsieur. Ces détails, c’est Hervé qui s’en occupait. Il était suffisamment bien payé pour le faire.
-Et la secrétaire qui déclare avoir anti-daté les lettres de licenciements ?
-C’est Hervé qui a dû le lui dire. Moi je vous dis et je répète que je ne connais rien à cette affaire là.
-Ok. On continue. Donc, toujours dans le même domaine : Visit France. Vous avez bien, après votre départ de la compagnie, repris pied chez Visit France, vous le confirmez ?
-Et alors ? C’est pas interdit ?
-Bien sûr, mais quand on sait qu’à sa tête, il y a un certain Argentino, que vous aviez licencié, ça fait quand même drôle ? Vous licenciez un cadre du CCE et puis vous vous mettez en affaires avec lui à Visit France. Vous trouvez ça normal ?
-Ecoutez, il y avait le Comité Central d’entreprise, où j’étais un syndicaliste. Après ma retraite, j’avais la liberté totale d’investir où je voulais.
-Mais d’après nos informations, vous avez vendu vos parts très rapidement.
-J’ai vendu mes parts trois ans après.
-Et vous pouvez nous dire combien vous avez vendu vos parts ?
-Ce n’est pas un secret, je les ai vendues un peu plus d’un million et demi d’euros et je vous signale que j’ai payé les plus-values dessus.
-Mais sur vos comptes n’apparaissent pas ces sommes là ?
-Ecoutez, j’en ai fait bénéficier ma famille, j’ai beaucoup voyagé. Il faut profiter de la vie, non ? Vous n’êtes pas d’accord avec moi ?
-Je suis tout à fait d’accord avec vous. Il faut profiter de la vie, surtout avec de l’argent honnêtement gagné. Je poursuis : le CCE nous a fait parvenir des extraits du livre de M. Bouaziz, qui explique que la direction d’Air France a du faire pression sur Argentino pour qu’il vous laisse une place...
-Si vous croyez ce que disent les journalistes...
Le visage de Bati tirebouchonne, on dirait une hyène prête à passer à l’action, pourtant il finit par sourire :
– Bon, écoutez, on va dans un premier temps retaper tout ce que vous m’avez dit. Au fait, combien aviez-vous investi dans Visit France ?
-Cinquante mille euros, je crois.
Je pousse alors un sifflement admiratif. Napolèse se retourne, intrigué. Je me lève, contourne mon bureau, me dresse à côté de Bati et je lui balance :
-Vous êtes doué. Remarquablement doué. Vous investissez cinquante mille euros dans une affaire et trois ans après, vous vendez vos parts trente fois plus ! Ça mérite de figurer au Guinness des records, catégorie investisseurs avisés, non ?
Il serre les dents, me scrute, se tait. Je vais me rasseoir derrière mon bureau. Bati prend une bonne demi-heure pour tout taper l’échange ; il relit son œuvre. Napolèse acquiesce.
− Bon, nous allons passer aux appartements corses, si vous voulez bien. Il semblerait que vos appartements, à vous et à Monsieur Fourquet, aient été payés, disons, à un prix d’amis
− Alors là, inspecteur, c’est vous qui le dites. Moi, il me semble que j’ai payé ces appartements à un prix tout à fait correct.
− Un prix correct ? Des appartements qui valent près de 100 000 euros et que vous achetez 30 000 ? Et puis, ce qui est surtout gênant ici, c’est que vous les avez payés à Monsieur Tardieu. Or Mr Tardieu travaille avec le CCE, il est propriétaire d’un établissement que le Comité lui louait.
− Je ne vois pas en quoi c’est contradictoire ?
− Ce qui est gênant, je vais vous le dire : c’est que pendant des années, le CCE que vous dirigiez a versé - selon le rapport Secafi - des sommes extravagantes, mais surtout vous les régliez en avance, avant que les prestations aient été consommées.
-Oh vous savez, on paie toujours des arrhes à la réservation.
-Oui, mais là, vous payiez quatre-vingt pour cent de la totalité de la facture plusieurs mois avant qu’un premier vacancier n’arrive. Ce ne sont plus des arrhes ! Qui plus est, le CCE a réalisé une comparaison du prix à la journée avec cinq autres hôteliers. Leur prix est de 25 euros par jour alors que Tardieu vous facture ça à 60 euros.
-Puisque je vous dis que je ne me suis pas mêlé de tout cela. C’était l’affaire d’Argentino.
-Ah oui, je l’avais oublié. Argentino, c’est lui en effet le grand organisateur !
Napolèse s’agite, il semble tout ragaillardi :
-Et bien écoutez, demandez lui à Argentino. Je pense qu’il pourra vous répondre.
-Je n’y manquerai pas. Monsieur Argentino a, semble t-il, pris de longues vacances. Mais à son retour, on pensera à l’interroger.
Le mis en garde à vue opine. Il m’agace grave avec sa manie de commencer ces phrases par « Ecoutez... » sur un ton condescendant ! Il donne la tenace impression de nous prendre pour des cons. De ma place, je regarde sa silhouette. Une carrure de rugbyman. Costaud, installé. Il encaisse bien et se tient pas mal après deux nuits passées au commissariat ; c’est un battant, l’animal. Bati ne le lâche pas :
-Dans le rapport Secafi, il est également dit que messieurs Fourquet, Argentino et Tardieu avaient créé une société commune pour développer des vacances en Corse.
-Vous voyez, vous le reconnaissez vous-même : c’est Argentino qui est à la manoeuvre, ce n’est pas moi.
-Bon, d’accord. Pause. Je vais retaper les questions-réponses et on relira.
Bati se débrouille bien derrière son clavier, même si après quarante ans de pratique, il ne se sert toujours que d’un doigt... L’exercice lui demande tout de même un certain temps. Il relit, Napolèse approuve. Cela fait déjà trois heures que nous besognons. Arrive le morceau le plus important, le plus lourd.
-Maintenant, que pouvez-vous nous dire de nouveau sur ces appartements, plus exactement ces semaines en temps partagé achetées au Canet, en Espagne, en Autriche ?
-C’est très simple, il s’agissait d’une demande forte des personnels d’Air France. Il fallait leur trouver des destinations agréables. Voilà tout.
-Mais, Secafi estime pourtant que la fréquentation de ces centres était très faible, de l’ordre de trente pour cent.
-Alors là, c’est le genre de détails dont je ne m’occupais pas, vous voyez ! Première fois que j’entends ces chiffres. Et puis les gens de Secafi, d’où ils sortaient ces pourcentages ?
-J’ai ici un rapport commandé par le Secrétaire, Monsieur Boulineau…
- Boulineau ! Vous rigolez, non ? Un rouge de chez rouge ! Vous faites confiance aux cocos, vous ?
-Pardon ?
-Mais Boulineau, Rocamora, Besco, Dubourg, c’est la CGT ! C’est les cocos ! Vous le saviez pas ?
-Je ne vois pas le rapport ?
-Le rapport ? Ces gens veulent casser l’entreprise, le voilà le rapport. Nous sommes manipulés par le parti communiste, je vous dis. C’est ça le fin mot de l’histoire.
-Je ne sais pas si nous sommes manipulés par Pierre, Paul ou Jacques ; tout ce que je sais, c’est qu’il y a un rapport d’expertise de Monsieur Francis Felgate, lequel est agréé devant les tribunaux et devant la Cour Européenne à Bruxelles. Et cet expert dit que tous ces appartements ont été achetés avec une surfacturation de l’ordre de soixante à soixante-dix pour cent.
- Je ne le connais pas, moi, ce Felgate ! Il peut écrire ce qu’il veut ! Tout ce que je sais, moi, c’est que j’avais l’autorisation du CCE d’acheter, que les formalités ont été respectées, que tout a été fait dans les règles.
Napolese hausse le ton à mesure qu’il parle. Il crie quasiment ses derniers mots « ...DANS LES REGLES ! » Bati riposte en lui parlant de majorité courte au CCE, 11 membres sur 20 (« Grâce à l’appui des navigants commerciaux. »), de commissions pharaoniques ( toujours selon Felgate) versées à un intermédiaire, un certain Monsieur Romin.
Là, silence radio du mis en garde à vue. Le personnage a l’air soudain aphone. Bati insiste.
« Monsieur Napolèse, sur les vingt millions d’euros, grosso modo, que le CCE a déboursés, les deux tiers se sont retrouvés dans les poches de Romin, qui les a ensuite distribués ! A qui ? Je vous écoute.
Napolèse retrouve soudain sa voix, il se lève, gesticule, se livre à la grande pantomime ; on sent qu’il a du métier, ce syndicaliste un brin comédien sur les bords :
-Mais je ne sors pas de Polytechnique, moi ! Je suis là pour gérer, c’est tout, pour faire du bien aux salariés, vous comprenez ça ? Je suis là pour les aider à passer leurs vacances, à tous ces employés, de bonnes vacances. Et quand je dis que je gère, faut que je précise tout de suite que je ne suis pas un gestionnaire professionnel ! Ce monde de chiffres, de prévisions, de codes, toutes ces sommes incroyables que vous citez, ça fout le vertige, non ?! Je marche sur des œufs, moi, dans ce monde-là, je tâtonne, je bricole, je supervise et je délègue beaucoup. Alors oui, c’est vrai, parfois j’ai pu faire des bêtises. Ou laisser faire. Peut-être... J’ai pu commettre des erreurs. Oui, peut-être...
A mon tour, je me lève, je reviens près de Bati dont je prends le relai :
– C’est quand même assez étrange, Monsieur Napolèse. Vous nous dites que vous êtes finalement un médiocre gestionnaire, si je comprends bien, que vous ne savez pas trop y faire, que le CCE est une machine qui vous dépasse un peu, que le maniement de l’argent, c’est pas trop votre truc. Bien... Mais dès qu’il s’agit de votre appartement en Corse ou de Visit France, alors là vous avez la main d’or, si j’ose dire, comme d’autres ont la main verte. Vous investissez cinquante mille euros dans une société qui vous rapporte plus de trente fois la mise ! Disons que vous êtes drôlement fort pour gérer vos affaires mais pas celles des autres.
L’acteur est redevenu muet. Il s’est cadenassé à nouveau à double tour. Je cherche la faille :
– Alors ? je vous écoute ? Vous voulez préciser quelque chose ?
- J’ai déjà tout dit.
- Pourquoi l’Autriche, monsieur Napolèse ?
- Pourquoi pas ?
- Effectivement, mais pourquoi pas l’Italie ?
- Parce qu’à l’époque on a eu de bonnes propositions d’Autriche.
- Ou parce que l’Autriche est encore plus arrangeante que la Suisse côté secret bancaire ?
- Ça, c’est vous qui le dites. Je n’en sais rien.
- Hé bien, je vous l’apprends : l’Autriche protège ceux qui y planquent leur fric encore mieux que la Suisse.
- Vous me l’apprenez, en effet ! Le gaillard est goguenard ; en son for intérieur, il se moque, il raille, il en serait presque taquin.
Indifférent et méthodique, Bati enfonce le clou :
-Toutes les pièces dont on dispose, les déclarations, les PV d’audition des spécialistes, tout montre clairement que les surfacturations ont été énormes. Je le répète : sur les vingt millions d’euros que le CCE a investis, il y a au moins deux-tiers de surfacturation.
Napolèse joue les abonnés absents, il nous balade. Comme les trois petits singes, il n’a rien vu, rien dit, rien entendu. Je vois l’heure tourner, Bati commence à donner des signes de fatigue. Je lui propose d’aller prendre un café et de le remplacer. Il accepte. Je m’installe face à notre margoulin, tout près de lui. Nos visages se touchent presque, chacun ne voit plus que la gueule de l’autre. Je défie mon vis à vis :
-Monsieur Napolèse, vous n’avez pas de chance. Vous êtes mal tombé. Et je vais vous dire où vous êtes tombé. Vous êtes tombé à la Brigade de Répression de la Délinquance Economique. Et à l’intérieur de cette brigade, vous êtes tombé sur un mauvais groupe. Car c’est notre groupe, Monsieur Napolèse, qui a sorti l’affaire des HLM de Paris, celle des HLM des Hauts-de-Seine avec le Juge Halphen. Peut-être que cela vous dit quelque chose ? L’affaire Schuller-Maréchal ? C’est nous qui avons sorti l’affaire des marchés truqués des lycées d’Ile de France. La cassette Méry chez DSK, c’est moi ! Alors je vais vous dire quelque chose : je ne vous lâcherai pas ! Je veux savoir et je finirai par savoir où cet argent dont on parle, les fameuses surfacturations, est parti. On a retrouvé Mr Romin, le savez-vous ? Mais il était ruiné. Il vivait – enfin, façon de parler - dans une caravane, comme un va-nu-pieds. Quelqu’un qui a fait dix millions d’euros de plus value et qui se retrouve ruiné, ça craint, non ? Et je vais vous dire mieux. Le dernier chèque qui passe par lui, de deux millions d’euros, dixit notre expert, sert à acheter des appartements qui ne coûtent en fait que la moitié de cette somme. Nouveau bénéfice un million d’euros ! On observe encore que Mr Romin, toujours lui, lève en plus une hypothèque d’un demi-million d’euros...
Mon mis en garde à vue s’applique à rester distant ; apparemment rien ne bouge sur cette face qui occupe tout mon panorama, les yeux, la bouche, les rides sont parfaitement immobiles, un peu comme un encéphalogramme plat. On dirait que le type a débranché toutes les prises pour s’obliger à demeurer cool, atrocement cool. Je continue mon laïus :
– Dans une affaire comme ça, quand on fait tellement de plus value, et qu’on lève en même temps une grosse hypothèque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il y a, derrière, une organisation ou quelqu’un qui a besoin de fric, de beaucoup de fric. Et ce qui se cache derrière, je finirai bien par savoir ce que c’est. Non, Monsieur Napolese, je ne vous lâcherai pas !
Le bonhomme réagit enfin. Comme une baudruche qui se dégonfle, il s’expulse de sa chaise, me domine un instant et hurle :
– Sale flicaillon !
Je me redresse aussitôt, le prends par la cravate et le rassois brutalement. Le protocole, ce sera pour plus tard. Mais il rate son atterrissage, son siège se renverse et lui chute à terre. D’une voix rauque que je ne lui connaissais pas, comme si ça sortait d’un autre corps, comme le feulement d’un possédé, il me menace :
– Tu es mort, flicaillon ! Tu ne le sais pas mais moi je le sais !
Je ne sais pas ce qui m’empêche de lui balancer mon pied dans la tronche.
Chapitre 31
Roissy CDG.
Les matins où elle avait le bourdon, enfin un bourdon plus tenace que d’habitude, Vera venait se recueillir devant le double et monumental panneau des Arrivées/Départs, situé à mi chemin du long couloir reliant les terminaux 2C et 2E. C’était son totem, son lieu de culte personnel, le fétiche autour duquel elle pouvait rêvasser. Et s’apaiser. De profil, les deux pans de l’installation ressemblaient aux ailes déployées d’un oiseau en vol ; de face, chaque tableau d’affichage, un triptyque en fait, avait un peu l’allure d’une vague déferlante. La liste des vols annoncés, de part et d’autre, était interminable. Vera s’amusait à les compter, cela faisait partie de l’exercice. Il y avait, ce samedi là, plus de 150 départs, et autant d’arrivées, programmés dans les quatre ou cinq heures. 300 destinations en une matinée, le tournis planétaire. Avec des noms familiers, Rome, Alger, Moscou ; des insolites, Asmara, Bujumbura, Dodoma ; des inconnus, Achgabat, Astana, Castries ! Vera n’en finissait plus de se faire son périple sur mesure, sa randonnée immobile, traversant, rien qu’en sautant les lignes, les océans, les cordillères et les déserts lorsqu’une voix d’ado la ramena sur terre :
« Mademoiselle, s’il vous plaît... »
Le garçon jouait l’interprète pour un groupe de touristes, des italiens,
d’apparence modeste à en juger par leur tenue, K-Way, survêtements, chaussures de sport. Il avait du la prendre pour une officielle et lui dit quelque chose de tout à fait incompréhensible, puis elle crut qu’il parlait de Berlin. Elle le fit répéter. Le jeune homme en fait demandait où se trouvait Leroy Merlin. Elle ne connaissait pas et ne put lui répondre. Ses interlocuteurs semblèrent vraiment navrés, presque choqués.
Les voyageurs, elle le comprit plus tard, étaient à la recherche d’un centre
commercial à la mode. Sillonnaient-ils l’Europe pour visiter un simple commerce ?! C’était peut-être ça, la mondialisation accomplie. Ces consommateurs acharnés l’avaient détournée du panneau ; elle se laissa donc distraire par l’agitation habituelle qui régnait dans ce coin de Roissy
qu’elle connaissait par cœur. Au rez-de-chaussée, le hall de la gare Sncf
grouillait de monde, la billetterie était prise d’assaut, les sandwicheries débitaient à tour de bras des collations onéreuses et improbables. Dans un coin un peu en retrait de cette salle, des dizaines de cartons étaient sagement rangés, dressés contre un mur ; c’était probablement ce qui restait du dortoir des régiments de noctambules qui se donnaient chaque nuit rendez-vous ici, Mehdi lui en avait longuement parlé.
Vera longea l’hôtel Sheraton puis s’attarda devant une des larges baies vitrées qui donnaient sur les quais du RER et des TGV. Une immense structure métallique blanche supportait les voûtes de la gare, comme les arcs dorsaux d’un colosse ; le panorama ne manquait pas d’allure. Comme elle allait s’en retourner à son antre, une scène l’intrigua. Cela se passait derrière la colonne des ascenseurs. Un ruban de plastique, blanc et rouge, comme ces bandes qui encadrent une scène de crime, isolait un carré d’une dizaine de mètres de côté. Le ruban était accroché, aux quatre coins de cet espace, par des caddies portant le sigle de la banque HSBC, laquelle n’en demandait sans doute pas tant. En effet, au centre de la scène, il y avait une curieuse pyramide de près de deux mètres cubes, un monticule de vêtements, de pantalons, de foulards, de parkas, de valises, de sacs à dos, de bouteilles plastiques. Un employé, masqué, ganté, armé d’un long manche en bois, saisissait avec hésitation les objets, un par un, au bout de son instrument puis les glissait dans de grands sacs en plastique bleu, placés sur un wagonnet à ses côtés. On se serait cru à Fukushima de l’après tsunami et le dérèglement des réacteurs. De temps à autre, et à tour de rôle, un petit chef d’étage maniéré puis une cheftaine gironde s’approchaient de l’espèce de sauveteur solitaire, pour le soutenir dans son entreprise. On les sentait partagés entre un évident dégoût pour le spectacle et une empathie obligée avec l’employé ; ils lui adressaient le même encouragement bref ( « S’il y a un souci, n’hésitez pas à m’appeler ! ») et puis ils s’enfuyaient, littéralement. Vera n’osait comprendre : l’administration, sans doute au cours de la dernière nuit, avait du faire une razzia sur les bougres qui squattaient la gare et confisquer leurs pauvres hardes. Ou alors elle avait profité de leur déambulation matinale pour chaparder leur saint-frusquin. On ramassait à présent ces haillons, comme s’il s’agissait de guenilles de pestiférés, ou d’équipages d’irradiés, tout au bout d’une pincette, pour les destiner probablement à un crématorium du coin. La Roumaine eut soudain terriblement honte, et une rage froide la pétrifia. Que faire ? Hurler ? Contre qui ? Le pauvre type en face d’elle qui s’agitait avec sa baguette ? L’esclave de service ? Alerter les brigades de touristes hilares qui passaient au large, à la recherche des dernières boutiques de luxe qui venaient de s’ouvrir ? A quel titre ? La chasse aux pauvres était ouverte, dans l’indifférence générale, et l’opération décontamination se poursuivit sans encombre. Vera déconfite retourna dans son trou.
Chapitre 32
Je laisse les volets fermés. Je ne sais plus très bien si c’est le jour ou la nuit, le matin, le soir. Il n’y a plus que cette douleur, cette vague de haine qui m’ont déboussolé.
Hélène est morte.
Elle m’avait appelé, hier soir, j’étais encore au bureau. Elle avait cette manie d’utiliser son portable à tout propos, de bavarder dans son mobile en s’habillant, en mangeant, en marchant, en conduisant. Elle se rendait chez son toubib, une visite de routine, me disait-elle. Elle me parlait du bébé, et puis du bébé et encore du bébé. Et moi, j’étais incapable de l’interrompre, j’étais comme au garde à vous. Je lui avais laissé la voiture, elle devait venir me chercher au bureau en fin de journée. Je l’ai entendue sortir de notre appartement, descendre les escaliers, clic-clac clic-clac, la sono était parfaite. L’ascenseur était disponible, me dit-elle encore, « mais la marche, c’est bon pour le bébé ». Elle a croisé une voisine, Bonjour, bonjour, Vous allez... ? Je vais... L’impression que tout le monde était pressé. Puis elle a accédé au parking ; l’écho de ses pas dans ce sous sol faisait une petite musique sèche, presque métallique. Le bip du message envoyé au véhicule, le grincement d’une porte qui s’entrouvre, les clés dans le démarreur. « Et le bébé, faudra lui trouver un nom, non ? » riait-elle. Un bruit de moteur qui semble hésiter à partir, une fois, deux fois, puis un craquement confus. Un coup ? Un choc ? Une chute ? Impossible à dire. Et silence radio. Un silence qui dure. J’ai pas du tout aimé ça, j’ai rappelé Hélène, ça sonnait dans le vide. Même pas le répondeur. C’est le concierge qui m’a fait signe très peu de temps après. Fallait pas que je m’inquiète, a prétendu ce con, mais ma voiture venait de prendre feu, une fumée épaisse avait envahi tout le parking ; les pompiers étaient déjà sur place mais pour l’instant, ils ne pouvaient pas dire s’il y avait quelqu’un à bord.
Grâce aux collègues, j’étais sur les lieux trente minutes plus tard. Des flics, à l’entrée du parking, tenaient à distance une petite foule de badauds. Au sous-sol, on pataugeait dans la gadoue, l’incendie avait déclenché les systèmes anti-feu, le plafond ruisselait encore un peu, et les pompiers, de leur côté, avaient du en rajouter dans l’humide. Un voisin, un infirmier de St Louis, était sur place ; on se connaissait vaguement. Il me dit qu’Hélène avait été tuée sur le coup. Comme coupée en deux, par une bombe coincée sous le volant. Cisaillée. Son corps ( en l’entendant parler de « son corps », j’imaginais aussitôt deux morceaux séparés, déboîtés, l’enfant pulvérisé et je m’étonnais de pouvoir mettre alors des mots sur ça) avait déjà été évacué. Il n’y avait plus rien à voir sinon la carcasse éclatée de la voiture. Personne n’avait remarqué de mouvements inhabituels dans le parking ces dernières heures, répétait le gardien à un policier que je ne connaissais pas et qui me salua maladroitement.
La sonnerie de l’entrée me fait sursauter. J’ai des crampes atroces au ventre, j’ai l’impression que la déflagration m’a scié, moi aussi. C’est Bati. Il est en noir, c’est de circonstance. Sans un mot, il me prend dans ses bras et me serre fort. Je suis incapable de bouger. Il me regarde, scrute les lieux et va s’asseoir. Il prend la bouteille de whisky sur la table, se tourne vers moi, soupire, théâtral :
– Mateo, les femmes pleurent les morts, les hommes les vengent.
A ces mots, je me retrouve des années en arrière. Après une nuit passée à la fac, je rentre chez moi et je comprends de suite que mon père est mort. Il y a déjà des voitures, des voisins, des amis dans la cour devant la maison. Ma mère, prévenue de mon arrivée, sort, m’embrasse sans un mot et me conduit à la chambre à coucher. J’y entre seul, je ferme la porte. Mon père, endimanché, repose sur son lit. Je m’approche, lui caresse les cheveux, baise son front. La raideur cadavérique me surprend. Je sais qu’après, il n’y a rien. Il le savait aussi. Pleurer me soulagerait mais pleurer, c’est accepter. Et cette mort, comme celle d’Hélène, je ne l’accepte pas.
Je regarde Bati, querelleur :
– Où tu as vu des pleurs ?
La bouteille dans la main, il laisse tomber :
– Matéo, boire, à certains moments, c’est comme pleurer.
– Et dis-moi Bati, en quoi ça te concerne ?
Ma réponse le perturbe. Il se lève lentement, comme il le fait parfois au bureau, il a l’air de chercher Courbet ou Van Gogh au mur. Il ne trouve que les fenêtres fermées. Puis il entame une sorte de confession sur un ton inhabituellement grave :
– Matéo, il y a longtemps de cela, j’ai été marié. A une fille de Balagne, une fille de Calenzana qui était aussi brune qu’Hélène était blonde, des yeux en amande, une peau de velours. Une odeur d’amande douce. Dans son village, la plupart des filles s’appelait Restitude, du nom de la vierge locale, la Vierge de la Restitude. Elle avait eu la chance d’avoir une sœur ainée qui portait ce prénom, ce qui lui avait permis d’échapper à la tradition. Elle avait hérité du plus beau des prénoms pour moi, Anne. C’est la seule femme dont j’ai été amoureux. Cet été là, nous passions des vacances au village, à Luri, chez moi. C’était le mois d’août. Anne était enceinte. Nous attendions la naissance d’un moment à l’autre. Un soir, après avoir discuté sous la tonnelle avec la famille et les voisins, on se couche comme d’habitude. Au milieu de la nuit elle me réveille :
– Bati, je crois qu’il faut y aller.
Elle sourit pour me rassurer mais je suis fou d’inquiétude.
– Bati, tout va bien se passer.
Elle a déjà préparé ses affaires. Je m’habille rapidement et on part en voiture. Toutes les minutes, elle pose sa main sur mon bras :
– Bati, ne t’inquiète pas.
Je descends les routes sinueuses du Cap Corse. Il doit être quatre heures du matin, bientôt le jour va se lever. J’entends dans le lointain une voiture qui arrive. J’apprendrai plus tard que ce sont des jeunes qui revenaient de boîte. A la sortie d’un virage, je vois ce véhicule foncer sur moi. J’arrive à les éviter mais je ne peux empêcher que la voiture sorte de la route et tombe dans le ravin. Des tonneaux, et encore des tonneaux. Je me réveille à l’hôpital de Bastia, je ne sais plus combien d’heures après. J’ai des fractures, un traumatisme crânien. Mais les docteurs réussissent à me sauver. En revanche, Anne et l’enfant qu’elle portait ont péri. A cette époque, il y a trente ans de ça, Matéo, l’échographie, ça n’existait pas chez nous. Mais je savais que c’était un petit garçon.
Bati se tourne vers moi :
– Il aurait eu à peu près ton âge aujourd’hui Matéo, tu comprends ? Je suis sûr qu’il t’aurait ressemblé.
Je m’approche de lui, je l’étreins. Il ne va tout de même pas se mettre à pleurer ?! Sinon je vais chialer moi aussi. C’est alors qu’il change complètement de sujet, se donne un air martial :
– Où est ton Manhurin, Matéo ?
Je ne réagis pas tout de suite. D’autant que je ne sais pas quoi répondre. J’ai jamais été un fana de flingue.
– Quelque part, dans un placard. Hélène n’aime pas… n’aimait pas voir cette arme. Et puis j’oublie pas ce que tu m’as dit le premier jour où je suis rentré dans notre bureau. Tu m’as dit très exactement...
Bati termine ma phrase :
– Petit, laisse ton arme au fond du tiroir. Il vaut mieux que tu te prennes une grosse tête que de commettre une bavure. La grosse tête, tu l’oublieras, la bavure elle te poursuivra toute ta vie.
– D’accord, mais maintenant, va falloir que je me blinde.
Bati sort de son pardessus un paquet, il le déplie. Apparaît un pistolet qu’il pose sur la table.
– Voilà, Matéo, un Luger P08 /14, calibre 9 mm parabellum.
J’hésite, il insiste :
– Parabellum, t’as pas fait de latin ? Si vis pacem, para bellum ; si tu veux la paix, prépare la guerre.
C’est vraiment le moment de réviser nos classiques. Je m’agace :
– Comment t’as eu ça ?
Il avoue, en retrouvant un ton de conspirateur :
– Une vieille histoire... Mateo, tu as huit coups dans le chargeur ; c’est un semi automatique suffisamment fiable pour ce que tu dois faire.
« Ce que tu dois faire... » Sacré Bati, il a deviné juste. C’est comme s’il lisait dans mes pensées.
Je range l’arme dans le placard de la cuisine derrière des paquets de pâtes et de riz.
La curiosité le démange. Il aimerait respecter mon silence ; en même temps, il a vraiment très envie de savoir comment je vais m’y prendre. Il lâche :
– C’est quoi, tes pistes ?
Je lui fais part de mes soupçons ; je crois avoir compris qui tire les ficelles. Je lui dis également ce que je compte faire. Il se caresse longtemps son menton mal rasé avant de réagir :
– Tu vois, ça me soulage. Parce que j’étais sûr que ce n’était pas quelqu’un du bureau. Cela aurait pu l’être mais je ne vois pas qui, chez nous, aurait pu balancer... Matéo, écoute-moi. Primo, tu vas te servir de ton téléphone portable uniquement pour des conversations banales ; deuxièmement, tu te mets en congés. Tout le monde à la Brigade comprendra. J’ai vu avec le patron, c’est pas un problème. Fais semblant de régler tes affaires de famille, tu vas, tu viens, mais dis toi bien que tu risques d’être surveillé et écouté. Ce que je te propose, c’est de m’appeler d’une cabine publique, chaque jour, entre midi et deux. Je serai chez Trassoudaine. Je te servirai de point d’appui.
Tout est dit. Bati me reprend dans ses bras et il ne peut s’empêcher de commenter :
« Et surtout prends un bain, tu pues autant qu’un troupeau de boucs !
Chapitre 33
Roissy CDG.
« AUCU, aucu, aucu, aucune-hésitation ! » : le slogan était scandé par deux à trois cents personnes. Aérogare 2, ils bloquaient le passage au carrefour de l’arrivée de la navette et du couloir –ainsi que de son tapis roulant - entre les terminaux 2D et 2F. « Aucu, aucu, aucu, aucune hésitation ! Non, non, non, à la répression ! Oui, oui, oui, à la négociation ! » Une partie des PIF de CDG s’était mise en grève, très en pétard contre les salaires (de misère) et les conditions de travail (mauvaises) et elle tenait à le faire savoir bruyamment. Mehdi en était, ravi. Il se retrouvait avec ses potes, ceux de « lacégète » mais aussi de tous les autres syndicats réunis pour l’occasion. Au mur, les écrans d’information du site restaient bloqués sur la mention « Mouvement social des sociétés de sûreté ». Les manifestants s’étaient armés de sifflets, de trompettes, de crécelles, de cornes de brume, de vuvuzela, de tambours, un orchestre symphonique universel. Certains dansaient et leur concert, sous les voûtes roisséennes, faisait penser à une finale de coupe du monde de football. Mehdi s’époumonait : « Au cul, au cul, au cul… ». Les flics, ce jour-là, on était au début du mouvement, semblaient presque aussi nombreux que les manifestants, plusieurs centaines de mastards, caparaçonnés, prêts pour le grand massacre ; casque avec rabat en plexiglas, boucliers énormes, épaulettes qui leur doublaient la carrure, bidules impressionnants, ceinture garnie de tout un arsenal répressif sophistiqué, genouillères et protège tibias considérables, bottes de sept lieues, c’étaient de grosses tortues ninjas noires, des Rambos terribles. Chacun était estampillé au dos d’un sigle codé, 1A, 2B, 3C, comme des pièces d’un jeu d’échec géant. Le déséquilibre physique entre les protestataires et leurs gardiens était surprenant : face aux jeunes gens, des jeunes filles souvent, format banlieue, les Cerbères semblaient presque deux fois plus volumineux. Il y avait là tout un savoir-faire sécuritaire dont Michèle Alliot-Marie s’était vantée auprès des Tunisiens, jadis. Le problème, c’est que ce savoir-faire, en l’occurrence, ne servait à rien. La police avait reçu l’ordre de tempérer et elle tempérait ; il lui suffisait d’encadrer et elle encadrait, point. En tête de manif, une jeune femme rousse et sexy, coupe au carré, brassard rouge marqué police au bras gauche, collant gris clair et jupette mini très colorée, hautes bottes noires, parlait dans une radio, au préfet peut-être, qui avait pris ses aises au Dôme tout proche, disait-on. « Ils avancent, ils avancent ! Vers l’aérogare B ; on fait quoi ? » L’engin crépita, elle traduisit : « On accompagne, on encadre ! Et baste ! » Ainsi, sous la banderole « Sûreté négligée, passagers en danger », la manifestation, qui venait de fait de doubler d’importance puisque les forces de l’ordre, objectivement, complétaient à présent les forces de sécurité, s’ébranla lentement, très lentement même, d’un pas de sénateur, comme pour faire durer le plaisir, à travers les couloirs et les aérogares. Le long du défilé, tous les quatre ou cinq mètres environ, les Robocops, désoeuvrés, presque débonnaires, traînaient des pieds. L’un d’eux côtoyait un porteur de drapeau rouge ; le tissu, ondulant, venait parfois recouvrir la visière de son casque, il se contentait de secouer le tête pour y voir clair, se gardait de tout geste trop agressif : l’ordre était d’accompagner, pas d’aller au contact. C’est ainsi que le cortège traversa le terminal 2D, soulevant quelques Vivas chez les clients de l’Hippopotamus et du MacDo, puis le 2B, monopolisé par Easyjet, même accueil cordial des gens de Pizza Hut. La farandole bifurqua vers le 2A en longeant le mur de dessins du brésilien Filipe Jardim, atteignit le 2C, effectuant ainsi un tour complet ou presque. Au fur et à mesure de l’avancée de la procession, les bureaux d’enregistrement fermaient, faute de personnels et de clients. L’aérogare était en train de s’ankyloser.
Mehdi, tout à son ardeur militante et unitaire, transita de 2B en 2A, avec le reste de la troupe, jetant à peine un œil au miroir de Vera. Il aurait dû, pourtant.
Chapitre 34
Il y a une balance dans cette affaire. Et elle n’est pas à la BRDE. C’est Bati en fait qui m’a mis la puce à l’oreille : le maillon faible, c’est la juge. J’ai réalisé, cette nuit seulement, que chaque fois que je contactais Laurence Rivière, mes affaires se compliquaient aussitôt ou dans les jours suivants. Longtemps, je n’ai pas vu le rapport, même quand Bati m’a fait passer, il y a quelques jours de cela, un exemplaire du Figaro, ouvert à la rubrique « Rendez-vous mondains ». Où est-ce que le Corse avait déniché ce papier intitulé « Petit cercle » ? Mystère. Sans doute quelqu’un du service le lui avait fait passer, intrigué par les noms qui y figuraient. On y détaillait les sauteries du beau linge. C’était pas trop notre genre, ni à Bati ni à moi, de décortiquer les chroniques people, même haut de gamme, mais ici, il y avait un patronyme, encadré au feutre rouge, qui ne pouvait que nous titiller, celui de Rivière Laurence, justement. La photo d’un Rallye en Haute Corse, simplement légendée « Le rallye, un rituel de passage », illustrait l’article. Dans la marge, le même feutre rouge avait ajouté une batterie de points d’interrogation. La journaliste du quotidien parlait d’un « tout petit monde », un cercle très fermé qui se fréquente entre Neuilly-sur-Seine, Palm Beach (Floride) et la Corse ; des rupins à « fort potentiel », c’était l’expression employée : « fort potentiel ». Des gens qui avaient fréquenté les mêmes grandes écoles. Une élite cooptée qui s’invitait à Deauville, skiait ensemble à Isola 2000, bronzait sur des yachts Cap d’Antibes. Rien que du bon. Le cercle regroupait deux faunes : les businessmen et les politiques. Les premiers payaient, les autres aidaient. Du donnant-donnant. Au rayon des politiques, on ne mentionnait personne en particulier, il y était juste question de plusieurs maires de grandes villes du sud-est et d’élus de « la Haute Assemblée ». Pour la partie Affaires, on parlait d’un directeur de d’un grand groupe de luxe, les frères Bénichon, des promoteurs immobiliers incontournables, des voyagistes à la mode ! Entre ces deux mondes, toujours selon la journaliste, c’est un certain Edouard Zabire qui faisait le lien, le go-between, l’intermédiaire, le Monsieur Bons Offices : ce quidam en effet, gentleman-farmer côté cour, gérait une écurie de dix chevaux de course et déclarait au fisc 8 millions d’euros de revenus, les petites années. Côté jardin, il avait été membre de cabinet d’une demi-douzaine de ministres ces dernières années. Et la juge dans tout ça ? Elle était présentée comme une « amie » du chef de meute, la compagne d’Edouard Zabire. Comme le monde est petit, ou c’est nous qui sommes grands, me suis-je dit. Et puis j’ai repensé à l’audition de Napolèse. A deux reprises, comme je lui demandais ce qu’il faisait à telle date, je ne sais plus précisément laquelle, il m’a dit qu’il était à un Rallye. Le Rallye de Haute Corse ? Sur le moment, comme un con, j’ai pas fait le lien. Et puis ces dernières heures, le chagrin aidant peut-être, je repassais en revue les pièces d’un puzzle qui commençait à prendre forme. Rallye = Rivière ; rallye = Napolèse ; Rivière = Napolèse. C’est ce que j’ai dit à Bati qui m’a bien compris.
La juge. Le Corse m’a donné l’adresse. Il la connaissait puisqu’il avait dû lui porter les P.V. à son domicile, suite à l’inondation des bureaux du TGI de Bobigny. Ce quartier entre Denfert-Rochereau et Montparnasse, au milieu de la rue Raspail, ne m’est pas inconnu. Les deux premières fois où je suis venu à Paris, mon ami François-Alexandre m’avait prêté un studio, qu’il avait hérité de son père, rue Boissonnat. Et puis, avec Hélène, j’ai dîné au Duc, elle adorait les crustacés et les poissons.
J’attends vingt heures. Je gare la voiture de service boulevard Raspail, vers le 238, et j’abaisse le pare-soleil police. Pour éviter une prune. La circulation sur le boulevard est fluide. Passage d’enfer, deux superbes rousses, des jumelles ?, font claquer dans un parfait ensemble leurs talons sur la rue pavée. Je m’engage rue Campagne Première. L’hôtel Istria resplendit en cette soirée de novembre. Une pensée fugitive pour toute la faune qui a sévi ici, les Aragon, Elsa Triolet, Man Ray, Erik Satie, Maïakovski, le philosophe Jean Benzrihem et tutti quanti. L’espace d’un soupir, je me sens tout minus, comploteur misérable mais déterminé. Je longe la rue, mon sac à l’épaule avec le matos prévu. Je m’arrête au 6b. Une simple pression sur un bouton permet d’accéder à un vaste vestibule orné de miroirs. A main droite, la « conciergerie » et puis une plaque indiquant « Têtu », probablement le siège du journal gay. Pas de concierge en vue. Au cas où, j’ai de toute façon préparé ma carte tricolore, celle qui ouvre les portes et fait taire les bouches. Bati m’a filé le code, j’accède à une cour intérieure pavée avec des entrées sur trois côtés. Que disent les boites aux lettres ? Laurence Rivière est au deuxième étage, entrée C. Si jamais elle était en compagnie, j’ai prévu de jouer le simplet, celui qui s’est trompé d’adresse. Elle ne me connait pas, c’est sans risque. Un escalier étroit mène au deuxième ; il y a deux portes d’appartements sur le palier. L’une est au fond du couloir, l’autre sur le côté droit. Je m’approche du 2B avec un luxe de précautions, jusqu’à contrôler ma respiration. Je colle mon oreille à la porte. Une musique. Du piano. Je crois reconnaître une nocturne de Chopin qu’Hélène m’avait appris à aimer. Le piano, Hélène, son corps cassé, le parking... Je prends une profonde inspiration et je sonne. J’entends un léger bruissement et très vite, la porte s’ouvre.
Bati ne m’a pas menti. Devant moi se tient une belle plante, brune, surmontée d’une queue de cheval. Un petit air dominateur. Genre tranquille mais hautain, et qui n’a pas l’habitude de se faire emmerder. De grands yeux bruns, un maquillage d’un rouge foncé qui lui donne un air d’Ava Gardner. Carrément. Elle est encore en tailleur et haut perchée sur des escarpins noirs.
– Mademoiselle Rivière ?
Ava Gardner fronce légèrement les sourcils, attend la suite.
– Lieutenant Montesinos, mademoiselle.
– Oui lieutenant ? Elle fait vraiment le service minimum.
– Je vous apporte les derniers P V, comme vous nous les avez demandés.
– Je n’ai rien demandé.
– Excusez- moi, c’est le boss pourtant qui me l’a ordonné.
Je gagne du temps pour être sûr qu’elle est seule. Par-dessus son épaule, j’aperçois une grande pièce qui peut faire office de salle à manger et de salon. Sur la gauche, une porte est ouverte. La chambre à coucher probablement. Si quelqu’un était là, il se serait déjà manifesté.
– Ecoutez, prenez-les, ce serait ridicule que je reparte avec ces documents. Il y a là les dernières auditions, notamment celle de Napolèse.
Je lui tends l’enveloppe. Au moment où elle l’attrape, je la gifle comme un bourrin. Une claque qui vaut un coup de poing. Elle part à la renverse, lâche l’enveloppe. Sa jupe remonte sur des cuisses gainées de bas noirs. Ses chaussures valdinguent. J’entre vite, je referme la porte derrière moi. Elle recule en rampant sur le dos, la terreur lui donne une formidable énergie et elle finit par lâcher d’une voix suraigüe :
-Vous êtes fou !
Je jette le sac à terre, m’agenouille et la maintiens au sol, en l’agrippant par le cou. Un petit filet de sang lui dégouline des lèvres, j’ai du la cogner comme un bœuf. Je me comporte comme un vrai salaud, il le faut. Hélène, si tu m’entends, tu sais bien que j’ai raison.
– Fou, oui ! Fou de douleur, fou de haine ! Et tu vas payer.
Je me rends compte que je suis en train de l’étouffer. Je desserre ma pression. Elle aspire goulument l’air, tousse, crache et murmure finalement :
-Je ne sais pas ce que vous me voulez ?!
La colère me galvanise. Comme si je venais de prendre une décharge électrique, comme si une onde de haine me traversait. De la main gauche, je saisis alors sa queue de cheval, lui tire la tête en arrière comme un barbare ; j’approche ma bouche de son oreille :
– Argentino ? Romin ? Riquet ? Non, ça te dit rien ? Ils ont été éliminés. Et comme par hasard, on les a butés aussitôt après que TU en as entendu parler. Par moi. Quand je TE donnais leur nom, c’est comme si je les condamnais à mort. Capito ? Alors tu vas me dire maintenant pourquoi ? Et qui tu informais, toi ? Quel est ton contact ? N’oublie pas ça : ma vie est foutue, je n’ai plus rien à perdre.
Je scande chacun de mes mots en lui secouant sa crinière comme un cinglé puis je lui redresse la tête, j’attends sa confession. Elle est aphone, elle croit hurler mais n’émet qu’un râle lamentable :
– Vous êtes fou !
Je lui rebascule la tête ; elle tente de saisir mon poignet, me pince, me griffe, je ne sens rien, je suis l’exterminateur :
– T’as pas idée de ma folie.
Furieux, je l’immobilise dans une posture qui doit lui faire sacrément mal dans le même temps où je fouille mon sac, j’en sors le Luger. Elle voit l’arme, s’agite de plus belle, se tortille. Cette fois, je pèse de tout mon poids pour la plaquer au sol. Elle ne peut rien contre quatre vingt cinq kilos de rage. Du pouce et de l’index de ma main gauche, je lui presse les joues pour lui faire ouvrir la bouche et j’y enfonce le canon du pistolet. Le tube heurte ses dents, le bruit est écœurant.
– Ecoute-moi bien. Je te répète : je n’ai plus rien à perdre. Alors, tu vas me donner ton contact ou je te fais exploser ta tête. A moins que tu préfères une balle dans le cul !
Je dis n’importe quoi, je suis lamentable mais je veux qu’elle capitule, vite. Je lis la terreur sur son visage, je sens une odeur ammoniaquée, elle est en train de se faire pipi dessus.
– Alors ?
Elle cligne frénétiquement des paupières, pousse des grognements de douleur. Je retire doucement le canon de sa bouche mais je reste affalé sur elle.
– Je t’écoute.
Sa confession est très courte. Ça me suffit. Je me relève et, sans la quitter des yeux, je vais m’assoir sur une chaise qui fait face au divan. Elle reste accroupie et tremblante contre le mur en enserrant ses jambes dans ses bras.
– Vous allez me tuer ?
Je fais semblant de réfléchir. Il faut absolument qu’elle me croit capable de le faire.
– Je vous ai dit ce que je savais. Je ne connais personne dans l’organisation.
Menteuse ! Elle me ment et pourtant je me contente de son aveu. Je lui jette un regard froid et me lève pour prendre le sac.
Je pose le pistolet et la fixe :
– Déshabille-toi.
Elle me jette un regard étonné, semble reprendre espoir. Je hausse le ton :
– Tu ne m’as pas entendu ?
Elle se redresse, retire sa jupe. Je prends l’appareil photo.
Chapitre 35
Roissy, CDG.
Vera avait entendu la manifestation venir de loin ; par principe elle fuyait ce genre de rassemblements, trop de flics, trop d’agitation, trop de risque. Tous les commerçants et passants de la placette étaient scotchés par le serpentin syndical, et elle en profita pour aller faire un brin de toilettes au WC voisin. Comme elle s’y attendait, elle s’y trouva seule. Elle ferma la bonde d’un des lavabos, remplit la cuvette et y plongea son visage. Même ainsi immergée, elle entendait encore le lointain brouhaha de la foule manifestante, déformé par la distance et l’eau. « O-U-O-U-O-U... »... Elle se redressa, s’ébroua, se regarda dans le miroir. Le type de la mine était à côté d’elle. Dans la glace, ils formaient tous les deux un drôle de portrait de famille. Elle n’eut ni l’idée ni le temps de crier. De toute façon, avec le fracas ambiant, les sifflets, les slogans, on ne l’aurait pas entendue. Du bras gauche, l’homme lui enserra le cou, l’étouffa. Le ruissellement d’eau semblait le gêner mais il dépassa son dégoût. Sa main droite tenait le poinçon. La Roumaine se dit que c’était comme dans le rêve, mais en drôlement plus vrai. La tige de fer fouilla le pavillon de l’oreille, chercha le bon angle, en prenant tout son temps. Un instant, un flash, un éclair, une poussière de nanosecondes, les regards des deux protagonistes se croisèrent. Elle pleurait, lui semblait placide, l’air du chrétien qui dirait : moi, je fais mon job, c’est tout. Même court sur pattes, il semblait terriblement puissant, comme enraciné. Submergée par la peur, suffocante, la jeune roumaine s’évanouit. C’est ce qu’elle pouvait faire de mieux. D’un mouvement sec, précis, le tueur lui fracassa le tympan, cela fit le bruit d’un carton sec qu’on perfore ; il lui traversa le labyrinthe, saccagea le cervelet. Elle s’affala. Méticuleux, attentionné, il accompagna la chute du corps qui s’étalait sur le sol carrelé en le mouillant passablement.
Chapitre 36
Vingt minutes plus tard, je suis de retour dans la voiture. Je jette le sac sur le siège passager et je m’agrippe au volant ; j’entends mon cœur qui pulse, c’est comme si on avait installé une grosse caisse dans l’habitacle. Wou-fou, wou-fou, wou-fou... Une bouffée de colère incroyable me submerge. La juge m’a lâché une adresse, c’est tout ce que j’ai pu obtenir d’elle. Pas de noms mais une adresse. Une boîte aux lettres qui lui permet d’informer le reste du réseau. Je m’en suis contenté. Je me voyais pas la cuisiner plus longtemps. Un moment, j’ai même eu peur qu’elle se ferme comme une huitre mais j’avais tout de même quelques arguments. Je l’avais sérieusement secouée, et d’une ; et puis je lui fis voir, sur mon appareil photo, les quelques clichés que j’avais pris d’elle en train de s’agiter avec un godemiché. En cas d’accident, au moindre pépin me concernant, ces photos parviendraient à la presse, lui avais-je dit. Ridicule : personne n’aurait publié ça. Et de toute façon mon sort est tracé.
Comme je n’ai pas envie d’attendre demain pour vérifier si l’adresse qu’elle m’a donnée est plausible, je prends aussitôt le périph puis l’A3, sortie Bobigny, et je m’engage dans le 93. Je retrouve facilement la Place Edmond Mauduy. En son centre, la statue du grand homme brille sous le feu orangé des lampadaires, comme si on l’avait soigneusement astiquée. Je contourne le monument et m’engage dans la rue Fabio Paruccini. Lentement, je dépasse le numéro 53. La rue est triste, c’est le genre de rues mortes où les volets des pavillons sont fermés 24h/24h. En cette saison, quand les résidents partent le matin au turbin, il fait nuit ; quand ils rentrent, il fait nuit. Alors, à quoi bon ouvrir les fenêtres ? Je quitte la voiture et je reviens vers le numéro 53. Une plaque indique « S C I La Plaine ». Ça correspond à ce que la juge vient de m’expliquer. Je ne m’attarde pas dans le coin, je rentre sur Paris. Un moment, je pense revenir chez moi, j’hésite. Finalement, je me prends une chambre dans un hôtel miteux, près du périph. Un pieu et un lavabo, la douche et les WC dans le couloir. Du spartiate. Je me couche et repense à cette putain de journée. Impossible de dormir. Hélène est là. Même dans ce bouiboui, elle est là. Je me tourne, me retourne, je la cherche, je la traque. Dans ma tête s’impose le refrain d’une chanson de Cabrel : « Ce n’est que le début d’accord d’accord... »
Chapitre 37
Roissy CDG.
« Nom de dieu de putain de bordel à cul de connerie de merde, c’est quoi ce foutoir ! »
Le chauffeur de taxi a lâché sa litanie d’un seul jet, sans reprendre son souffle. « Enculé de ta race... » On le sentait prêt à remettre ça. Son beau visage d’oriental a pour le coup perdu sa placidité. L’objet de sa colère : une Mercedes noire, limousine aux vitres teintées, garée n’importe comment sur un des passages réservés aux taxis. Sacrilège. Ils ont eu assez de mal à se faire leur place à CDG, voilà que des connards de luxe venaient sans vergogne bouffer leur espace et squatter leur terre. Un jour comme aujourd’hui en plus, avec la grève des gens de sécurité et la manif en prime. La totale ! Un flic s’approcha, un géant aux poils roux, on l’aurait dit tout droit sorti d’un pub de Belfast s’il n’avait eu son uniforme. Le véhicule portait un macaron officiel. L’agent tiqua, chercha du regard s’il y avait du beau linge dans le coin, ou un larbin. Nada. Enfin il y avait du monde mais rien qui ressemblait à ce genre d’apparatchik. Fallait faire évacuer l’intruse sinon les taxis allaient faire du barouf. D’ici à ce qu’ils se mettent en grève, eux aussi. Du trottoir circulaire déboula un bruit de cavalcade. Le policier vit arriver sur lui un petit homme au visage osseux, le patibulaire incarné, une vraie gueule de malfaisant, un bonnet de marin sur la tête, costar de toile bleu nuit. Le personnage était à la bourre.
– Je dégage, c’est bon ! Désolé !
– Bouffon, charogne, dégueulasse, empaffé ! L’oriental était très remonté ; debout près de son taxi, il enfilait ses perles à destination du retardataire, lequel faisait mine de ne pas entendre.
– Papiers ! Ordonna le condé au malingre.
– Je dégage, chef, c’est bon, je dégage ! Se contenta de répondre l’autre, avec un indéfinissable accent.
Le flic, qui faisait bien deux têtes de plus que le chauffeur de la limousine, était décidé à faire montre d’autorité. Il s’interposa entre le conducteur anguleux et la portière de sa voiture. « Papiers ! » répéta-t-il. L’interpelé exhiba à contre-cœur un passe officiel, orangé, estampillé République Française, SENAT. Au nom de Padovani Orso, chargé de mission, groupe Droite nationale.
– Orso, c’est le prénom ? S’étonna l’agent.
Silence radio du sondé.
– Je recommence : votre nom, c’est bien Padovani et votre prénom, Orso ? Notez, si vous répondez pas, je marque : « Refus d’obtempérer à agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ». C’est ça que vous voulez ? Vous savez ce que ça peut vous coûter ?
– Retrait de six points sur le permis, précisa illico le taxi, comme s’il était chargé de donner la réplique au flic, plus trois mois d’emprisonnement, plus 3750 euros d’amendes, plus diverses peines.
– Je m’appelle Padovani Orso, et alors ? laissa tomber le maigre, très contrarié.
– Et alors, et alors, Orso égale ours, non ? On vous a baptisé, officiellement, ours ? Votre mère était d’accord avec ça ?
L’agent se sentait en verve. Le petit homme, blanc de rage, pinçait les lèvres, à la limite d’écumer ; on le sentait obligé de contrôler une immense colère, une monumentale envie de cogner ; les efforts pour se contenir mobilisaient toute son énergie.
– Ours ?! L’uniforme s’était tourné vers le chauffeur de taxi, rigolard. Ces deux zèbres avaient l’air de travailler en couple. Un binôme de boute-en-train. Ours ?! Attention, pas Nounours ! A la limite, Nounours, c’est plutôt tendre, non ? Mais ours ?! Pourquoi pas sauvage tant qu’on y est ? Ou misanthrope ?
Le cogne s’en donnait à coeur joie. Il était largement sorti de son devoir de réserve. Mais ça l’amusait de turlupiner le jogueur étique qui lui faisait face. Lequel s’était figé, bloc de pierre et de haine. Statufié qu’il était, les mains tremblotantes certes, mais déterminé à la fermer, à encaisser et à l’écraser. Il avait les yeux écarquillés, comme s’il photographiait les moindres détails du flic et du chauffeur de taxi. Ça carburait dur sous son bonnet. Ces deux-là, il était pas près de les oublier. Oui, il se prénommait Orso et alors ? Qu’est ce qu’ils pouvaient y comprendre, ces faces de rat ? L’ours, c’est la puissance, non ? C’est la force, celle du guerrier, du sage ? Tout en ruminant ainsi, il se torturait les paumes pour passer ses nerfs, garder son calme, s’imprégner de leur visage. Ses pupilles dilatées étaient celles d’un fauve juste avant l’assaut. Si le flic et le chauffeur avaient pris le temps de croiser son regard gris fer, ils auraient été saisis d’effroi. Mais les deux gaillards, tout émoustillés, continuaient de le charrier.
– Et pourquoi pas grizzli ?
– Ours en peluche ?
– Ours mal léché ?
-Et pis, on sait jamais quand il les a ?
– Quoi donc ?
– Bin, ses ours...
Wouaaa, ça tournait à la grosse rigolade. L’homme au bonnet avait débranché, il n’écoutait plus. Il savait très bien faire ça quand il le fallait, c’était une question d’autodiscipline, simplement, de survie aussi parfois. Le flic finalement lui rendit sa carte d’accréditation, avec un petit geste méprisant, du genre : C’est bon circulez, créature, j’veux plus vous voir... Orso ne le fit pas répéter, s’installa au volant immédiatement, mit en marche ; la Mercedes émit un petit bruit dédaigneux et s’éloigna. Tout au long du parcours, sur l’autoroute miraculeusement dégagée qui le conduisait à Paris, le Corse poussa un seul et même hurlement, un rugissement de fauve à s’en péter les cordes vocales.
Chapitre 38
A cinq heures, je suis déjà debout ; trois heures plus tard, me voilà garé à cent mètres du 53, rue Paruccini. Je lis un journal vieux de plusieurs jours, en fumant clope sur clope. Si Hélène me voyait, elle qui était si fière de m’avoir fait arrêter « ce vice » comme elle disait... Neuf heures et demie, le facteur fait sa tournée ; il dépose des enveloppes dans la boîte à lettres de la SCI La Plaine. Je repense à la juge. Qu’est-ce qu’elle a bien pu faire après mon départ ? Ameuter les siens ? Ou écraser ? Et Napolese, où il est passé ce zèbre. Onze heures et quelques, une Mercedes noire me double et stationne en face du 53. Mon cœur repart à l’attaque, Wou-fou, wou-fou, mon tam-tam intime s’emballe... Je sens l’adrénaline monter. Le chauffeur descend ; à cette distance, je ne distingue qu’une silhouette trapue, surmontée d’un bonnet de marin. Le gonze ouvre le portail du pavillon, entre. Je quitte ma caisse, m’approche suffisamment de la voiture pour relever le numéro d’immatriculation et la marque : Mercedes Classe E 350 4matic. Le pépé Bonnefous a vu juste. Ce doit être cette voiture qu’il a repérée dans le chemin de terre, le soir où Romin a joué au bonze. Je retourne à ma planque, j’attends. Vingt minutes. Le chauffeur réapparaît, ferme le portail, retrouve son Allemande et démarre, impérial. Je le suis. Plusieurs ruelles. Au retour, on passe devant le palais de justice, direction l’ A3. L’exercice est difficile, il y a pas mal de circulation. Je m’efforce de ne pas perdre de vue le gibier mais la filature n’est pas mon fort. Un poids lourd me fait une queue de poisson, se rabat ; je freine. Le temps de repartir, l’autre a disparu. J’ai droit à un défilé de camions de la même société, « Transports Marc Massa ». Je râle, je gueule, je m’étonne : tous les gros culs sont immatriculés 13 ce matin ! Que viennent foutre les Transports Massa à Paris ?
Le mieux est de retourner en ville, attendre midi et appeler Bati, chez Trassoudaine. Fidèle au poste, il est là en effet ; je lui donne le numéro d’immatriculation de la Mercedes. Il note et me donne rendez-vous à 20 heures, place de la Bastille, au bar éponyme. Jusque là, je n’ai rien d’autre à faire que ruminer ma haine, mâchouiller mon désespoir. J’évite la maison, je renonce même à aller au crématorium où les parents d’Hélène ont fait conduire leur fille. Je tourne en rond dans le centre. Rue des Ecoles, je me fais une toile, un vieux Robert Enrico de 1974, avec Trintignant, Noiret, Jobert. La cavale d’un type poursuivi parce qu’il connaissait un secret d’Etat. Je me tape le film deux fois de suite. Pas vraiment de quoi se remonter le moral. J’arrive au Bastille dès 19 heures ; Bati, lui, est à l’heure, encore plus sombre que d’ordinaire. Il s’installe en face de moi, sort une feuille pliée en quatre et me confie :
– Mateo, c’est du lourd !
– Je t’écoute.
– La Mercedes appartient à un sénateur, Antoine Marie Luciani, Président du Groupe du Parti de la Liberté à la Chambre Haute. Gros poisson, mon vieux.
Et Bati me déroule la bio du bonhomme. Luciani est né à Lumio, en Balagne, en 1937 ; il a fait, activement, c’est lui qui s’en vante, la guerre d’Algérie ; membre fondateur de son parti dont il est toujours le trésorier. Plusieurs fois ministre, notamment à l’Intérieur. Cité dans des dossiers de pots de vin et de blanchiment d’argent mais jamais vraiment inquiété. Dispose d’un solide réseau africain, ce qui lui permet d’entrer dans tous les bureaux des Présidents du coin sans frapper à la porte. Est considéré comme le tenant de l’aile dure du parti. Célibataire. On ne lui connaît aucune relation. Mais on signale son attachement à son chauffeur/assistant, Orso Padovani, fils de Pierre-Marie Padovani, assassiné, soi-disant, pour des règlements de comptes entre nationalistes, mais sans doute plus prosaïquement pour trafic de drogue.
Tout ça colle avec ce que nous savons. Les morceaux se mettent en place. Des surfacturations sur le time-share d’Air France aux caisses du Parti de la Liberté, ça circule. Je le dis à Bati qui rebondit :
– En t’écoutant, je repensais à l’affaire ELF, tu sais quand les avocats de la défense avaient les PV avant le juge... Matéo, toucher à Luciani, c’est toucher au PDL, le Parti de la Liberté.
– Alors ça, Bati, je m’en bats les couilles. C’est lui le boss et il va payer.
Il me donne l’adresse de Luciani, du côté de Saint Rémy de Chevreuse. On fait une pause, une assez longue pause, comme si le silence était alors nécessaire. Bati opine du chef.
– Tu es décidé, Matéo ?
– Je ne te comprends pas, Bati ; tu es le premier à me parler de vengeance, tu me donnes un flingue et tu veux que je fasse quoi, maintenant ?
Il tourne la tête vers la place, regarde passer une bande de fêtards, perruques vertes sur la tête, riant fort. Il soupire :
– Tu es jeune, Mateo...
Du coup, il me fixe, s’accroche à mon regard et confesse :
– Moi ma vie est finie. Je peux le faire pour toi.
Un court instant, j’ai honte. Comment ai-je pu penser que Bati voulait me faire revenir en arrière ?
– Je ne sais pas comment te remercier, ami, mais c’est ma vie. Tu en as fait assez comme ça. Je ne reculerai pas. Je vais aller en planque, au domicile de notre sénateur, et dès que je serai prêt, je frapperai. En tout état de cause, je dois faire vite parce que je crois qu’ils ne laisseront pas tomber. On est allé trop loin.
– D’accord. Tu veux qu’on dîne ensemble ?
– Non Bati, je te remercie. J’ai besoin de réfléchir à tout ce que tu m’as dit, et je veux dormir un peu.
Bati décompresse. Comme je ne suis pas rasé, il remarque :
– Tu tentes la barbe, gamin ?
– Oui papi. Décembre va être froid, je préfère garder les poils.
Chapitre 39
Roissy CDG.
Mehdi n’apprit que bien plus tard, le surlendemain du drame en fait, par la rumeur roisséenne, la mort de Vera. Le corps avait été évacué, il n’avait pas réussi à savoir où. On allait la charcuter, pour voir ; ou peut-être pas d’ailleurs : une cloduque, qui s’en soucierait ? En ces temps de vaches maigres, il n’y aurait probablement pas d’enquête. On parlait d’un transfert ultérieur à Thiais, là où on enterre les SDF. Il avait vu un reportage sur ce cimetière pour morts « sous X », des alignements de dalles identiques, un gigantesque damier de carrés de béton vaguement gris, avec des chiffres ; pas de noms, pas de signes, pas de fleurs, aucun objet qui traîne, aucun relief, le grand rien, le parc des Morts Anonymes, le no man’s land parfait, un plat pays dévasté, balayé. Pif ne se sentait pas le courage d’y aller, ni demain ni jamais. Il n’aurait pas tenu le coup.
Il désertait. Mehdi était bouffé par la culpabilité, une saloperie d’idée fixe qui lui pourrissait tout. Il ne se pardonnait pas d’avoir été absent, une nouvelle fois, alors que Vera avait besoin de lui. Il donna sa démission de l’agence de sécurité et quitta CDG sans explication, sans saluer quiconque.
Chapitre 40
Ce samedi matin de décembre, je roule vers la demeure du sénateur, à Milon La Chapelle. Elle se situe en fait sur la route de Saint Lambert, à mi-chemin entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et les ruines de l’Abbaye de Port-Royal des Champs, rasée comme on sait par Louis XIV, histoire de mettre fin au Jansénisme. Route de Saint-Lambert, ça pue l’aisance. Doit pas y avoir beaucoup de smicards ou d’allocataires du RMI dans le coin. Ou alors des sacrés malins ! Un vallon, une route qui serpente au milieu de propriétés opulentes, entourées de parcs et de charmilles, pour éviter le regard des manants sur les piscines et autres signes extérieurs de richesse. Je n’ai aucune difficulté à trouver la maison du sénateur devant laquelle stationne une Audi A8. La bâtisse est à 150 mètres environ de la route. On y accède après un passage sous un arc en brique sans grille ni portail. Sur la pelouse, des arbres aux feuilles caduques se les gèlent. La propriété fait un bon hectare, délimitée par des haies de troènes. Accès facile. Je prends mes marques, je repère, je détecte. Faut que je comprenne le mode d’emploi de ce type, et de son ourson. Des heures durant, je circule dans le coin et je repasse régulièrement devant le 56, route de Saint Lambert. En milieu d’après-midi, l’Audi est encore là mais pas de Mercedes en vue. Finalement, je décide de faire un break et je retourne à mon hôtel lowcosté. Dimanche matin, je repars au front. Une Peugeot 407 a remplacé l’Audi mais toujours pas de Mercedes. A nouveau je planque, dans un petit chemin peinard, en surplomb ; j’attends, je glande. R.A.S., les volets de la maison sénatoriale restent désespérément clos. Je poireaute pour des prunes presque toute la journée. Rebelote lundi matin, je me pointe à sept heures, je retrouve mon poste d’observation dans le passage. Huit heures, bingo : la Mercedes apparaît. Elle traverse lentement le portail, s’arrête devant le perron. Orso ouvre sa portière, ne la referme pas et franchit rapidement les quelques mètres qui le séparent de la maison. Vingt minutes passent. Le chauffeur ressort, une mallette à la main, le sénateur au cul. Le duo s’installe, l’engin démarre. Je suppose qu’ils vont à Paris. J’enrage. Je rentre à mon tour sur la capitale où je passe ma colère dans une interminable marche le long des quais de la Seine. Dix-sept heures, me revoilà route de Saint-Lambert. Je patiente, il n’y a que ça à faire. Je repense à un collègue qui, chaque fois qu’il fallait faire ce genre de surplace, disait : on va croquer le marmot ! J’ai jamais osé lui demander d’où il tenait cette expression. Croquer le marmot ?! Vingt-deux heures trente, la Mercedes se montre, s’engage nonchalante dans l’allée et s’arrête à quelques mètres de la porte d’entrée. Orso ouvre au sénateur, ils se serrent la paluche et l’élu, scotché à sa mallette, s’engouffre dans la résidence. Je ne m’attarde pas et je retrouve ma chambre, je l’ai gardé finalement pour la semaine. Pas de clés, un code, six chiffres, ça marche quand ça veut. Mardi, même topo. Orso est là à huit heures, il embarque le maître. Et le redépose à vingt-trois heures cette fois. Mercredi matin, même scénario. Midi et quart : j’appelle Bati chez « Trassoudaine » comme tous les jours. Je l’informe de mes intentions.
− C’est pour ce soir, Bati.
Le Corse tique :
− C’est un peu tôt, non ? Enfin c’est vrai que t’as pas trop de temps non plus.
− Exact.
− Dans ce cas, Mateo, rendez-vous vendredi...
− ... « Aux cadrans », gare de Lyon », je complète.
− Quatorze heures. Faut que je puisse tout organiser, tu vois ? En cas de problème, appelle-moi demain.
− A vendredi, ami !
− Au revoir Matéo. Comment on dit chez toi « bonne chance » ?
− Suerte.
− Suerte, Mateo !
Oui, vraiment, j’en sais assez pour pouvoir passer aux choses sérieuses. Il me faut préparer l’expédition du soir. Vers 16h, je gare la voiture de service dans la rue de Bati, je récupère le sac dans le coffre et je laisse les clés dans sa boîte aux lettres. Je prends le RER, ligne B jusqu’au terminus, à Saint-Rémy-les-Chevreuse. Je porte un vieux jean, des baskets, un tricot et une veste passe-partout ; dans le sac, entre autres choses, je garde un passe montagne. Arrivée à Saint-Rémy un peu après dix-huit heures. Direction : Milon-la-Chapelle à pied. Trente minutes plus tard, je fais face à la maison du sénateur. La nuit est tombée depuis longtemps, sans bruit, comme il sied dans un quartier chic ; quelques lampadaires éclairent simplement la route. J’enfile le passe montagne, je dépasse le portail du 56 jusqu’à la limite de la propriété voisine et là, je me glisse sans mal à travers la haie pour arriver tout près de la maison. Une bâtisse d’un étage, une de ces demeures bourgeoises typiques des années trente. Le garage est visible de la route, je ne veux pas tenter l’ouverture. Pas question d’attirer l’attention. Je contourne le bâtiment et choisis une des trois fenêtres situées dans ce qui doit être l’aile nord. Un petit coup de pied de biche, le volet en bois saute. Je casse le carreau. J’attends le hurlement d’une alarme intérieure. Dans ce cas, je filerais dans les bois. Mais rien ne se passe. J’ouvre franchement la fenêtre, je jette à l’intérieur mon sac et je m’infiltre à mon tour dans le dispositif ennemi. Je referme le volet derrière moi tant bien que mal ; du sac je sors ma torche. Je me trouve dans ce qui semble être le bureau du sénateur. Le mobilier est en bois et ça vient pas d’IkéB, c’est sûr. Au mur, des photos, en noir et blanc pour la plupart ; on y voit surtout des hommes jeunes en tenue militaire. Sous certains clichés sont affichées, sous enveloppe plastique, des coupures de presse qui, toutes, relatent des épisodes de la guerre d’Algérie. Quelques photos sont plus récentes, en couleur ; l’une d’elles représente une photo de groupe du rallye de Corse dont parlait la rubrique mondaine du Figaro. Sur le dernier cliché, un homme, vu de dos, est en train de taquiner des chiens de combat, deux énormes pitbulls, des yeux d’exophtalmiques, une dentition de crocodile ; j’imagine aussitôt, à tort j’espère pour l’intéressé, le sieur Argentino aux prises avec ces molosses...
Je parcours les autres pièces du rez-de-chaussée : une cuisine, une vaste salle à manger, une buanderie et un grand salon avec deux tables basses, deux grands canapés et un divan d’angle. Aux murs, cette fois, toute une série de reproductions de batailles napoléoniennes. Dans un petit meuble vitré, chichiteux, une demi-douzaine de statuettes de Bonaparte sont à la parade. Je m’installe sur le divan. Il est huit heures, il va falloir encore attendre une éternité mais je me sens impassible, froid, comme si tout ce qui m’entourait n’avait aucun sens, comme si je ne faisais déjà plus vraiment partie de ce monde. Je sais simplement que j’ai quelque chose à faire, qu’il faut le faire, point. Je m’habitue au noir. Il est près de 23 heures quand le véhicule arrive : les roues mangent le gravier, la lumière des phares se devine un instant dans l’encadrement des volets, le crissement cesse. Je me dirige vers le salon, j’attends. Claquement de portières, bref échange entre les deux hommes, bruits de pas, cliquetis de la serrure, porte qui se pousse puis se referme. D’où je me trouve, j’imagine que le sénateur se rend dans la cuisine. Peu après, la porte du salon s’ouvre, l’élu actionne l’interrupteur, tombe la veste ; il a un verre à la main. Et il me découvre. A trois mètres de lui, je pointe mon Luger sur sa tête et lui indique, d’un petit geste de la main, le divan.
C’est moi qui le menace mais c’est lui qui m’impressionne. Il a le teint plâtreux, celui qu’on a d’habitude sous les néons mais lui est manifestement blafard en permanence. Il est en bras de chemise, blanche, ce qui rajoute à sa pâleur. Rien à voir avec ses compères toujours bronzés aux petits oignons, broshing d’enfer et dotés d’une dentition de carnaval. Il a un front large, accentué encore par un début de calvitie, des yeux plissés, héritage d’un lointain aïeul oriental ? Pour un nationalo-national comme lui, c’est un comble. De courtes bas-joues s’affaissent pour donner à sa bouche un air d’accent circonflexe. Une gueule de père fouettard.
Il me fixe, presque indifférent, et va s’asseoir doucement, sans lâcher son verre. Je me dis qu’il a un putain de sang-froid. Je me lance :
− Mateo Montesinos.
Il continue de me dévisager en silence, les traits de sa bouche toujours plus amers.
− Nous n’avons pas été présentés, sénateur, mais c’est moi l’homme dont vous avez tué la compagne : Hélène Bracieux.
− Ou vous êtes fou ou vous vous trompez !
− Je ne suis pas fou et je ne me trompe pas. Je sais tout, monsieur Luciani.
− Vous savez quoi ?
− Que vous êtes, monsieur le sénateur, à la tête d’une organisation politique d’ultras, qui se finance par des méthodes pas très catholiques, et que vous n’hésitez pas à éliminer ceux qui vous gênent.
− Cinéma ! Du pur cinéma ! Où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça ?
− Vous avez toujours réussi à passer entre les gouttes, monsieur Luciani. Les détournements de fonds des marchés publics de la région parisienne, vous vous rappelez ? Les révélations de la cassette Mery, non, ça ne vous dit rien ? Toujours concerné, jamais touché, encore moins coulé, c’est un peu votre devise. Vous avez du métier, c’est clair. De la bouteille, beaucoup de bouteille. Ces derniers temps, vous avez trouvé de nouvelles vaches à lait. Avec la complicité d’employeurs et de syndicalistes véreux, vous tapez à présent dans les caisses de certains comités d’entreprise.
Son regard a l’intensité d’un laser, ce type me découperait en morceaux s’il le pouvait.
− Je vous le redis, monsieur Mexicos...
− Montesinos, Mateo Montesinos.
− Très bien. Je ne vois pas de quoi vous parlez, vous divaguez.
− Monsieur Luciani, Laurence Rivière a parlé.
Ses yeux se plissent encore, ce ne sont plus que deux fentes ; il s’envoie une rasade :
– Je ne connais pas cette personne.
– Vous ne la connaissez pas mais vous vous affichez pourtant avec elle dans des rallies, vous posez bras-dessus bras-dessous. Vous voulez que je vous montre la photo ?
L’impavide sénateur s’anime, il commence à se trémousser et fait mine de se lever.
– Restez assis ! Monsieur Luciani, je sais comment vous vous êtes organisés. Et comment vous avez atteint cette espèce d’impunité. Jusqu’à ce jour. C’est simple, apparemment ; encore faut-il avoir les moyens, mais vous n’en manquez pas. Vous avez des complices chez les magistrats, chez les policiers. Et toutes les affaires qui pourraient mettre en danger votre organisation vous sont aussitôt communiquées. Discrètement. Via une boite aux lettres à Bobigny. Elle existe, je l’ai rencontrée ! Si un dossier tombe entre les mains d’un juge qui n’est pas de votre réseau, celui-ci voit alors la promotion, ou la mutation, qu’il attendait depuis des années débloquée. Par enchantement. Même chose pour la police.
− Si vous savez tout, alors qu’est-ce que vous foutez ici ?
Son sourire mauvais me fascine. Un saurien, voilà à quoi me fait penser le sénateur, un reptile dans son marigot, faussement calme mais tout près à me bouffer au moindre faux geste. J’avoue :
− Avant de vous tuer, je voulais vous voir. Voir à quoi vous ressembliez...
Là, le type s’alarme ; il devait me prendre pour un gogo, un excité du bocal comme il doit en croiser pas mal à longueur de journées. Mais j’ai trouvé les mots qu’il faut, il vient de comprendre que c’est sérieux. Sur le champ, il puise dans ses réserves et me sort tout à trac sa rhétorique d’ultra :
– Parce que vous pensez peut-être que j’ai fait tout ça pour mon plaisir ? Que je la jouais perso ? Que Luciani ne pensait qu’à Luciani ? Ou que j’alimentais mon compte en banque ? Mais monsieur le justicier, vous n’avez rien compris : je me bats pour vous !
Et il me déballe tout un boniment sur la civilisation qu’il faudrait défendre, il énumère tous ceux qui auraient juré de faire « notre » peau, il parle des rouges, des juifs, des arabes, il s’énerve, il s’apoplexise, il voit des complots partout.
– Vous imaginez bien qu’ILS vont pas se gêner quand ils seront tous ici ! Et pour leur résister, faut pas des fiottes, des demi-portions, des couilles-molles.
– Comme Argentino ? Je balance, sans avoir calculé mon coup.
− Oui, comme Argentino, exact. Un dégonflé de première, celui-là. Un mesquin. Une petite bite, en plus. Qui ne voyait que son petit intérêt. Paix à son âme.
Il me sourit, mauvais.
– Vous avez le pistolet, vous vous croyez fort mais vous êtes condamné, jeune homme !
Il s’envoie une rasade :
– Et comme tous les condamnés, vous avez doit à la vérité ! Mon petit Orso, au fait vous ne le connaissez pas encore mais vous allez l’apprécier, j’en suis sûr ; bref notre Orso adore les chiens de combat. Vous voyez où je veux en venir ? Il m’a assuré que la viande des traîtres regorgeait de protéines...
Le sénateur s’amuse, il grogne, ricane et repart en croisade.
– Aujourd’hui, faut des commandos, des vrais. Et moi, Monsieur le visiteur du soir, avec mon organisation, j’ai construit un commando. Des commandos. Et on se prépare à faire face à l’invasion, au chaos... »
Il parle, il parle, il me saoule de sa tchatche. Mais ce type a beau avoir un bagou d’hystérique, c’est un malin, un calculateur ; il veut gagner du temps, chercher une issue, trouver une arme, un buste de Bonaparte, un cendrier, n’importe quoi qu’il pourrait me balancer dans la gueule. Il se lève en parlant et ses yeux cherchent. Je comprends sa technique. Je le stoppe :
− Et Hélène ? Pourquoi l’avoir tuée ? Elle n’avait rien à voir avec vos délires !
Il se rassoit brutalement et lâche en haussant les épaules :
– C’est toi qu’on voulait, tu le sais bien. Mais à la guerre, il y a toujours des dégâts collatéraux.
Ce ton, ce tutoiement de soudard, là, c’est trop, je ne sais pas ce qui me prend, je tire. Sans même viser. Le coup fait un bruit terrifiant. La balle lui a traversé le ventre. Le sénateur a l’air cloué à son siège, sa chemine blanche se macule lentement de sang. Il me regarde, sidéré, ne veut pas comprendre ce qui se passe, puis tente de colmater la plaie avec ses mains et finit par s’affaisser doucement sur le côté ; il pousse de petits souffles rauques. Cette musique m’est insupportable. Je me lève, pointe le canon dans son oreille gauche ; ses yeux sont chavirés, il ne me voit plus. Je l’achève.
Un dégât collatéral ?! Hélène ?! Je pouvais tout entendre, mais ça, non ! Vidé, je vais m’assoir juste en face de lui. C’est la première fois que je tue un homme. J’ai fait ça comme un cochon. Du travail salopé mais je n’éprouve aucun remord. Je devais le faire, pour me soulager, pour pouvoir penser sereinement à Hélène. Je ne retrouve pas vraiment mon calme mais le vertige qui me tarabustait pendant l’exécution s’estompe. J’attends. A nouveau. Le cadavre sénatorial émet encore de très légers bruits, comme une baudruche qui n’en finit plus de finir. Un peu plus tard, je ferme toutes les lumières et m’installe pour durer ; j’ai décidé de buter l’autre fumier, tout à l’heure. La nuit va être longue mais au bout il y va de ma délivrance. Du moins, je veux y croire. Plusieurs fois je me lève pour aller boire dans la cuisine ; je me contente de l’eau du robinet. Je devrais aller dans le bureau de Luciani, fouiller dans ses papiers, essayer de trouver des preuves de ce que je savais ou de ce qu’il m’avait avoué. Mais tout ça n’a plus guère d’importance. J’ai franchi le Rubicon, je n’avais plus qu’une obsession : me venger complètement. Toute la nuit, je rumine ma colère, et résiste au sommeil. Huit heures moins dix, un bruit de voiture dans la cour. La Mercedes est de retour. Je vais dans l’entrée, le Luger à la main, j’entends ses pas. Je sais que l’assassin d’Hélène est de l’autre côté de la porte. Il frappe. Je tourne la clé, j’ouvre doucement, en essayant de rester caché le plus longtemps possible. Une fraction de seconde il hésite. Je me dirai plus tard qu’il a dû trouver étrange que l’appart soit dans le noir. Mais il est sur son élan et pénètre dans le vestibule. Aussitôt je lui vise le cœur et je tire. Pas question de lui laisser sa chance, de lui offrir un duel. J’abats l’ours. Du moins, c’est comme ça qu’on fait, j’imagine, à la chasse. A nouveau l’arme fait un barouf d’enfer. Orso recule comme s’il venait de prendre un train en pleine poire et s’écroule. Du pied je lui déplace vite les jambes, histoire de pouvoir fermer la porte. Et je l’observe. L’exécuteur des basses œuvres, le bourreau privé de l’ex-sénateur, le tueur, le sicaire, le spadassin, le fauve, les deux mains plaqués sur sa poitrine, me découvre ; je lui trouve le même regard que le sénateur, glacial, têtu, buté, c’est le cas de le dire. La douleur doit le transpercer mais il n’a que haine en lui. Il sait qui je suis. Il s’en doute en tout cas. Je m’approche :
− Montesinos !
Il parle en corse, il m’injurie. Malgré une mort qu’il sait certaine, il a encore la force d’insulter. Entre deux petites bulles de sang, ses imprécations sortent de sa bouche en se précipitant. -
– O bastardo ! O rubaccia infetta chi tu si ! O carogna chi tu si
Je mets fin à sa litanie en lui explosant la tête, exactement comme je l’ai fait avec son maître. A la tanière, l’ours ! Aux pieds, la bête ! Couché, le sauvage ! J’ai soudain terriblement froid. L’insomnie, la peur, la haine ? Je me sens aussi minable et barbare que ces merdes que je viens d’éliminer. Ma carcasse se met à trembler, comme en état d’électrochoc. Je frissonne et je sue en même temps. Je me traîne jusqu’à la cuisine pour m’asperger le visage d’eau froide ; la machinerie se calme un peu. Mais il fait toujours aussi froid.
J’attends encore, je ne sais trop quoi, puis je refais le tour de la maison ; j’abandonne les étuis de balles, leur provenance sera à peu près impossible à trouver. Un Luger. Rescapé de la guerre. Evadé de Corse...Mais j’essuie les rares objets que j’ai pu toucher. Par déformation. Je range mes affaires dans le sac et récupère dans les poches d’Orso la clé de la voiture. Je vérifie, mais à quoi bon ?, que toutes les lumières sont éteintes et je sors prudemment. Il doit être dans les huit heures trente, il fait encore nuit. J’emprunte la Mercedes, c’est une automatique. Direction Bourg-la-Reine. Là, je laisse la voiture, fermée, sur le parking, je balance les clés dans une poubelle et je reprends le RER.
Chapitre 41
Roissy CDG.
Sur le site, on oublia vite Mehdi. Ainsi vont les choses. T’es là, c’est bien : t’es plus là, on zappe. Personne, dans son service, ne pensa prendre de ses nouvelles. Pourtant il n’était pas loin. Il créchait toujours au Vieux Pays. A Goussainville. De l’autre côté des pistes. Il vivait seul, ruminait beaucoup, radotait aussi. Petit à petit, il se mit à douter de la mort de Vera. On lui avait peut-être raconté un bobard, après tout, il n’avait pas vu le corps. Elle se cachait sans doute, comme elle savait si bien le faire, elle avait peur, il allait l’aider. Il se remit aux exercices, footing, pompes, barre fixe et tout le toutim. Il devait se préparer, pour de bon cette fois. Finie la bricole, il fallait qu’il se montre au top. Vera, demain, devait pouvoir compter sur lui, totalement, inconditionnellement. Prêt ? Prêt ! Il allait être son garde du corps modèle, son superflic rien que pour elle, son agent privé infaillible, son service de sécurité à lui tout seul. Il avait compris : autour de Véra, le risque était très élevé, il lui fallait donc une protection rapprochée maximum. Il continuait de s’entraîner comme une bête, s’harnachait comme un pro. Il se ruina pour se procurer tout l’attirail nécessaire, le gilet pare-balles à port dissimulé, l’oreillette reliée à une radio Acropol portée sous l’aisselle, un pistolet automatique Glock 26, 10 coups, à la ceinture, la matraque télescopique portée à la taille. Il aimait ce sentiment de force que lui donnaient tous ces accoutrements. Il s’inventait des scénarios tordus ; si l’ennemi attaquait en nombre, il sortirait, magie magie, un pistolet mitrailleur HK MP5 et faucherait les intrus. Des guignols dans l’assistance menaceraient sa Véra d’objets divers, ustensiles pointus, pierres, acides ? Il brandirait son parapluie de protection antilacération. S’il devait escamoter la jeune femme aux regards de l’assistance ? Il déplierait illico dans une manip express les trois panneaux de sa valise de protection en Kevlar et le tour serait joué. Il avait bien répété, tout collait. Oui, il était super-paré, Mehdi. Go, go, go, Mehdi.
Le garçon s’estimait vraiment fin prêt, capable de s’adapter à toutes les formes de risques. Si le danger était faible, il accompagnerait seul la jeune femme et son matériel était suffisant. Il apprécierait au cas par cas s’il devait prendre le parapluie ou la valise ou l’HK MP5. Si le risque était élevé, il lui faudrait des aides : il ferait venir les trois mousquetaires. Il avait pensé embaucher des mômes du coin mais ils n’étaient pas très sérieux et il allait faire appel à des mecs de la Sécu, il en connaissait assez. Les trois « extras » devraient former un triangle entourant Véra, un gardien ouvrirait la marche, les deux autres surveilleraient ses côtés gauche et droit et lui serait le bodyguard chargé de défendre les arrières. Une sorte de losange de protection. Maintenant, si le risque était maximum, et avec Véra, ce serait toujours un peu le cas, alors il devrait sortir le grand jeu à huit : aux quatre précédents gardes, il en ajouterait quatre, dans les trous en quelque sorte, histoire d’encadrer complètement la fille. Ils formeraient ainsi un « carré tireur », une bulle inviolable. Pif savait qu’on pouvait faire encore mieux, envoyer des « précurseurs » en avant-garde pour tester tous les endroits que Véra allait traverser ; à eux d’évaluer la menace. On pouvait aussi disperser parmi la foule des aides à oreillette qui seraient en permanence au contact discret des gens. Mais bon, tout ça, c’était l’idéal. Demain, peut-être, il embaucherait tout ce monde.
– Véra je suis prêt ! » hurlait-il en trottant dans les rues désertes du Vieux Pays.
– Tu m’entends, Véra ?
Où était-elle passée ? Ils avaient pourtant bien rendez-vous. En tout cas, lui n’était pas en retard. Et équipé comme il faut.
– Véra ?! Il parlait aux murs délabrés, aux fenêtres aveugles, à la chaussée jonchée de débris, aux végétaux qui reprenaient partout le pouvoir, dans la moindre faille, la plus petite crevasse.
Le quartier n’était que délabrement, dévastation, désolation.
– Véra ?!
Un jeune homme en Vespa vint à passer, lentement, intrigué par ce Robocop qu’il n’était pas sûr de reconnaître. Pif se précipita au devant de la machine, saisit le guidon avec une vigueur impressionnante, immobilisant de fait l’engin et fit chuter le conducteur.
– Face au sol ! Mains en l’air !
– Mehdi, c’est moi, fais pas le con, beugla le gamin qui venait juste d’identifier son agresseur.
– C’est moi, fais pas le con ! reprit Pif d’un ton grinçant. Penché sur le môme, il se livra à une palpation très rapide, bras, tronc, jambes, entrejambe. Il se redressa et, à la manière d’un gardien de but qui dégage son ballon, il balança un coup de pied magistral dans la tête du motocycliste à terre, lequel s’évanouit.
Mehdi récupéra tous ses ustensiles, pistolet-mitrailleur, parapluie, valise ; il ressemblait à un représentant de commerce empressé. Puis il partit, au trot,
parmi les décombres de l’ancienne cité, relançant régulièrement son cri de guerre :
« Véra, j’arrive... »
A CDG, personne à ce jour n’a découvert la tanière de la Roumaine.
Chapitre 42
C’est ici que tout a commencé, avec Hélène. La brasserie « Aux Cadrans » face à la gare de Lyon, à la sortie du métro de la ligne 1. Les premiers rendez-vous, les premiers cafés, les premiers rires, la découverte de l’autre. Jusqu’à cet après-midi du mois de mai où elle avait fini, enfin, par céder. Cette première fois, si émouvante et angoissante, si différente des autres premières fois. L’exploration de ce corps, ces seins parfaitement blancs, si doux, « du coton » avais-je pensé, ce regard qui se troublait sous mes caresses. Ces dimanches à s’aimer, seule la faim nous faisait sortir du lit ; on y retournait pour se consumer, comme deux zélotes d’une nouvelle religion. Les premiers vrais « Je t’aime », comme si les autres, avant, n’avaient été qu’une répétition.
L’arrivée de Bati me fait revenir sur terre. Il commande un café, me tend « Le Figaro ». Je ne peux m’empêcher de lui dire :
− Je ne comprends pas que tu puisses lire ce journal de merde.
− Matéo, j’essaie de faire vivre Monsieur Dassault. N’oublie pas qu’il est orphelin de père et de mère.
En « Une », sous la mention « Exclusif », le titre s’étale sur près de la moitié de la page : « Le Sénateur Luciani et son chauffeur tués par un groupe intégriste ». Le chapeau de l’article précise : « Un courrier à la rédaction revendique les exécutions. » Suivent les reproductions de phrases dactylographiées où l’on peut lire que les deux hommes ont été exécutés « au nom des martyrs assassinés par la France et son valet, pendant la guerre d’Algérie » et qu’il faut s’attendre à « d’autres victimes de la vengeance du peuple ». Le texte se termine par la formule « Allah Hakbar » ( « Y a pas de H à Akbar, se dit, méticuleux, Matéo) et il est signé : « Groupe 19 mars 1962 ».
Le journal tartine sur les conditions de réception du message, son authentification et conclut : « Ce groupe est inconnu des services de police mais aucune piste ne sera écartée, nous a-t-on fait savoir ». Suit une flopée de témoignages émus d’élus de tous bords, s’indignant de ce lâche assassinat.
Je lève les yeux vers Bati :
− Pourquoi le 19 mars 62 ? Pourquoi t’as choisi ce nom et cette date ?
− C’est la date des accords d’Evian, Matéo, ça marque la fin de la guerre d’Algérie. Comme pour tout accord, il a dû y avoir des désaccords, non ? Enfin, j’ai rien trouvé de mieux, désolé. De toute façon, ça va compliquer, un peu, l’enquête, on sait bien comment travaille la maison. Mais les « autres », eux, ne seront pas dupes. Ils comprennent bien que tu es derrière ces meurtres. Et ce sont eux qu’il faut prendre de vitesse.
Comment dire le contraire ?
Bati reprend :
− Ta démission a choqué beaucoup de monde à la brigade .
− J’ai reçu en effet quelques messages sur mon portable, j’ai pas répondu.
− C’est trop tard, maintenant. T’as les clés de ton appart ?
– J’y suis pas retourné, ni au crématoire, tu sais. J’étais à l’hôtel. J’ai tout fourgué, le Luger et les vêtements que j’avais l’autre soir, dans une consigne à Montparnasse.
Je lui file mon ticket.
− Ok, dès ce soir, je vais récupérer tes frusques et l’arme et je les fais disparaître. Maintenant écoute moi bien. Quand tu arrives à Marseille, tu vas à la Joliette. Tu sais où c’est ?
Bati est drôle quand il veut.
− Non, mais je trouverai.
− Petit con. Il y a un billet qui t’attend, au guichet 13 de la gare maritime, au nom d’Antoine Lorenzi. Tu règles en liquide. T’en as sur toi ?
Il ne me laisse pas le temps de répondre et me glisse une enveloppe toute boursouflée.
− Tu embarques ce soir sur le Napoléon Bonaparte à 20h. Arrivée à Bastia : 7h00 ou 8h00 demain. Là, tu vas place Saint Nicolas, face au débarcadère, tu ne peux pas te tromper, tu te poses au bar qui est au milieu de la place, « Café de la paix » qu’il s’appelle. A 9h15 précises, tu sors. Une BMW, immatriculée 2404 SH 2B, s’arrêtera. Tu la rejoins, elle sera conduite par mon ami Charlie, Charlie Lévenard. Tu peux lui faire une totale confiance. Il va t’amener dans un premier temps à Talasani, son village, le temps d’organiser ton passage en Sardaigne à partir de Bonifacio. En Sardaigne, on va te préparer une nouvelle identité : passeport, carte d’identité. Ta destination finale sera Caracas.
Je marque le coup
− Tu pouvais pas choisir un coin un peu plus loin, non ?
− On aurait pu te choisir Tahiti mais il paraît que tu n’aimes pas trop la chaleur. Caracas, c’est bien, c’est tempéré.
Bati recommande un café
− Surtout Matéo, pas de lettre, pas de coup de téléphone. A personne, et bien sûr pas à ta mère. Rien de rien. Tous les messages ne seront qu’oraux. Si tu as quelque chose à me dire, tu me le transmettras par la filière dont tu vas faire connaissance en Sardaigne, c’est Lévenard qui me fera passer l’info. Et quand j’aurai moi quelque chose à te dire, je passerai par lui.
Je râle.
− C’est comme ça que je vais apprendre le décès de ma mère, par exemple ?
− J’irai la voir, Matéo, je lui expliquerai. Mais pas maintenant. Je suis sûr que son domicile est surveillé. J’en suis persuadé.
Il marque une pause
− Et tu reviendras quand tout se sera calmé.
Je n’en crois rien, mais je fais comme si.
− Mais Bati, s’ils me trouvent pas, ils vont remonter jusqu’à toi ?
− T’inquiète pas, Matéo, je suis en congés jusqu’au 31 décembre, et le 1er janvier, je suis à la retraite. Je dois finir quelques trucs que j’ai commencés et je rentre chez moi, à Luri, au plus tard la semaine prochaine. S’ils veulent venir à Luri pour faire leur cinéma, je leur souhaite bonne chance.
Je ne suis pas vraiment rassuré. On se regarde ; j’aurais bien voulu rester avec lui. Pourtant je me lève ; j’ai les yeux qui commencent à piquer. On se serre fort dans les bras, là, en pleine brasserie, on doit avoir l’air tarte. Dans un espagnol hésitant, il lâche :
– Hasta siempre
− Adios
Ça fait un peu brigadistes attardés qui se rejouent la scène des adieux. Il prend mon ticket de consigne, sort le menton dressé et tourne la première à droite, rue de Lyon. Moi, je traverse le boulevard Diderot, je monte les marches de la gare. Normalement, je devrais me retourner, une dernière fois, pour me graver sur les rétines ce putain de quartier que j’ai tant aimé, où j’ai tant aimé. Mais je peux pas, je suis raide comme un garde suisse en pleine parade. Le TGV pour Marseille est à l’heure. Je m’y installe avec le sac contenant quelques vêtements de rechange.
Trois heures et quelque plus tard, je suis gare Saint Charles. On est en fin d’après-midi mais il fait déjà nuit. Ce sont les jours les plus courts de l’année. C’est dans cette gare que mon père a posé les pieds, pour la première fois, en France, avec sa valise et quelques frusques. Il me semble que c’était il y a un siècle. Mentalement, je fais le trajet jusqu’à La Joliette. En sortant, je frissonne, de tristesse, de haine. Je contourne les éternels abonnés des sorties de gare, je descends vers le boulevard d’Athènes avant de tourner à droite et de m’enfoncer dans la nuit Marseillaise.
FIN
ANNEXES
Document n°1
Extraits du rapport d’Euroexpertise sur l’opération de time-share du CCE Air France à Fuengirola (Espagne).
« En novembre 1992, le bureau du Comité Central d’Entreprise du groupe Air France proposait à ses membres réunis en session des 25 et 26 novembre 1992 l’acquisition de semaines en multipropriété (Time-Share).
Cette première opération portait sur des semaines de vacances situées dans des appartements localisés dans la région de Fuengirola dénomme Malibu centre , et dépendant d’un club de vacances, le « CLC Developments Limited » dont le siège social est : 28 Finch Road, Douglas, Ile de man (Iles Britanniques).
1)Le 10 décembre 1992, une première promesse de vente est signée avec le club CLC Developments Limited, pour une période de 70 semaines moyennant un prix de 6 230 000 francs, paiement effectué par chèque, daté du 09 décembre 1992, tiré sur le Crédit Lyonnais, au nom de Landmark Title Agency, Compte séquestre « Club La Costa » sur un compte de : La Banque Populaire – 55, avenue Aristide Briand – 92542 Montrouge cedex, soit un prix de 89 000 francs par semaine classifiée rouge.
Lors de cette opération, nous avons constaté l’anomalie suivante :
Landmark Title Agency Limited, immatriculée en Angleterre sous le n° 2105882, n’a rien à voir, si ce n’est la ressemblance du nom avec :
Landmark Title and Trust Limited, immatriculée en Angleterre sous le n° 01112603, titulaire du droit réel de propriété des immeubles sis à Fuengirola.
Or, c’est la première société Landmark Title Agency qui est bénéficiaire du paiement déposé à la Banque populaire de Montrouge (France).
D’après recherches, cette société anglaise n’a déposé aucune comptabilité, ni de déclaration fiscale depuis le 31 décembre 1991 et elle a été liquidée d’office le 31 octobre 1993, soit peu de temps après l’encaissement du chèque de 6 230 000 francs.
2)Le 1er décembre 1994, une nouvelle promesse portant sur 31 semaines, toujours à Fuengirola, est signée avec une autre société, la CLC International Marketing Limited, Siège au 28 Finch Road, Douglas, Ile de Man.
Pour une période de 31 semaines, moyennant un prix de 3 172 850 Francs, paiement effectué par chèque de banque, tiré sur le Crédit Lyonnais, daté du 24 novembre 1994, au nom de First American Title Insurance Company – UK – et non plus au nom du Club La Costa, soit un prix de 102 350 francs par semaine classifiée rouge.
Là aussi, il conviendra de vérifier les incidences d’une confusion possible concernant la différence de nom des sociétés suivantes :
La First National Trustee Company Limited a son siège à l’Ile de Man, elle est titulaire des titres de propriété, et est enregistrée sous le n° 37018.
La First American Title Insurance Company a son siège à Londres, 63 Victoria House, enregistrée sous le n° 1112603 ; son unique activité est l’assurance vie ; elle est le bénéficiaire du chèque de 3 172 850 francs.
Le plus étonnant reste le fait que ces deux transactions ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société française, dont le nom semble avoir été curieusement modifié, sans avoir recours aux publicités légales :
La société TFSC – Time Share France Communication, SARL a son siège au 34, rue Beaujon – 75008 Paris ; elle est immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 347 507 014, et est représentée par monsieur Franck Romin, c’est la signataire des deux ventes avec le CCE et elle figure sous cette appellation dans les contrats de vente.
Or, il ressort de nos recherches que cette société n’existe pas sous cette dénomination.
En effet, le numéro d’inscription au registre du commerce de Paris B 347 507 014, correspond à une société dénommée Sport France Communication, qui a pour activité « les services annexes à la production », dont le siège était initialement fixé : 75, avenue Parmentier – 75011 Paris, transféré ensuite au 34, rue Beaujon – 75008 Paris, et dont le gérant est monsieur Jean-Luc Arribart . Monsieur Jean-Luc Arribart dispose curieusement d’une société immatriculée en Irlande, ce depuis le 28 septembre 1990 : La Galestar Investments Ltd, 101 Furry Park Road, Howth, Dublin.
Document n°2
Rapport d’audit sur opération de time-share du CCE Air France à Radstadt (Autriche). Extraits.
Note de synthèse
Le bureau du Comité central d’entreprise de la société Air France nous a mandatés en janvier 2000, à l’effet de vérifier l’évaluation du prix d’acquisition de différentes semaines de vacances en Temps Partagé « Time-Share », réalisées au cours des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997. Votre demande d’évaluation faisait suite à un dépôt de plainte contre X, déposé en décembre 1999, avec constitution de partie civile. Après avoir procédé aux vérifications sur place, nous avons rédigé plusieurs rapports. Ceux-ci font mention de négligences d’ordre juridique et financier, ainsi que d’une surévaluation anormale des prix d’achat. Au vu de nos conclusions, vous avez décidé en 2002 d’engager une procédure civile (en Autriche). Le but recherché étant l’annulation des actes de vente pour cause de lésion, en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées indument. Le TGI de Salzbourg a donné suite à votre requête, considérée comme justifiée. Un premier rapport d’expertise (autrichien) conclut à une surévaluation des prix de 40%, confirmant en partie nos conclusions. (Mais) l’expert autrichien a omis certains points techniques ne pouvant qu’augmenter cette différence et porter la surévaluation à environ 65%. (…) Il paraît évident à la lecture des différents mémoires que la nullité pour lésion des contrats de timeshare devrait être reconnue, compte tenu d’une disproportion marquée entre les prestations des deux partie. L’analyse des premiers échanges de mémoire confirme nos premières analyses faisant état de prix et conditions d’achat majorés dans des proportions anormales.
Fait à Paris le 9 mars 2004
L’expert agréé Francis Felgate, agréé CNEI et CEACE.
Rappel des faits
Les opérations se déroulent entre le CCE Air France, acheteur, et deux sociétés étrangères différentes, vendeurs. Les achats des 309 premières semaines sont réalisés avec le Ferienclub, société dont le siège est situé à Radstadt et dont les associés sont autrichiens. Les deux dernières acquisitions pour 147 semaines sont réalisées avec une société FM Holiday, siège à Radstadt, représentée par des associés de différentes sociétés étrangères, dont le gérant est M. Morin, de longue date fournisseur habituel du CCE pour ce type d’opération en time-share.
1)Ferienclub : Les opérations sont effectuées en toute légalité, pour un prix global de 21.365.000 FF correspondant à l’utilisation de 309 semaines. Bien que le formalisme juridique ait été respecté, certaines anomalies ont cependant été constatées ; elles portent sur des prix d’achat surévalués, sur le montant des commissions versées aux intermédiaires à hauteur de 40% du prix de vente (Groupe Morin), sur les erreurs de classification saisonnière des semaines et quelques erreurs de propriété non encore régularisées. Il nous a aussi semblé curieux que le 23 octobre 1993, une offre ait été faite par le Ferienclub au CCE pour se rendre acquéreur de 309 semaines à un prix symbolique de 150 000 FF et aucune réponse n’a été faite alors que le prix des 309 premières semaines s’élevait à plus de 21 millions de FF. Soit un manque à gagner pour le CCE de 21.365.000 FF – 150 000 FF = 21.215.000 FF.
Sur le prix des opérations : les cessions intervenues dans des sites comparables font ressortir un prix maximum de 50.000 FF la semaine pour un logement de six personnes en haute saison dans les années 1994-1995. Pour les années postérieures, les prix sont en chute libre, de 6.000 FF à 15.000 FF pour ce genre de semaines. Cette tendance explique la proposition de Ferienclub de 1998 pour l’achat de 309 semaines au prix symbolique de 150.000 FF.
2)FM Holiday : Les deux opérations menées avec cette société comportent des anomalies et des questions restées sans réponse à ce jour. Notre mission a permis de vérifier la date de signature de chacun des chèques établis lors de ces opérations ainsi que l’ordre correspondant. A ce titre, nous avons pu relever le fait que Me Stoltz, avocat à Radstadt, n’était nullement habilité, dans la promesse de vente, à recevoir un chèque tiré sur le CCE d’Air France dans la mesure où ce moyen de paiement n’a pas été directement utilisé au financement des semaines en time-share mais dans le cadre d’une opération de « portage financier » au profit de FM Holiday, société constituée pour la circonstance, afin d’acquérir la propriété de la totalité des lots, mis par la suite en time-share et revendus pour partie au CCE Air-France.
1ère vente : le 21 novembre 1996, 105 semaines pour 9.882.000 FF, soit 95.067 FF la semaine.
Les prix, à la hausse, font l’objet de surfacturations évidentes. Par ailleurs, Mr Morin, gérant de FM Holyday, et intermédiaire du précédent programme Ferienclub, a directement encaissé un chèque de banque de 9.982.000 FF, tiré sur le compte du CCE d’Air France ; il a utilisé cette somme pour créer sa propre société (FM Holyday), en dehors de toute fiscalité française ; pour acquérir des immeubles en toute propriété au nom de FM Holyday ; pour revendre huit mois plus tard la jouissance en temps partagé de semaines au CCE d’Air France, réalisant ainsi avec les fonds mis à sa disposition par ce CCE une plus-value personnelle de plus de 25.000.000 FF.
2ème vente : le 26 juin 1997, 42 semaines pour 4.205.420 FF, soit 100.131 FF la semaine.
Les prix de vente ont encore augmenté alors que les méventes sont notoires ( vente forcée aux enchères publiques de deux chalets fin 1996). De plus, cette seconde opération traitée avec FM Holiday a été menée en infraction totale avec la législation de l’époque ( loi de 1996, transposition de la directive communautaire du 26 octobre 1994). Nous avons par ailleurs été amenés à constater les irrégularités suivantes, relatives au paiement des semaines et à la non-production des certificats d’attribution notariés et enregistrés : dans un premier temps, il nous a été indiqué qu’un chèque d’un montant de 3.956.000 FF, tiré sur le compte du CCE ( Crédit Lyonnais n° 0073935 du 4 juillet 1997) aurait été remis par M. Morin à Maître Stolz, avocat à Radstadt. Après vérification, il s’est avéré que ce chèque a été annulé et remplacé par un virement Swift d’un même montant, émis le même jour, directement à l’ordre de FM Holydays sur la banque Ralffelsenkasse à Radstadt. Il n’a pas été possible, en l’état actuel de la mission, de déterminer si ce montant a réellement servi au paiement des semaines pour le compte du CCE, et donc de vérifier si le CCE en est bien propriétaire. Le dernier courrier reçu par Maître Haslauer ( 1er mars 2000), notaire chargé de l’enregistrement de ces actes, nous précisait que les documents officiels nous seraient envoyés sous huit jours, soit le 9 mars 2000. Le 29 mars 2000, on est toujours dans l’attente de ces textes. Il convient donc de se demander si le CCE est oui ou non titulaire de ces semaines.
A défaut de production desdits justificatifs, il paraîtra évident que les membres du CCE ont été floués dans cette opération ; il faudrait savoir qui est le véritable propriétaire de la toute propriété de ces immeubles, les chèques du CCE ayant directement servi à acquérir la totalité des biens immobiliers. Précisons toutefois qu’une hypothèque a déjà été prise par la banque AVA à l’encontre de FM Holidays sur certains lots des deux chalets, le 21 août 1997, pour un montant de 2.925.000 FF ( lots n° 10,11,17,19).
Conclusion
Les faits relatés dans ce premier rapport d’audit démontrent que ces opérations de time-share à Radstadt ont été effectuées dans des circonstances anormales tant au niveau des prix que des irrégularités constatées, et au mépris de toute prudence élémentaire. Il convient en conséquence de poursuivre, voire d’étendre la mission, afin d’obtenir les justificatifs demandés et d’apporter les réponses aux questions non justifiées.
Francis Felgate, expert agréé par la Compagnie nationale des experts immobiliers de Paris, par la Chambre des experts agréés de la Communauté européenne.
4 de couv
Entoulooping
de Gérard Streiff et Mateo Montesinos
Ça vole haut les millions au CCE d’Air France. A la BRDE (Brigade anti-fraudes), Mateo Montesinos, jeune flic marseillais qui découvre Paris, et son vieil ami corse Bati, s’intéressent à un copieux détournement de fonds ; des surfacturations magistrales, des montants à faire planer. Plus l’enquête avance, plus elle recule ; et ce n’est pas un effet d’optique. Leurs investigations dérangent grave. Mais c’est qui, le monte-en-l’air ?
Au même moment, à Roissy-CDG, gigantesque ville éphémère chaque jour recommencée, Vera, une SDF roumaine squatte l’aéroport et file l’imparfait amour avec « Pif », un gars de la sécurité ; l’ennui, c’est que la fille, parano sur les bords, s’est faite des ennemis, des tenaces, des nuisibles, un mac de Brasov, un teigneux au poinçon également.
Aucun rapport entre les deux histoires, quoique...
Un polar aérien.